Dans sa pièce de théâtre La Conférence, Christophe Pellet donnait libre cours à une pensée critique sans concession. C’est cette pensée que nous retrouvons dans l’essai qu’il publie au cœur de la mêlée d’une rentrée littéraire à jamais marquée par « l’esprit français » qu’il fustigeait. Mais il s’agit d’une critique plus large et plus glaciale, plus profonde et moins colérique, à l’image du titre « oxymorique » : comment la contemplation peut-elle être subversive ?
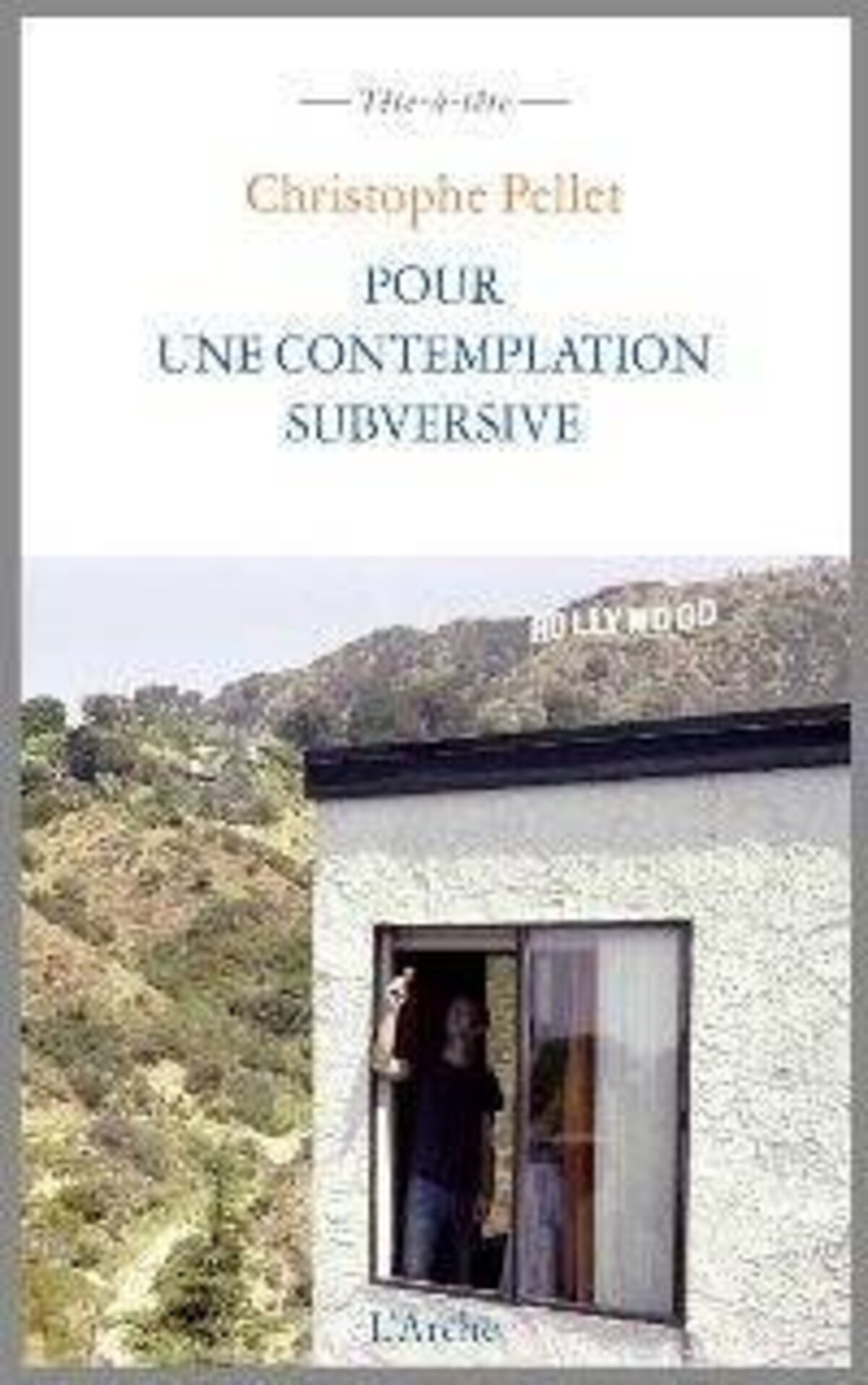
Avant tout, qu’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit pas d’une contemplation quelque peu naïve et passive, l’auteur faisant clairement la distinction entre le contemplatif et le contemplateur : « Là où le contemplatif évacue tout combat, toute lutte pour ne s’attacher qu’aux seules forces de l’esprit et de l’intellect avec comme recherche principale le bien-être, la sérénité et une forme de profit, le contemplateur tel que je le définis s’affirme par une présence physique en lutte avec la matière, une lutte qui n’est pas un conflit mais un corps à corps » (p. 16). Autrement dit, aucune fuite dans la contemplation de Christophe Pellet mais bien un affrontement du monde ou une confrontation constante avec le réel. D’ailleurs, comme il le souligne, le contemplatif, s’il n’affronte pas le réel, le contestataire qui en appelle toujours à un autre monde, une autre société, ne l’affronte pas plus : « le contemplateur est éloigné de cette attitude de vain refus ou de cette fantomalisation du réel définie par Bachelard et Rosset : il ne prévoit rien, n’envisage pas un autre monde possible que l’instant présent de son propre monde à l’œuvre dans sa conscience » (p. 26).
Le contemplateur est un écrivain – un « voyant » du réel – mais le lecteur l’est aussi, par le biais d’une écriture : « La voix immatérielle de l’écrivain devient matière par le style, et le style, une matière à contempler par le lecteur » (p. 34). La contemplation est alors subversive car elle est regard incisif, net, sans concession, authentique, en mesure de « modifier un conformisme ambiant » (p. 66). Mais si les morales répressives d’antan tentaient de canaliser parfaitement toute forme d’art subversive, elles les suscitaient d’autant plus. Aujourd’hui, il y a le marché, et il dénature l’art, le vide de sa subversion. Le capitalisme industriel a fait que « notre capacité à contempler s’est perdue, dissoute au cœur de ce temps productif » (p. 73). En suivant les réflexions subversives du contemplateur portugais Fernando Pessoa, l’auteur pose la question : « pourquoi travailler autant (…) ? Pourquoi le temps de la contemplation n’accompagnerait-il pas le temps du travail ? » (p. 84).
À lire l’essai de Christophe Pellet – cette invitation à la contemplation matérialiste –, on en vient à penser que nous sommes dans l’informe comme jamais auparavant, de plus en plus conscients du réel et vivant de plus en plus complaisamment dans du virtuel – nos vies deviennent virtuelles, le réel n’est que souffrance, tragédie, mort, tandis que nos joies, nos désirs, nos satisfactions, nos amitiés etc. sont de plus en plus détachées du réel, indépendantes, comme en apesanteur. Et l’art dans tout cela ? et l’écriture, le livre ? Après le temps de l’emprise marchande qui fait toutes les rentrées littéraires où (tré)passent tant d’auteurs authentiques, serait-ce le temps de la littérature immanente, de la fin de l’art[1] ? Parviendrons-nous par la contemplation subversive à casser « cet immobilisme pesant et insupportable, né d’une agitation extrême imposée par les classes dirigeantes pour mieux nous asservir à leurs lois, à leur désir de profit et de consommation, et par-dessus tout, à leur angoisse de mort » (p. 89) ?
Je dirais volontiers : nous l’espérons. Mais l’espoir, défini par Spinoza, est une passion qui n’apporte que tristesse, ce n’est pas une action – l’espoir est pour le contemplatif, non pour le contemplateur. Alors, nous devons effectivement ressentir, tel que l’exprimait Pessoa dans son Livre de l’intranquillité et cité par Pellet[2], mais, pour que la contemplation nourrisse une action, nous devons aussi désirer, et, ce désir doit pouvoir se situer entre Spinoza et Sade, puisque bien des pages du livre évoque le désir matérialiste du « divin » marquis que l’on voudra à nouveau enfermer dans les enfers de la littérature à cause, justement, de son pouvoir intact de subversion.
Christophe Pellet, Pour une contemplation subversive, L’Arche, 2012, 107 p., 16 €.
[1] Ou de son histoire : « les grandes œuvres ne peuvent naître que dans l’histoire de leur art et en participant à cette histoire. Ce n’est qu’à l’intérieur de l’histoire que l’on peut saisir ce qui est nouveau et ce qui est répétitif, ce qui est découverte et ce qui est imitation », Milan Kundera, Les testaments trahis.
[2] « Il existe des âmes contemplatives qui ont vécu de façon plus intense, plus vaste et plus tumultueuse que d’autres qui ont vécu à l’extérieur d’elles-mêmes » (p. 84).



