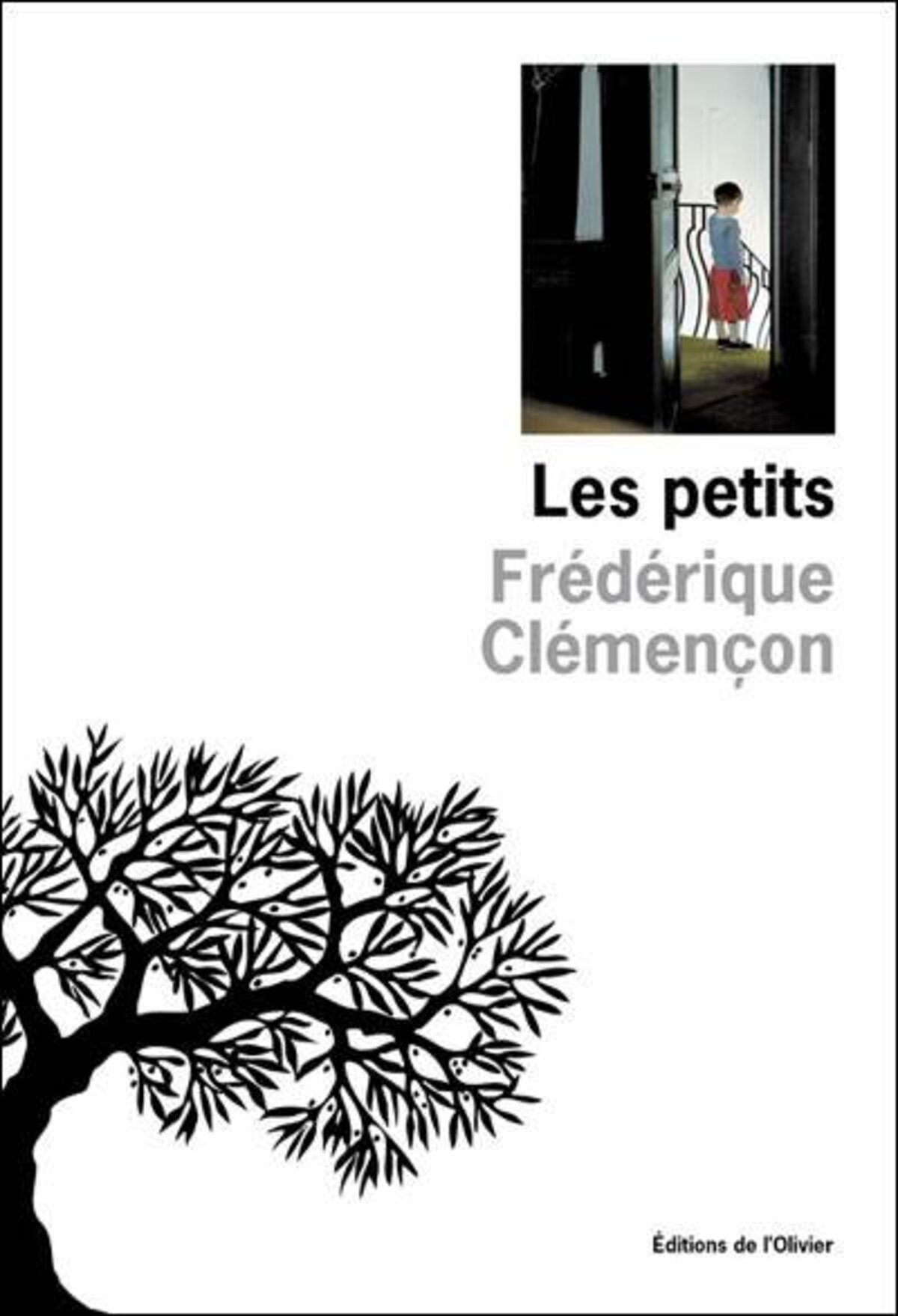
« — Je sais pas, petite.
— M’appelle pas petite, ça m’énerve. Moi, je sais, je veux dire que je sais ce que je veux ».
Frédérique Clémençon est un écrivain des voix. Elle les multiplie, les fragmente, fait de ses livres (romans, nouvelles) des chambres d’échos.

Dans Une Saleté (Minuit, 1998), deux femmes, une mère et sa fille parlent et règlent leurs comptes. Elles ne dialoguent pas véritablement, leurs récits se croisent, incommunicabilité, intimité perdue, encore fragmentés par une troisième voix, ironique, et celles des disparus (père, beau-père, grand-père). Des « filets de voix », des tissus de mots qui s’entrechoquent, construisent un univers tendu, lourd, dense. Dès ce premier roman, Frédérique Clémençon imposait un style, une voix justement, cette maîtrise d’une parole tout à la fois intime et mise à distance, et un texte conçu comme une modulation, retrouvant le grain de chaque voix pour mieux dire celle d’un écrivain, inspiré par l’altérité. Une saleté, singulier de façade, alors que le pluriel se déploie dès la première page du roman (« les saletés qu’elles m’a dites ce jour-là tout de même »), éclats, fragments.
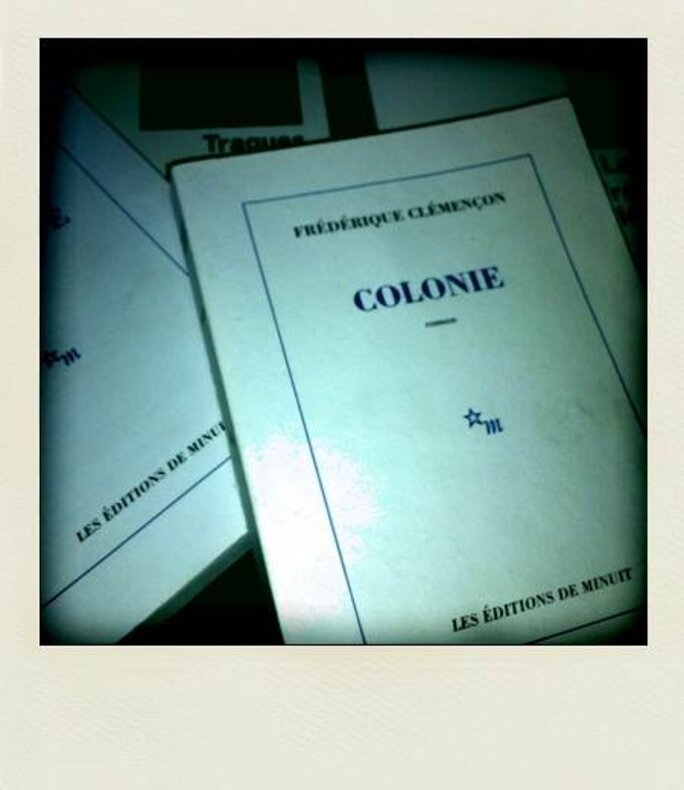
Dans Colonie (Minuit, 2003), Léonce et sa mère, dans une maison des frontières (demeure à l’abandon, entre la rivière et la Nationale, perdue dans un passé à jamais souvenir), chambre d’échos toujours, murmures, envies d’exotisme et d’aventure, récits et mythes qui se transmettent. Comment faire corps avec les rêves, les souvenirs ? Polyphonie, encore, et un univers fracassé, en déréliction.
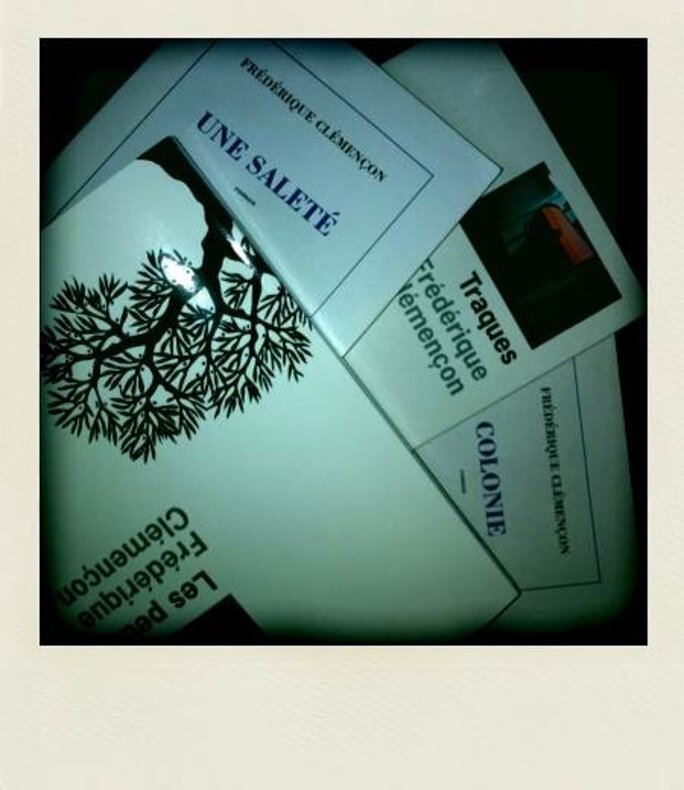
Dans Traques (L’Olivier, 2009), Frédérique Clémençon croise les voix de quatre personnages, Jeanne, Vincent, Anatole, Élisabeth, le roman se construit sur ces récits juxtaposés, trouvant des liens, des échos : la fuite, les fantômes, les ruptures. Tous portent le poids d’une histoire, de morts, d’exils, de bonheurs disparus ou refusés. Tous s’échappent dans et par les mots, tentent de redevenir « entiers », malgré les souvenirs, les haines, les peurs, l’indifférence et le poids du monde.
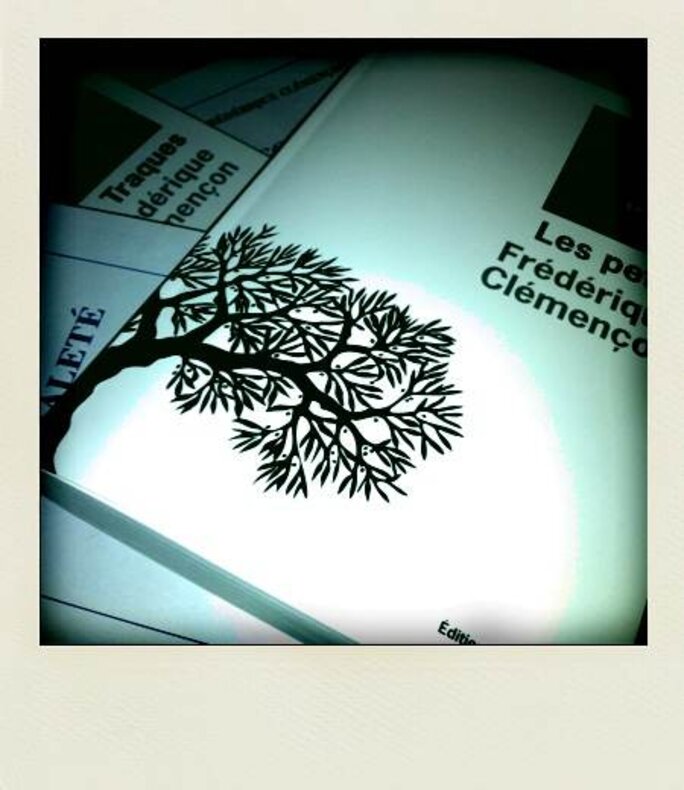
Et aujourd’hui, Les Petits (L’Olivier, 2011), texte qui affiche cette fragmentation jusque dans sa forme : recueil de huit nouvelles, de voix, intérieures, intimes, au bord de la rupture au monde, aux autres et à soi. Des petits donc, majoritairement des enfants, ou des modestes, des écrasés, des oubliés.
Jean, banni, indésirable, que sa belle-famille et sa femme Alice se sont employé à « faire disparaître » et qui partage un dernier pique-nique sur la plage avec ses filles, les « petites », les premières du livre. Frédérique Clémençon déploie dans ce récit magistral sa manière singulière, cette violence à l’état de latence, toujours au bord de l’implosion, cette colère qui sourd à travers les lignes, au cœur du texte, qu’elle imprime en nous malgré l’apparente légèreté du ton. D’autant plus cinglant.
« Voilà ma vie, se disait Jean : rien de moins qu’une affaire de conquêtes et de territoires, une minable affaire de territoires à conquérir – ou pas. Le sien, il n’avait pas su le défendre, il s’était étiolé, avait rétréci sous leurs assauts répétés, inlassables. Pendant que le leur avait gagné en puissance, en épaisseur, s’était fortifié, le sien faiblissait, en vertu de cette loi implacable, mécanique, qui voulait que ce qui est perdu pour l’un profite à l’autre, Alice tirant une joie mauvaise de ces joutes dont elle avait été un témoins gêné puis intéressé avant d’y prendre part elle-même, les mains posées sur la chevelure fine des fillettes qui le fixaient incrédules : il fut bientôt vaincu.(Mais après tout que possédait-il vraiment ? de quel territoire pouvait-il se flatter d’être l’unique possesseur ?) »
La voix intérieure de Jean se diffracte, se perd en parenthèses, souvenirs heureux, douloureux (plus de partage, tout bonheur devient douleur quand on est exclu de son propre passé), dans sa voix s’imprime celle de l’auteur, qui jamais ne juge, feint d’exposer, neutre, et fait entrer un infini dans ces non-dits, ces creux, ces failles.Violence sourde du Bannissement de Jean, des Mains de maman, quand Paul ressent la honte inavouable de la séparation de ses parents, durant les vacances, père disparu sans laisser d’adresse, « il se sentait honteux, coupable de ce qui était arrivé, sans être en mesure de nommer sa faute, ce qui ajoutait à sa honte ». Honteux du chagrin de sa mère, de son visage « devenu aussi dur qu’un caillou, sale aussi ». La vie est Une saleté, l’enfance un enjeu, un territoire que se disputent les adultes. Qui offre parfois des moments en apesanteur, hors de l’espace, comme ces pique-niques au bord de la mer qui ponctuent les deux premiers récits, moment climatérique, « une sorte de tremblement de terre à peine perceptible, une faille discrète par où le chagrin avait commencé à s’échapper, à s’écouler doucement, vidant petit à petit l’espace de cette grisaille qui les accompagnait partout, de cette sensation qu’autour de soi tout était figé, empesé, au bord de l’asphyxie ».
Violences sourdes, donc, asphyxie de soi et du monde, non-dits qui pèsent sur l’enfant pianiste, l’amour maternel au point mort (Les Petits), amour paternel interdit, familles aux filiations brisées, empêchées, occupées, ennui et bêtises invisibles des adultes, l’enfant qui regarde par la fenêtre comme un ailleurs, moderato cantabile (La guerre). Ces petits ne sont pas des enfants au sens latin du terme, ceux "qui ne parlent pas". Les petits s’interrogent, creusent, se questionnent, tentent de percevoir, de sortir des conflits que les adultes, d’autres adolescents, le monde leur imposent.
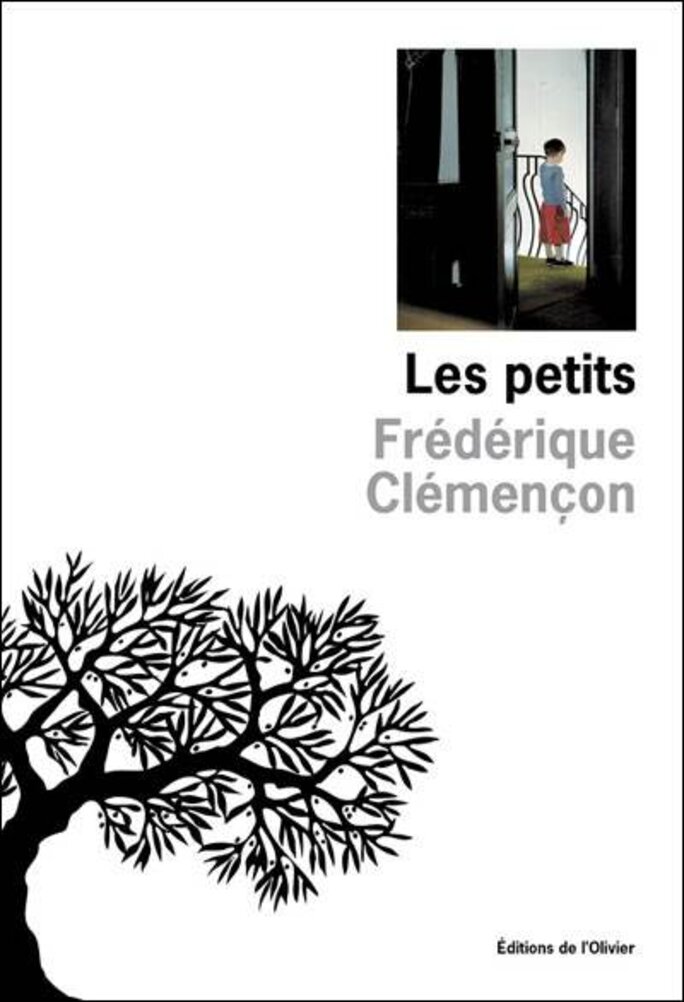
Petits parce qu’ils ne sont pas libres, autonomes, parce qu’ils sont, pour une part, des objets, miroirs de la réussite ou de l’échec de leurs parents. Clémence, la bien-nommée, qui permet à ses parents de mesurer qu’ils échappent aux cris, désordres, cet « enfer domestique » chez leurs amis, « une fillette qui n’avait rien changé à leur vie », « ses parents l’aimaient pourvu qu’elle ne les dérangeât pas et les flattât en société par un comportement discret et des manières délicates qui soulignaient l’éducation sans faille qui avait été la leur » (Les Pianistes). Clémence ne se révolte pas. Mais « elle avait souvent pensé que, lorsqu’elle serait en âge d’avoir à son tour des enfants, elle n’en aurait pas ». Adèle du Rêve de Lazare : « Si tu veux tout savoir, ma mère dit même que je suis née pour emmerder le monde.
Elle avait répété ces mots, appuyant sur chaque syllabe avec gourmandise : Em-mer-der-le-mon-de ! Em-mer-der-le-mon-de ! Tu te rends compte ? Et tu sais quoi ? Je m’en fiche. Ma mère, elle, c’est pas le monde qu’elle emmerde, c’est moi. Juste moi.
[…] Une mère comme la mienne […], ça empêche de rêver.
[…] Voilà : ma mère, en fait, elle attrape mes rêves avec une corde et elle les étrangle. Couic. Tu comprends ?».
Petits, comme dans le dernier récit qui implose l’univers de l’enfance des sept premières nouvelles, tout en faisant retour à l’épigraphe (Jules Renard), parce que l’enfer bourgeois, les intérêts et petits arrangements universitaires excluent Marie, la renvoient à sa différence, celle de ceux « qui n’appartiennent pas à votre petit monde », Marie qui « avait cessé d’être des leurs ». Refus du leurre, du « parfait. Tout était parfait ». Violences sourdes, insensibles, violence insoutenable (Deux tu l’auras), violences familiales, sociales, Frédérique Clémençon diffracte, explore ces territoires, impose sa voix, l’une des plus fortes, rares, singulières de la littérature contemporaine.
Frédérique Clémençon, Les Petits, Éditions de l’Olivier, 201 p., 18 €.



