Le Remplaçant est l’histoire d’un nom ou d’un non, d’ailleurs. Boris JAMPOLSKI. Ce patronyme apparaît en lettres capitales à la page 56 du roman d’Agnès Desarthe. Un nom s’impose, apparaît, en lieu et place de celui prévu, Janusz Korczak qui dirigea l’orphelinat du ghetto de Varsovie. Qui est ce Boris Jampolski ? un personnage particulier, porteur d’une histoire décalée : « Mais peut-être ferais-je mieux de commencer par expliquer que mon grand-père n’est pas mon grand-père. Le sang ne nous lie pas ». Une filiation « détournée ». « J’aimais l’idée d’être sa petite fille, alors que ma mère n’était pas sa fille, comme s’il avait été permis de sauter une case ».
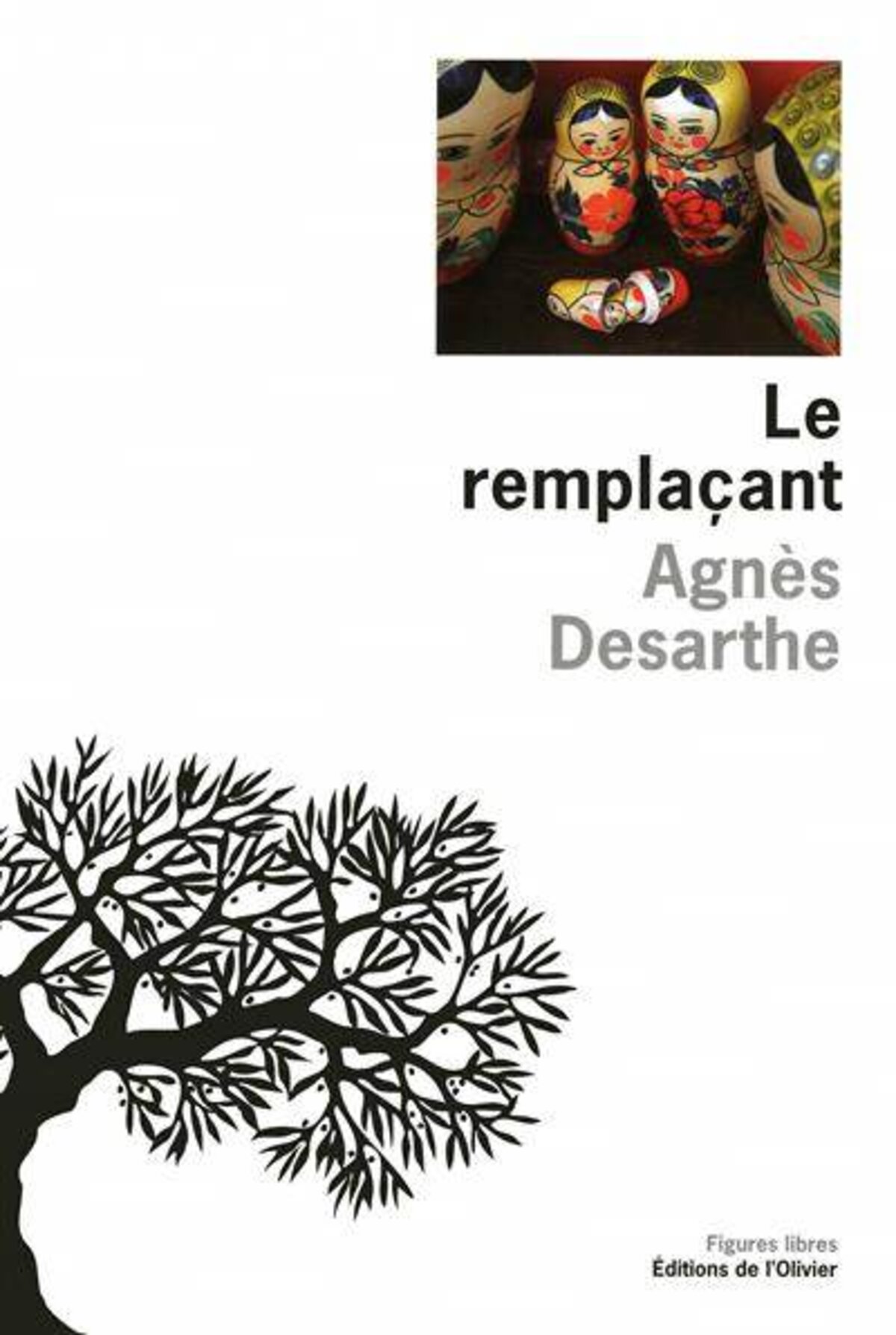
Le sang ne lie pas, il donne à lire. Un « mille-feuille onomastique » d’abord. Boris s’appelle aussi Bouz (ou Bouse), Baruch. « B.B.B. » ou « triple B ». Son nom est un enchantement et une énigme, un jeu également. Le patronyme est une « piste » pour comprendre le personnage, écrit Agnès Desarthe avant d’en jouer : « JAMPOLSKI. Quand j’étais enfant, j’entendais Jean-Paul skie ». Plus sérieusement, c’est un nom toponymique, polonais, dont le sens est à lire dans les romans d’Isaac Bashevis Singer. Ou dans ceux d’Agnès Desarthe qui lui dédia, en 1996, Un secret sans importance.
Ce secret a une importance. Un grand-père qui n’est pas le grand-père biologique (disparu à Auschwitz), qui est « le remplaçant ». Doublement.
D’abord parce que la grand-mère d’Agnès Desarthe refit sa vie avec lui : « Triple B avait le bon goût de ne pas être à la hauteur du disparu ; ni aussi beau, ni aussi intelligent, ni aussi poétique que le mort qu’il remplaçait. On avait perdu au change, et c’était parfait ainsi, moins culpabilisant. La médiocrité du nouveau permettait d’honorer convenablement la mémoire de l’ancien ». C’est contre cette image familiale officielle qu’écrit Agnès Desarthe : elle déroule son « épopée rocambolesque », son rapport aux mots, à leur prononciation même, le grand-père parlant « un français qui avait inventé l’hyperlatif ». Boris est un conteur, il appartient à cette aristocratie intellectuelle, rare, composée de ceux qui inventent leur vie, la brodent, la magnifient. Il n’est pas un « homme sans qualités ». Là est la transmission, pas celle des « comptes », que refusent le grand-père comme sa petite-fille, celle du conte. Celle de l’invention :
« Je voudrais qu’il existe un livre sur mon grand-père dans lequel tous les renseignements seraient consignés. Je pourrais lire ce livre, j’adorerais le lire, mais c’est idiot car c’est moi qui dois l’écrire.
N’importe qui à ma place procèderait rationnellement en menant une enquête. Il suffirait d’interroger ma mère, mais je m’y refuse. Je préfère inventer ».
Remplaçant, Boris l’est aussi parce que ce livre – une commande de l’éditeur, Olivier Cohen, pour cette collection « Figures libres », consacrée à des vies exemplaires* – aurait dû être centré sur Janusz Korczak, que la figure de ce grand-père s’est imposée à l’écrivain :
« Le problème, avec les livres, c’est qu’ils n’obéissent pas à leur auteur. On choisit un héros et voilà qu’un personnage secondaire brigue le premier plan, on construit une histoire mais une demi-page d’écriture s’empresse de la déconstruire. […] Ce livre, celui que j’étais en train d’écrire, était censé être un portrait du pédagogue polonais, mais dès les premières pages, le lapsus a œuvré. J’ai su très rapidement qui allait prendre la place de Korczak dans ce récit, se superposer au personnage d’origine, profiter d’une vague ressemblance et de coïncidences historiques pour s’immiscer dans le projet, le faire dévier, le détourner irrémédiablement ».
Croit-elle. Car le livre dévie, encore, en une construction labile, bouleversante, trouvant dans la fiction la vérité de l’Histoire, de ses morts, de ses fantômes. Le récit devient résistance, survie, échappée à l’horreur absolue des temps. Un de ces « chants d’un monde massacré ». Une béance qui peut tout dire, tout contenir, comme cette recette de cuisine disparue d’un livre, une des clés de la signification du roman, moment de poésie, de romanesque plein, de mise en abyme.
Le Remplaçant est un récit construit comme une matriochka – un des objets saugrenus et poétiques qui décorent l’appartement des grands-parents –, une poupée gigogne, un récit qui toujours échappe, se défile pour mieux se tisser. Plein dans ses ellipses. « J’écris toujours l’histoire d’à côté, jamais celle que j’avais prévue », confesse Agnès Desarthe, en un roman qui se mire, commente sa genèse, son écriture, sa composition. Un récit des origines et des filiations.

Le roman d’Agnès Desarthe n’est pas une biographie (ou alors double, voire triple, en écho, liée à des lieux, des photographies, des dates), ce n’est pas une autobiographie, même si le récit a des accents très personnels, même s’il est aussi, surtout, un portrait d’écrivain(s). C’est un hymne au conte, à la « réinvention » comme manière de cerner une vérité, de dire son essence terrible, sans la déplier tout à fait, sans la toucher. Le Remplaçant est un conte, « opaque », comme le nom du grand-père, fantaisiste, sensible, d’une ironie fondamentale, spéculaire, interrogative, douce-amère. « Tout ce que j’ai retenu m’a été enseigné par les romans, le théâtre ou la poésie », écrit Agnès Desarthe. Le Remplaçant mérite d’être retenu.
CMAgnès Desarthe, Le Remplaçant, Editions de l’Olivier, « Figures libres », 86 p., 12 € 50
* « Je voulais écrire sur un homme exemplaire, et voilà que je m’attache à un exemplaire d’homme ».



