Au programme de décembre sur les rayons du Bookclub, des correspondances, motifs et lettres, des couleurs. Giono, Pastoureau, Virginia Woolf. De quoi lire et même apprendre à Manifester à Paris.
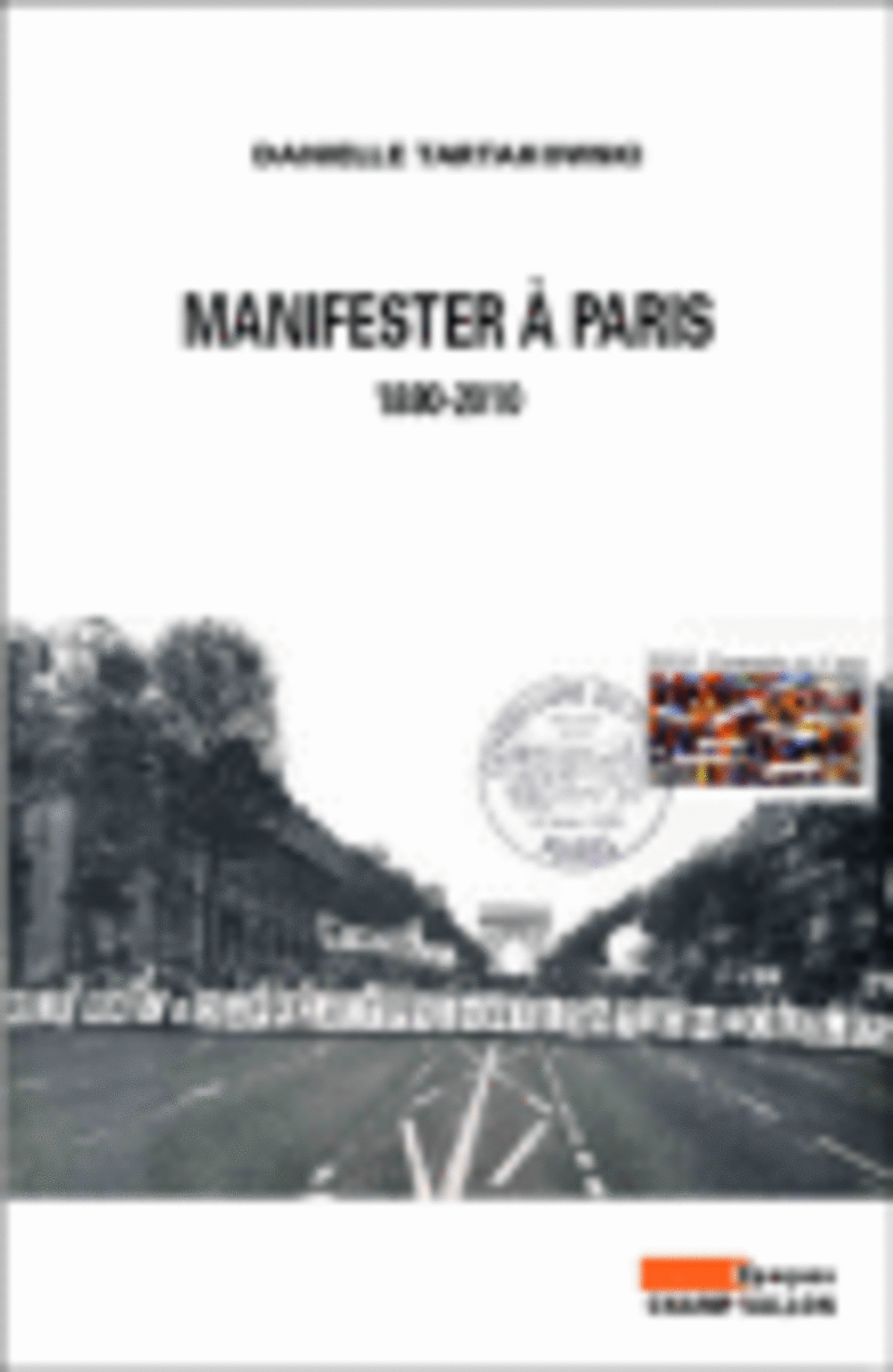
La rue parisienne «berceau des révolutions», «figure métonymique de Paris ou de son Peuple», sujet de romans, de tableaux : Manifester à Paris interroge le mythe et l’histoire, de l’avènement de la République, dans les années 1880, à aujourd’hui (2010). La rue n’est pas un simple lieu mais un «espace» de sens, un «espace-récit» et -réflexion. L’ouvrage découpe des plages de temps comme autant de mutations : 1880-1920, moment de l’appropriation, par la rue, du Paris d’Haussmann, avec l’émergence de lieux emblématiques (la Bastille, République, Nation). Puis, de 1912 à 1935, le périmètre des manifestations s’élargit, «au-delà des barrières» de Paris, vers des territoires jusque-là non arpentés. 1936 à 1968 sont des décennies de «réécritures», avec le Front populaire et les organisations ouvrières, même si 66-68 brouillent les espaces, avec la Commune étudiante. Enfin des années 70 à aujourd’hui, Paris devient «ville événement». Paris ne serait-il Paris «qu’arrachant ses pavés», comme l’écrivait Aragon ?
Ce livre passionnant retrace les grandes heures manifestantes de la capitale, les remet en contexte, analyse leur lien avec une mutation de l’espace urbain comme politique, et déconstruit quelques mythes et idées reçues. CM Danielle Tartakowsky, Manifester à Paris (1880-2010), Champ Vallon, « Époques », 304 p., 25 € Rêvons en couleurs
Michel Pastoureau est sans conteste le grand spécialiste français des couleurs telles qu’elles expriment et animent la vie des collectivités. Il a véritablement créé cette discipline qu’est l’histoire sociale des couleurs et l’on se souviendra de ses beaux volumes sur le bleu ou sur les rayures.
Dans Les Couleurs de nos souvenirs, il rassemble tous les petits épisodes colorés qui ont marqué son existence non pas de savant mais d’homme ordinaire qui a eu dès l’enfance l’attention attirée par l’utilisation que l’on faisait des «teintes» et des goûts ou dégoûts qu’elles manifestaient. Partant de ses souvenirs, il développe tel ou tel motif et revient à l’érudition qu’il a accumulée, ouvrant généreusement ses fichiers. Cela donne un ouvrage vagabond, plein de charmantes digressions, écrit d’une plume alerte et toujours soucieuse de transmettre quelque connaissance inédite. JD
Michel Pastoureau, La Couleur de nos souvenirs, Paris, Seuil, « La librairie du XXIe siècle », 2010. 18 €.
Correspondance de Vita et Virginia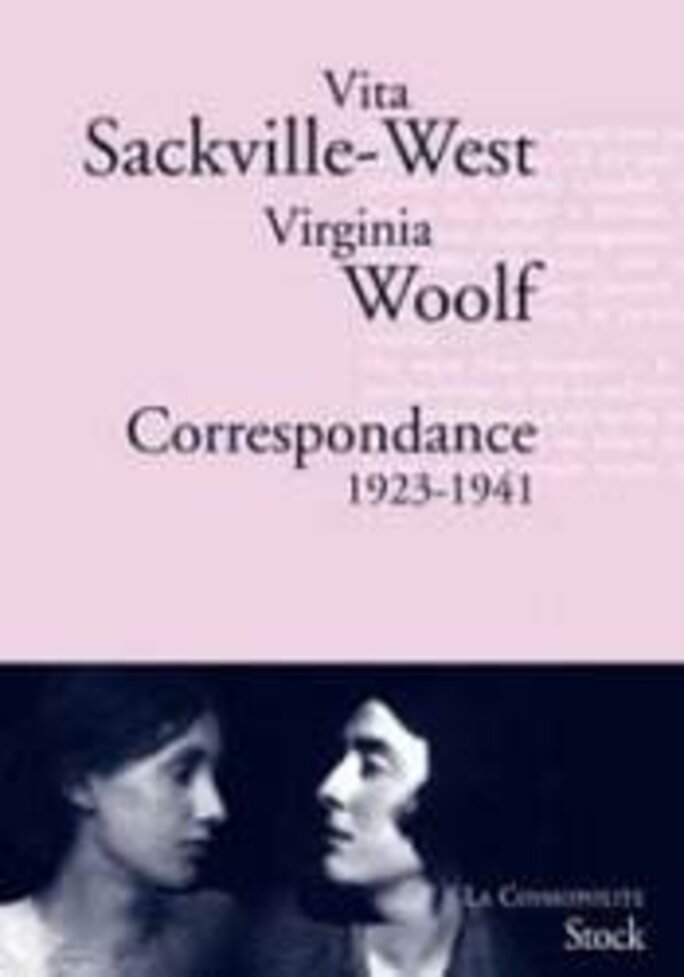
Virginia Woolf rencontre Vita Sackville-West, à laquelle elle dédiera Orlando, dans un dîner à Londres en décembre 1922. Leur correspondance se poursuivra durant 18 ans, amicale d’abord puis, dès la fin 1925, intime, passionnée, emportée, jalouse, à l’image de leur liaison.
«Ma Virginia chérie,
J'ai le sentiment que j'aimerais t'écrire une longue lettre. Une lettre sans fin. Des pages et des pages. Mais il y a trop à dire. Trop d'émotions, (…) et trop de surexcitation. Et, sincèrement, tout se réduit à cette vérité parfaitement simple que je voudrais que tu sois là».
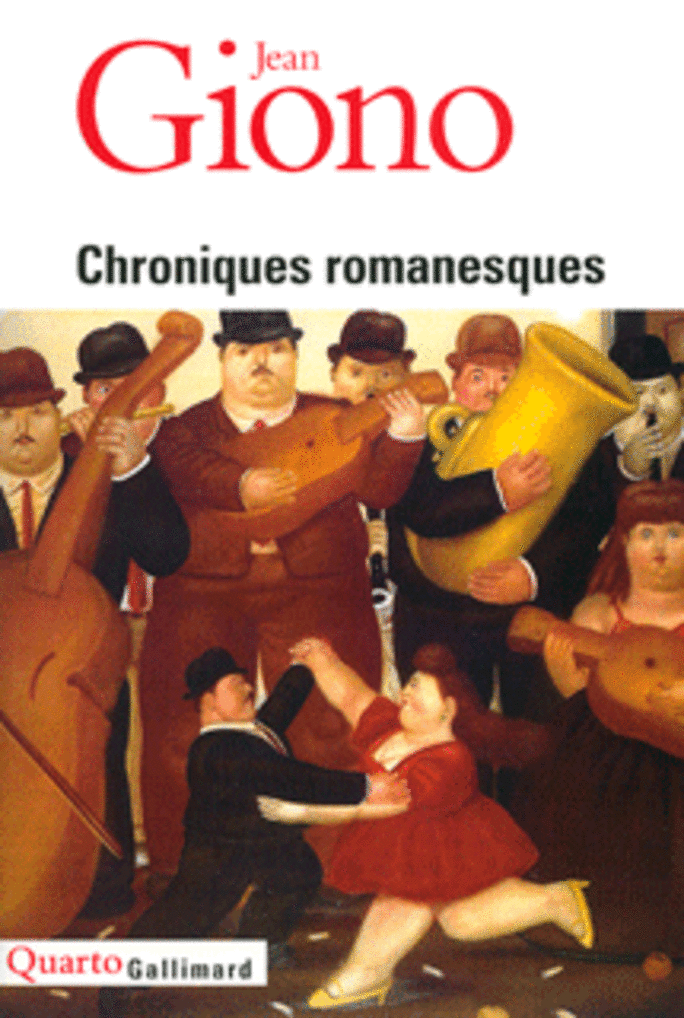
La collection Quarto de Gallimard publie en un gros et beau volume les Chroniques romanesques de Jean Giono. Elles sont reprises des Œuvres romanesques complètes publiées en six tomes en Pléiade avec des notes allégées.
De quoi s’agit-il ? D’un regroupement des romans que l’écrivain, alors qu’il avait quelques ennuis, a écrits au lendemain de la guerre 40-45. Conçus d’une écriture rapide, ces récits sont fortement situés dans le temps (soit au XIXe soit au XXe siècle) comme dans l’espace. Ils sont huit mais l’on retiendra tout spécialement Un roi sans divertissement, ce chef-d’œuvre, et Les Âmes fortes. Mais Noé, qui est le roman du romancier et de son œuvre en train de s’écrire vaut aussi le détour. Cette édition est présentée par Mireille Sacotte de façon particulièrement vivante. Ainsi de la préface, des notices et d’une « Vie et œuvre » riche et particulièrement enlevée. JD Jean Giono, Chroniques romanesques, Quarto Gallimard, 2010. 33 €. Jacques Dubois & Christine Marcandier-Bry


