Paris-Brest de Tanguy Viel est un itinéraire, celui du narrateur, retournant passer dix jours dans le Finistère Nord, après avoir quitté Brest pour Paris, trois ans plus tôt. C’est aussi le fameux gâteau, qu’il tient à la main en entrant dans la maison que ses parents ont achetée, face à l’océan. Paris-Brest se donne lui-même comme un roman familial. Même si « tout le monde s’en fout des histoires de famille » – sauf la mère du narrateur qui tombe sur les 175 pages pourtant soigneusement cachées dans un secrétaire fermé à clé.
Ecrire un roman "familial à la française à l’anglaise" donne un résultat très post-Duras, « plus post-Echenozien que jamais », comme l’écrit Sylvain Bourmeau, un roman unique, pourtant fait de romans, de constructions de langage par peur de trop en dire, d’appartements et de maisons qui ont une histoire, de parenthèses qu’il faudrait refermer, de cimetières qui sont « comme les rayons d’une bibliothèque » et de mots qui éclatent à force de ne pas vouloir faire d’histoires. Et « tout se tient là, sous mon crâne, comme les parois d’une bibliothèque qu’on aurait renversée ». Alors il faut dire ou ne rien dire, la frontière est si mince, comme lorsque le narrateur est assis au chevet de sa grand-mère :
« Je me souviens d’avoir dit des phrases enchevêtrées, comme une toile invisible que j’aurais tissée sur son lit, elle immobile toujours, seulement prise au milieu des quelques mots qui revenaient sans cesse dans ma bouche (…) et déversés en boucle sur elle. (…) Mais bien sûr je n’ai rien dit, je me souviens que je n’ai rien dit ».
Paris-Brest est un « famille je vous hais-me ». Impertinent, intense, corrosif, fortement iodé, cynique, empreint d’une atrocité sous des dehors feutrés qui n’a d’égale que sa poésie, la poésie de Brest, ville adorée, haïe, objet de rejet comme de fascination, la poésie de la mer, du vent.
Le narrateur passe en revue tous ses manques, ses ratés : sa carrière de footballeur avortée avant même d’avoir commencé – son frère, lui, est footballeur professionnel –, son autonomie impossible que ce soit vis-à-vis de sa mère ou du fils Kermeur, double négatif, ombre permanente, mauvaise conscience. Il montre surtout qu’on ne peut se défaire de ce qui nous construit, en bien comme en mal : la gifle de la mère « l’empreinte de sa main sur ma joue », « toutes ces choses sont en partie écrites sur ma joue, sur la marque de sa main sur ma joue », ces souvenirs de chute dans un bassin glacé ou de vol dans un supermarché, ces hontes, vécues, subies, à l’image de la condamnation du père pour malversations financières quand il était vice-président du club brestois. Tout reste, tout se rejoue même, parfois. Que l’exil soit volontaire ou non, celui des parents dans le Languedoc-Roussillon, celui du fils à Paris, on est forcé de revenir, partir n’efface rien, les injures fusent des années après quand le père traverse Brest à découvert, et tout porte trace, comme la chambre d’hôpital de la grand-mère, « sur les murs et la fenêtre assombrie par trop de paroles qui grimpaient comme du lierre sur les vitres ».
Tout est en somme à l’image de Brest, cette ville qu’il est impossible de réinventer, comme l’écrit Viel dès l’incipit, somptueux, de son roman :
« Il paraît, après la guerre, tandis que Brest était en ruines, qu'un architecte audacieux proposa, tant qu'à reconstruire, que tous les habitants puissent voir la mer : on aurait construit la ville en hémicycle, augmenté la hauteur des immeubles, avancé la ville au rebord de ses plages. En quelque sorte on aurait tout réinventé. On aurait tout réinventé, oui, s'il n'y avait pas eu quelques riches grincheux voulant récupérer leur bien, ou non pas leur bien puisque la ville était de cendres, mais l'emplacement de leur bien. Alors à Brest, comme à Lorient, comme à Saint-Nazaire, on n'a rien réinventé du tout, seulement empilé des pierres sur des ruines enfouies. »
Réinventer. Sans doute est-ce là le mot clé de ce roman. On ne peut échapper à l’écriture de son histoire familiale, on peut certes décaler les évènements, changer des noms, faire mourir sa grand-mère et l’enterrer alors qu’elle est bien vivante — pour ouvrir et fermer le roman familial à écrire sur son enterrement —, forcer un peu les traits, « compte tenu aussi que c’était un roman », mais on ne change rien totalement. Sinon la forme, sinon les codes du genre.
Ce que démontre magistralement Tanguy Viel dans ce court roman, intense, irrévérencieux, en (se) jouant de main de maître de la technique pourtant éculée de la mise en abyme : à la manière du Paris-Brest, gâteau fourré, Tanguy Viel écrit un roman familial autour du roman familial de son narrateur et se joue de cette structure. Quand le narrateur rend visite à Noël à ses parents, les 175 pages de son manuscrit dans sa valise, il pense : « c’est comme les poupées russes, maintenant dans la maison familiale, il y a l’histoire de la maison familiale ». Deux perspectives narratives, celle de l’auteur, celle du narrateur, se croisent, se mêlent, se mettent en perspective autour de quelques secrets. Percer le mystère savamment entretenu par la mère qui toujours voudrait que rien ne se sache, dévoiler les secrets de famille les plus honteux, les millions de la grand-mère, ceux du père :
« Il faut dire, il y eut une concomitance troublante entre les ennuis de mon père et la fortune de ma grand-mère, disons, entre les dix-huit millions positifs de ma grand-mère et les quatorze millions négatifs de mon père. On aurait dit comme des vases communicants. Là-dessus je n’ai jamais réussi à débrouiller l’écheveau, tout ça est resté très flou et très indistinct mais je suis sûr qu’il y a des relations inconscientes, bien sûr inconscientes, entre le devenir pauvre de mes parents et le devenir riche de la grand-mère ».
Et, grâce au croisement des perspectives, dire, aussi, la vérité enfouie de ce narrateur, malgré ses propres constructions de langage, sa manière d’écrire l’histoire, de la réinventer, sans doute.
Le style de Tanguy Viel est celui des vagues, toujours recommencées : il avance par reprises, réitérations, il est heurté et pourtant fluide, à l’image d’un roman qui progresse par saccades, comme un fil qui sans cesse échappe, chaque reprise ajoutant un adjectif, un adverbe, une nuance, une maille au filet, et paradoxalement un silence sur le secret, perceptible mais ineffable, comme enfoui, exprimé (pas au sens de dire mais d’extraire, de tirer le suc – la lie ici – d’une chose). Plus que de reprises, on devrait parler d’allers et retours, comme l’indique le titre Paris-Brest, lacunaire malgré sa beauté et ses sens explicites, puisque le roman, dans sa structure, est un Brest-Paris-Brest. Ces répétitions créent une attente, un suspens, mais elles creusent aussi une inquiétude, un malaise.
Dans ce roman, tout est affaire de silences, de mots qu’il faudrait prononcer, dire et qu’on s’interdit d’articuler, d’autres que l’on répète comme des litanies pour masquer des failles, des gouffres. Il s’agit de « composer », en somme, terme que Viel emploie page 29 et qui dit tout. Composer avec ce que la vie impose, composer avec ses hontes et ses manques, composer comme on brode pour masquer la vérité : la mère qui aurait voulu « raconter une autre version de cette histoire, une version sans Albert sans doute, une version sans moi sans doute, mais surtout, je crois une version sans les Kermeur », composer comme on écrit – nécessairement – le roman de sa famille.
Paris-Brest, donc. « En rade » aurait aussi fait un excellent titre si Huysmans n’en avait déjà donné une version. En rade, comme les espoirs de départ du narrateur, comme l’appartement de la grand-mère avec vue sur la rade de Brest, comme elle le dit si souvent, la bouche pleine de cette phrase, qui dit aussi sa fortune bizarrement acquise, cet argent qui plombe tous les rapports de famille :
« Cent-soixante-mètres carrés avec vue sur la rade, répétait-elle comme si c’était un seul mot, une seule expression qu’elle avait prononcée des milliers de fois, laissant glisser dessous toutes les images qui allaient avec, c’est-à-dire la mer bleue de la rade, les lunatiques teintes de l’eau, les silencieuses marées d’août, les reflets de la roche et les heures grises de l’hiver ».
Règlement de comptes de Noël, d’une veille de Noël en famille, « ce 20 décembre » 2000, véritable anaphore de plusieurs chapitres, dans une atmosphère lourde de non dits, de malaises. Tout sauf un conte de Noël, Tanguy Viel excellant dans la peinture des petitesses de la bourgeoisie, de ses hypocrisies, de ses atrocités. Dans le rendu de son étroitesse aussi, ses carcans, son renfermé, malgré l’air du large, comme l’illustre la spasmophilie de la mère, les sacs en plastique qu’elle se met sur la tête pour respirer, ou comme le souligne ironiquement le nom du restaurant pour vieux amiraux et amateurs de bridge que fréquentent la grand-mère puis la mère du narrateur : « le cercle marin ». Vicieux, vicié, ce cercle…
Les personnages de ce roman sont tous liés, ils s’observent, se jaugent, se menacent, passent des contrats tacites ou notariés, ils s’enferment, se volent jusqu’au moment où la vérité éclate, mais cela changera-t-il quelque chose ? il suffit parfois, sans doute, d’un geste, en apparence anodin, profondément bouleversant, comme le montre la dernière page du roman.
Paris-Brest est un roman magistral sur le décalage entre rêves et réalité, volonté de partir et retours, sur la difficulté de se « réinventer », sur les failles de nos histoires de famille, confirmant, si besoin était, à quel point ce jeune écrivain, Tanguy Viel, né en 1973, construit peu à peu une œuvre qui compte. Ou, comme il l’écrit lui-même, dans son ironie irrésistible : « Techniquement tout était clair. Psychologiquement non. Psychologiquement rien n'est jamais clair mais techniquement si. » Tout est dit.
Tanguy Viel, Paris-Brest, Editions de Minuit, 190 p., 14 €
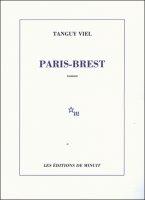
A noter, la parution en poche, dans la collection « Double » des Editions de Minuit de Insoupçonnable, critique Les Mains dans les Poches
Rencontres avec Tanguy Viel, à l'occasion de la parution de Paris-Brest :
. le mercredi 21 janvier à la librairie L'Arbre à lettres (2 rue Edouard Quenu, 75005 Paris),
. le mardi 3 février à la librairie Le Square (2 place Docteur Léon Martin, 38000 Grenoble),
. le samedi 7 février à la lilbrairie Les Cahiers de Colette (23-25 rue Rambuteau, 75004 Paris),
. le jeudi 12 février à la librairie Passages (11 rue de Brest, 69002 Lyon),
. le mardi 17 février à la librairie Compagnie (58 rue des Ecoles, 75005 Paris),
. le mercredi 18 février à la librairie Les Temps modernes, (57 rue de Recouvrance, 45000 Orléans),
. le mardi 3 mars à la librairie Sauramps (Le Triangle, 34000 Montpellier),
. le mercredi 4 mars à la librairie Ombres blanches (50 rue Gambetta, 31000 Toulouse).



