
«Un raz de marée arrive. Bientôt, j’en suis sûr, tout le monde mourra.»
En 2010, François Laplantine, anthropologue, publie un Tokyo, ville flottante au riche sous-titre Scène urbaine, mises en scène, pointant vers le pluriel d’une ville insaisissable, vers une tension du réel et de sa représentation. Et ce livre se veut en effet dans un entre-deux : ni essai spécialisé ni journal de voyage — quand bien même il repose sur un séjour au Japon en 2008-2009 — mais un «texte d’apprentissage ou plutôt de désapprentissage par rapport à un mode de connaissance européocentré».
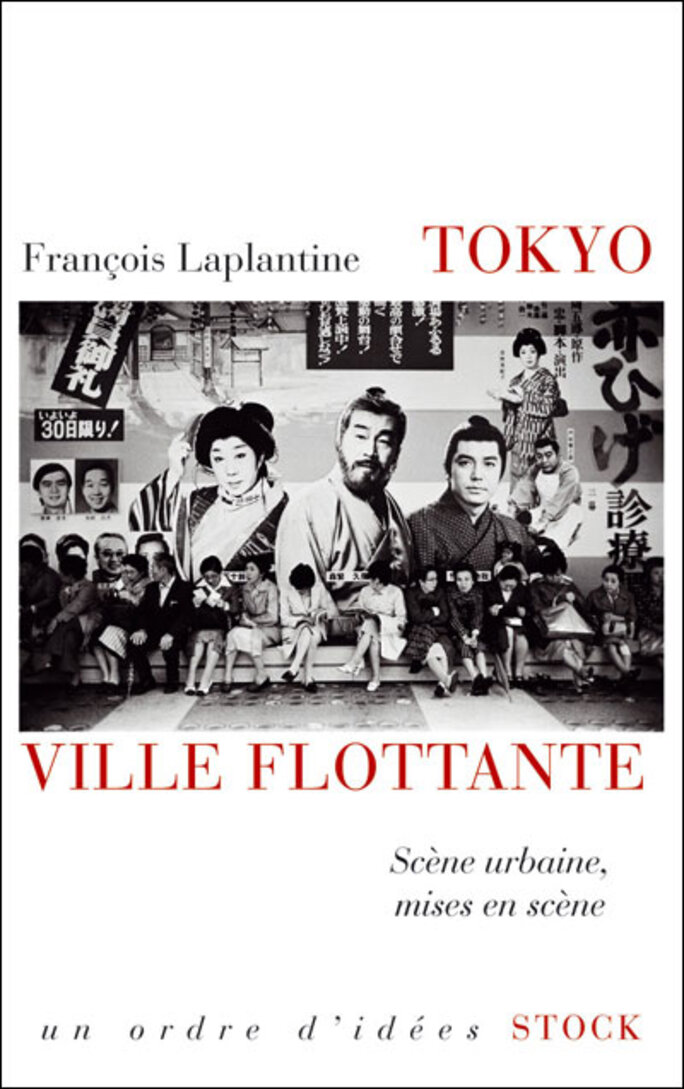
Agrandissement : Illustration 2
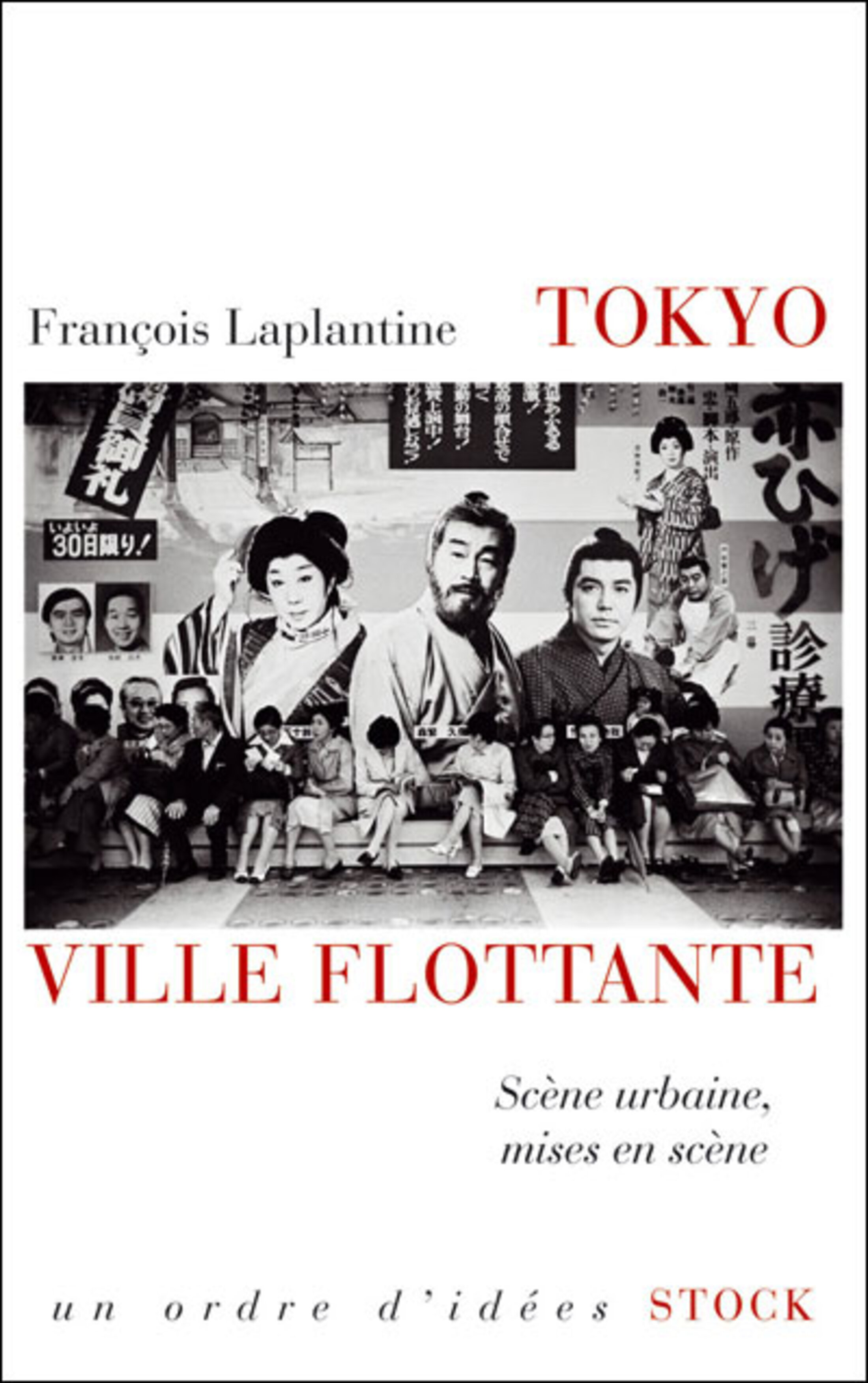
François Laplantine observe, extérieur à la scène urbaine, étranger dans une ville qui lui échappe, le fascine, et il tente de la saisir, à partir d’un «hors-champ de fiction» (cinéma, littérature) agissant comme un contrechamp. Tokyo ressemble à New York, Chicago, São Paulo et pourtant elle n’est comme aucune autre mégalopole, elle est «dans l’écart du comme, dans l’intervalle du presque».
Tokyo, ville flottante se construit sur des fragments d’un discours amoureux et tokyoïte, des observations, des détails, des réflexions culturelles, linguistiques. Le livre s’offre comme une découverte, mot fondamental, analysé dès le chapitre 2 : «dé-couvrir», «se défaire de ce qui avait été couvert», «laisser surgir», «se départir d’une double projection : l’exotisme convenu et le "Japon-repoussoir"», se départir des clichés et stéréotypes.
Le livre vaut dans son ensemble : fin, cultivé, passionnant. On le reprend aujourd’hui pour son chapitre Nature, péril et paysage. On relit l’une des épigraphes, empruntée à Aoyama :
«Un raz de marée arrive. Bientôt, j’en suis sûr, tout le monde mourra».

Une phrase prononcée face à la mer par une petite fille dans Eureka (2002), un film réalisé par Shinji Aoyama, réflexion sur la violence des hommes rapportée et comparée à celle de la nature.
Dans ce chapitre, François Laplantine analyse le lien — millénaire, culturel, quotidien — du Japon à l’eau : celle qui nourrit (le poisson), celle qui purifie (les bains), celle qui détruit (inondations, tsunamis). Le rapport du Japon au paysage est nourri du sublime en tant que catégorie esthétique : fascinant parce que terrifiant, mélange de menace et d’admiration, de peur et de grandeur.

Agrandissement : Illustration 4

Puis, on parcourt, de nouveau, le chapitre Vers une esthétique de la disparition : le mal du siècle d’une génération, la manière dont le cinéma comme la littérature le traduisent, le mettent en scène et cette apparition d’une figure, celle de «l’homme flottant, évoluant dans un milieu urbain lui-même fluctuant». Dans ce livre, qui part du décor urbain, en témoin extérieur et encore étranger à la ville et ses habitants pour plonger au cœur de sa culture, se dit alors l’envers du décor, une vision intime de la civilisation japonaise, dans sa hantise de la disparition.
Des pages qui prennent, aujourd’hui, une tonalité dramatique. Comme l’écrit François Laplantine, le Japon est sans aucun doute un des pays les plus propices «à l’imaginaire et à la projection de fantasmes», citant Michel Butor qui, lors de son premier voyage (1972) voyait dans «ce pays imaginaire, un miroir magique dans lequel on fait apparaître ce qu’on veut». Un pays, "terre des morts" comme le titre magnifiquement Libération aujourd'hui, qui nous invite à la réflexion et se donne comme un «miroir» en effet de nos peurs et nos engagements à venir.
François Laplantine, Tokyo, ville flottante, Scène urbaine, mises en scène, Stock, "Un ordre d'idées", 2010.
Et à lire ou relire La Centrale d'Elisabeth Filhol, POL, 2010 et cette question, lourde, noeud du roman, « Quel est le point de rupture ? »



