Sait-on que le 8 novembre, au Canada et ailleurs, on célèbre désormais l’anniversaire de naissance d’Herculine Barbin, figure emblématique de ceux qu’on a appelés longtemps les hermaphrodites et qui sont aujourd’hui les « intersexes » (quel mot !) ? Cette Herculine Barbin, prénommée Alexina par les siens, avant de devenir Camille, puis Abel, naquit à Saint-Jean d’Angély en 1838. Jeune enseignante sur l’île d’Oléron dans un couvent de formation de demoiselles, elle s’éprit de l’une de celles-ci, la rejoignant au lit chaque nuit en toute impunité. Se sut-elle fille et garçon à la fois, dotée qu’elle était d’un appareil génital double et inachevé ? Toujours est-il qu’elle finit, avec les « moyens du bord », par posséder physiquement son amie. À partir de quoi sa situation devint intenable en dépit de la protection candide dont les deux partenaires jouissaient en un milieu exclusivement féminin : elle se confia à des prêtres, fut examinée par des médecins qui finirent par la faire reconnaître comme homme. Abel ainsi civilement transformé quitta alors son aimée, s’exila à Paris, où, après un temps, il se suicida.
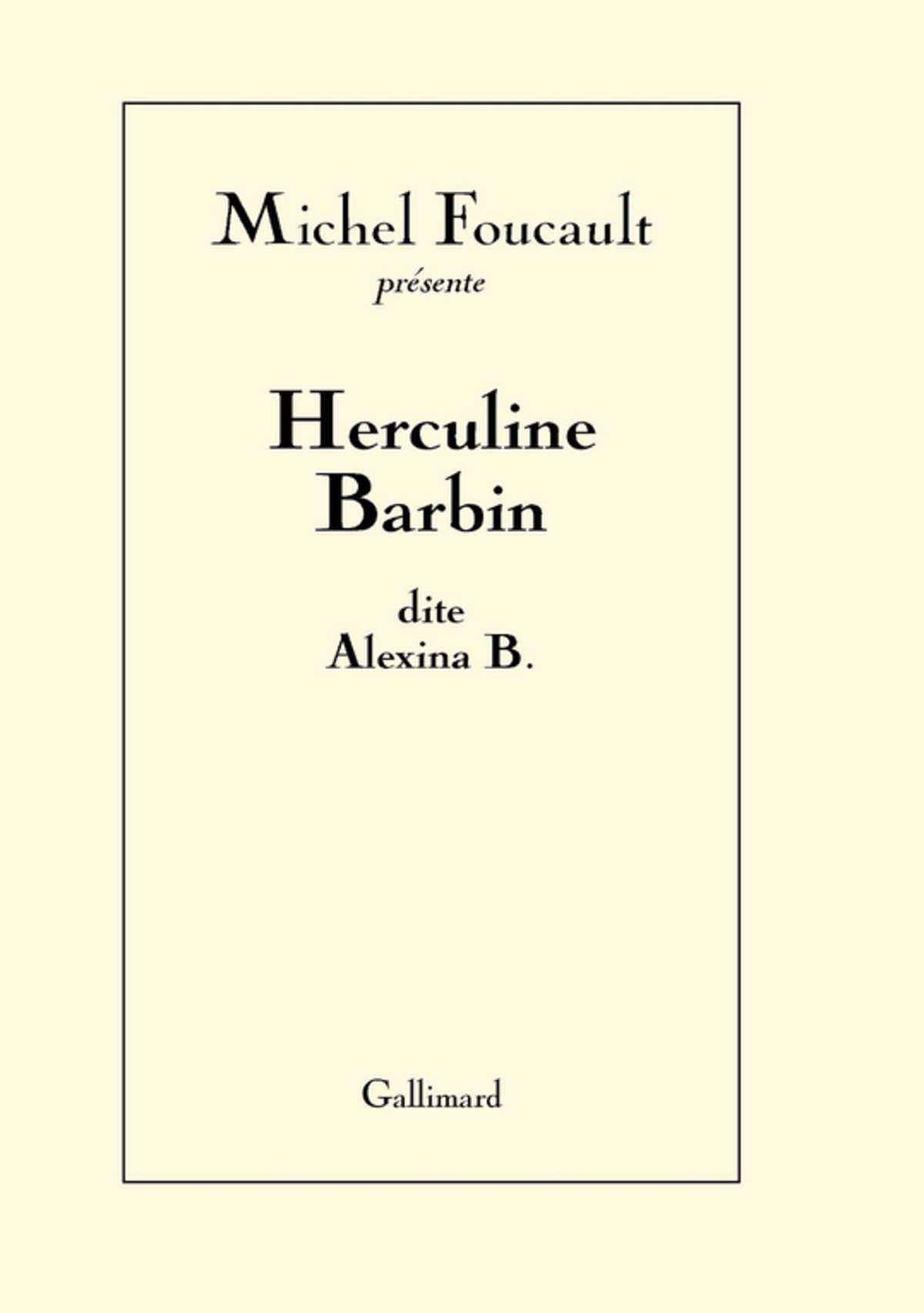
Agrandissement : Illustration 1
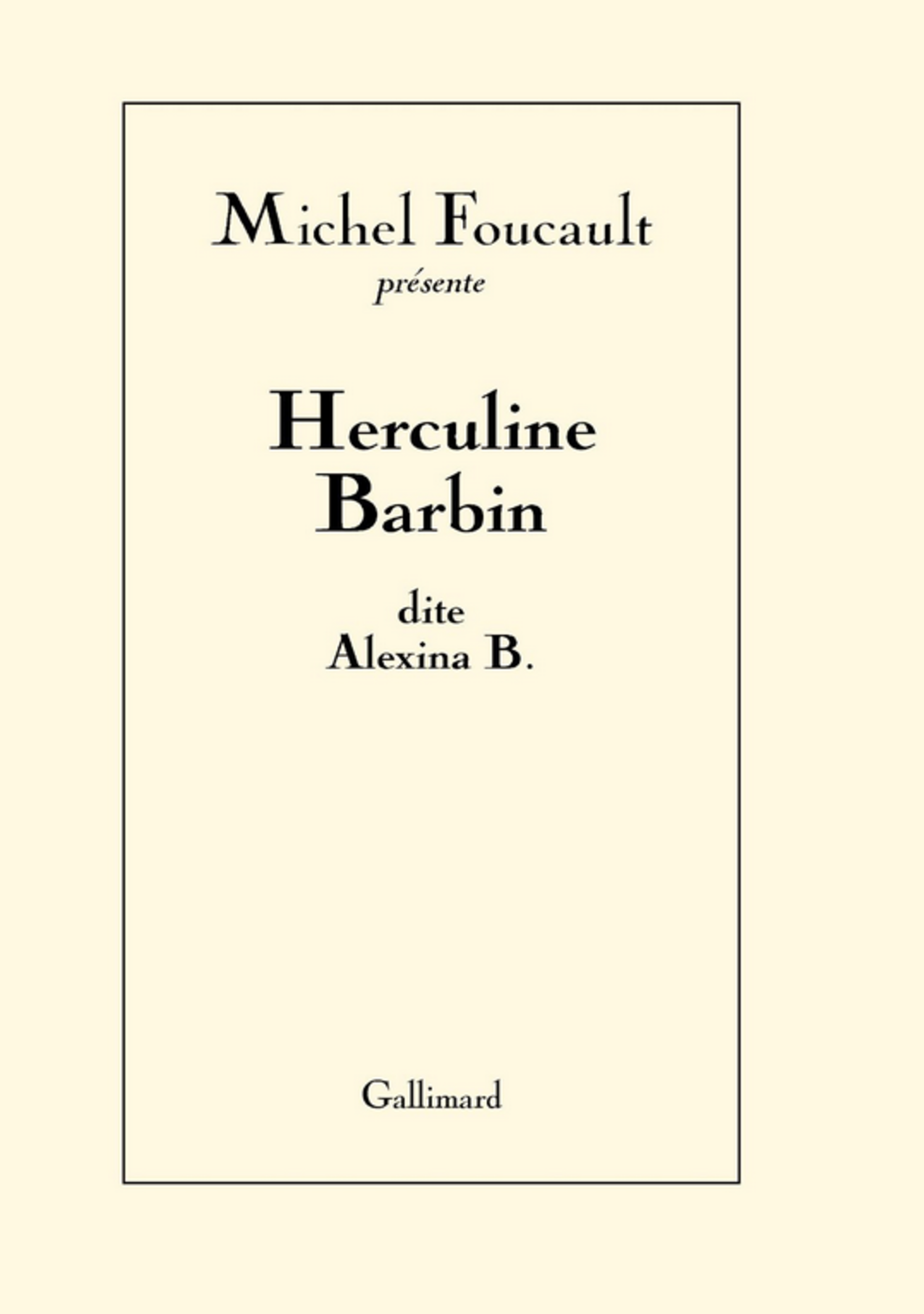
Herculine-Abel a laissé des Souvenirs aussi pathétiques que délicatement écrits. Édités autrefois par l’éminent docteur Tardieu, qui étudia le cas, ils sont redécouverts par Michel Foucault au XXe siècle et proposés par lui dans la collection « Les Vies parallèles » qu’il avait lancée au temps de son Histoire de la sexualité. Les voici repris avec une Préface destinée d’abord à l’édition américaine des Souvenirs, une Postface fouillée d’Eric Fassin et tout un dossier comprenant des attestations médicales et administratives mais aussi un roman inspiré par l’affaire, Scandale au couvent, de l’auteur allemand Oscar Panizza.
Cette réédition s’imposait et vient à son heure dans la mesure où elle apporte un riche document au vaste débat sur la question des « genres » qui est plus que jamais d’actualité – et pas que dans les universités américaines et, pour d’autres raisons, dans la droite dure en France. Dans sa Préface, on sent Foucault plus qu’ému par ce qu’il vient de découvrir. Lui qui tenait pour une consubstantialité de la sexualité et de la loi comme répression prend acte d’une expérience inédite à laquelle préside une naïveté d’avant la loi : les deux jeunes femmes s’aiment sans trop savoir ce qu’elles font et qui elles sont. « Le dur jeu de la vérité, que les médecins imposeront plus tard à l’anatomie incertaine d’Alexina, écrit Foucault, personne n’avait consenti à le jouer dans le milieu de femmes où elle avait vécu » (p. 15) ; et plus loin : « On a l’impression […] que tout se passait dans un monde d’élans, de plaisirs, de chagrins, de tiédeurs, de douceurs, d’amertume où l’identité des partenaires et surtout celle de l’énigmatique personnage autour duquel tout se nouait était sans importance. » (p. 16) Et le philosophe de laisser planer autour du récit un climat d’idylle d’avant la faute qui rend bien les intonations et perceptions du témoignage d’Alexina.
Dans sa Postface, Fassin rappelle de son côté que la philosophe américaine Judith Butler s’est, après Foucault, intéressée au cas d’Herculine Barbin. D’elle, on ne pouvait attendre moins : ne rencontrait-elle pas là un parfait exemple de ce « trouble dans le genre » dont elle a traité avec éclat ? Or, l’Américaine dit ne pouvoir suivre Foucault dans son vague romantisme d’un Éros d’avant la loi – cette loi dans laquelle les plaisirs du sexe s’ancrent dès l’origine. Mais, pour Éric Fassin, Foucault ne s’inscrit pas ici sur la plan de la théorie mais aperçoit dans les Souvenirs d’Herculine une tactique de contournement d'effets de pouvoir dont la jeune personne a une conscience au moins vague et auxquels elle résiste spontanément.
Occasion pour le postfacier de revenir à ce que le pouvoir de catégoriser le sexe a un caractère foncièrement politique – observation valant pour quiconque et non pour les seuls unisexes. Et Fassin d’enchaîner à la suite de la psychologue Suzanne Kessler ou encore de la biologiste Anne Fausto-Sterling : « le sexe est inséparablement une affaire de genre : sa vérité est inscrite moins dans une réalité biologique que dans une pratique médicale informée par des représentations sociales de la différence des sexes. » (p. 238) Ce qui conduit Fassin à risquer l’idée d’un archipel du genre en forme de continuum ou de dégradé pour faire pièce à l’habituel polarité binaire du sexuel.
Pour suivre, Eric Fassin se livre à une analyse extrêmement fine du texte d’Alexina, montrant par exemple que les enjeux du drame intime de celle-ci, drame alors largement mâtiné d’enchantement et de jouissance, se manifestent à même le langage et jusque dans les usages grammaticaux du féminin et du masculin. Ce qui est d’ailleurs révélateur de toute une situation paradoxale et de ce qu’elle a de perturbant. Car il y a bien dans la situation de quoi se perdre. Ainsi c’est l’homosocialité dans laquelle vivaien les deux amies qui leur a permis de connaître une intimité que le vrai sexe d’Alexina aurait dû leur interdire ; à l’inverse et non moins paradoxalement, c’est la différenciation sexuelle qui va finir par les séparer. « Car, écrit Fassin, le rapport hétérosexuel qui fait advenir “le vrai sexe” d’Abel l’écarte de sa maîtresse. » (p. 256)
Redisons-le, la réédition des Souvenirs d’Herculine Barbin vient à point nommé. Elle trouve toute sa place dans des débats où l’identité sexuelle est questionnée. De plus, le livre est à sa manière un petit chef-d’œuvre d’écriture dans le retour d’un sujet sur lui-même. Bref, un ouvrage à lire sans retard.
Michel Foucault présente Herculine Barbin dite Alexina B. Postface d’Éric Fassin. Paris, Gallimard, 2014. € : 19, 50.



