« J’ai ressenti ce qu’on appelle le vertige »
(Pauline Klein, Alice Kahn, Allia)
Chaque rentrée littéraire est un vertige. Quantitatif et arithmétique d’abord, 701 romans paraissent, comment tout lire, tout dire, un combat perdu d’avance ? Littéraire ensuite, vertige de la découverte, des emballements et leur versant déceptif, des attentes et retrouvailles (Echenoz, Houellebecq, Volodine, Bret Easton Ellis, Will Self, Gonçalo M. Tavares), les vertiges de la lecture, de la critique. Le vertige enfin, par les transports que tout roman induit, dans des espaces et des dimensions inconnues. La sensation de vivre dans un ailleurs. Celle du lecteur, amplifiée par le « vertige existentiel chronique » (Fanny Chiarello) de nombre de personnages rencontrés. Chaque rentrée littéraire est une course contre le temps, dans l’ivresse des pages et des marges, des échos.
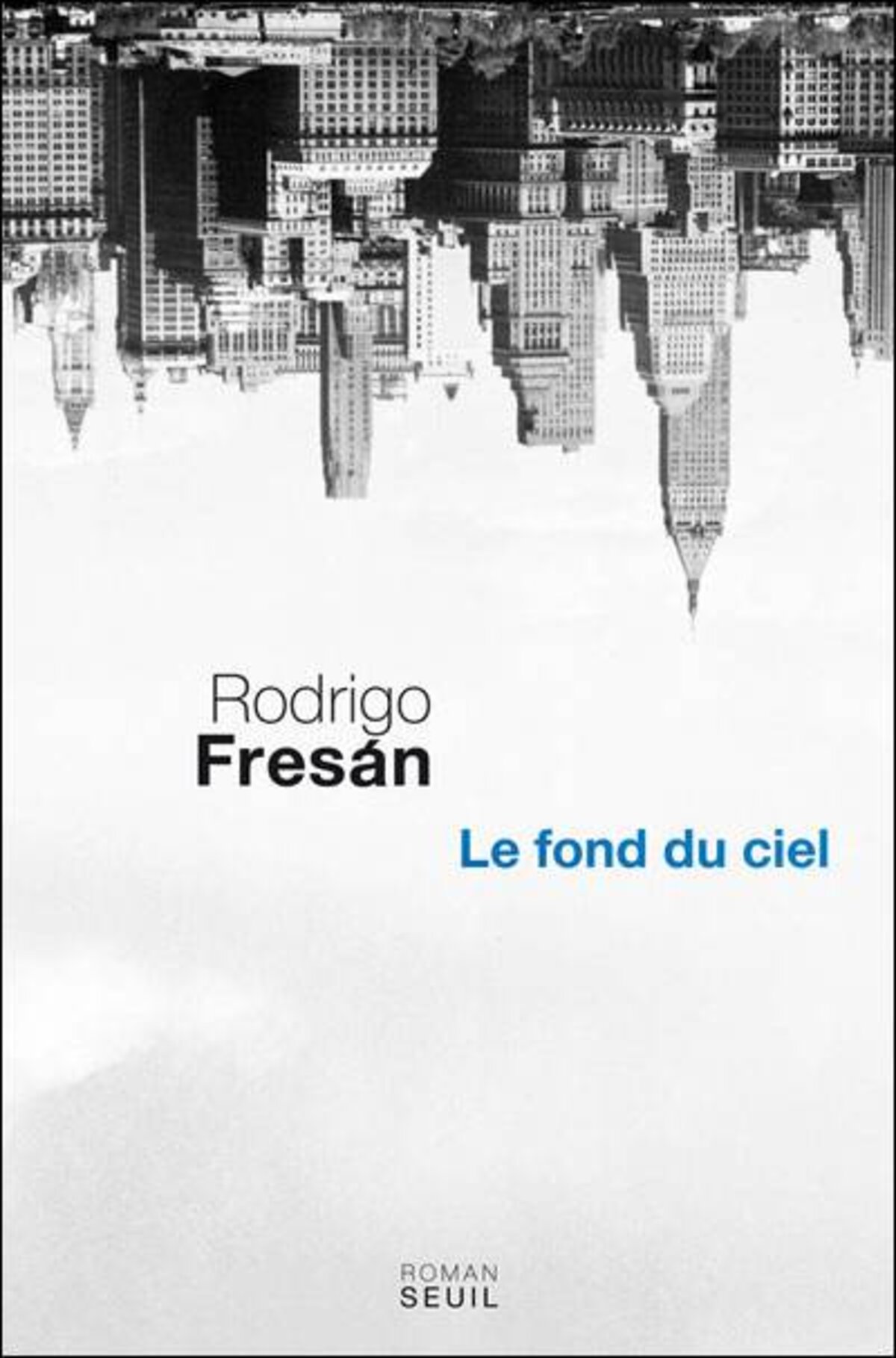
Agrandissement : Illustration 1
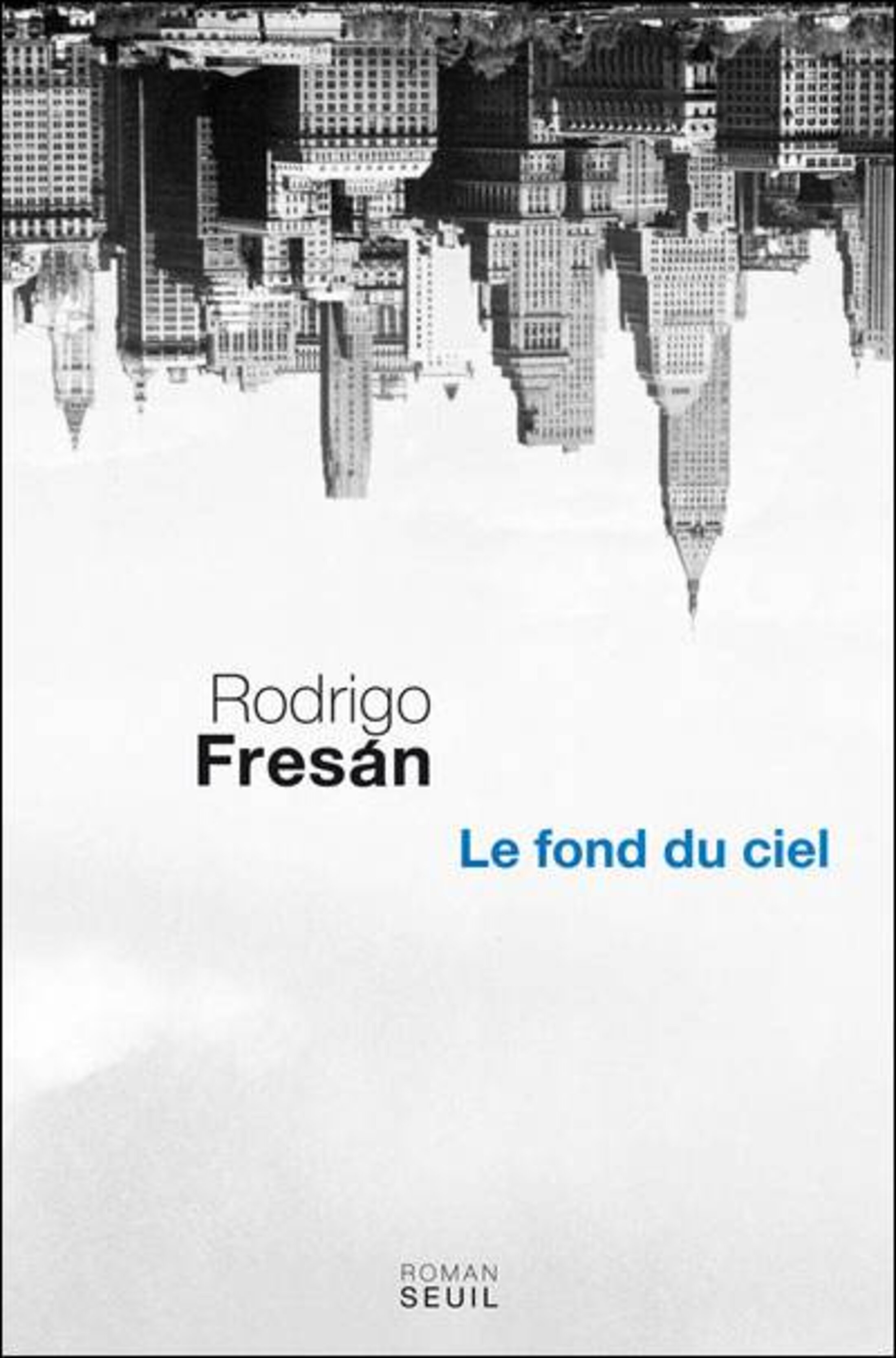
Etranges, ces correspondances que l’on construit peu à peu, ces univers élaborés de manière solitaire et parfois solipsiste par des écrivains face à leur page ou leur écran qui soudain, par la magie de la lecture, de la transmission, se télescopent, se rencontrent : air du temps, thèmes majeurs, actualité brûlante ou hors tout qui s’imposent, sans raison aucune, d’autant plus pertinente.
De roman en roman, la rentrée littéraire devient une chambre d’échos, un laboratoire du monde comme il va, des êtres comme ils sont ou se fantasment, de l’Histoire que la fiction interroge, d’une humanité qui prend sens.
Revue subjective, lacunaire, assumée, de ces Télescopages (Fabienne Yvert, Attila). En route vers cet Atlas des inconnus (Tania James, Stock). Carte et territoires.
Aux côtés des love stories décalées (Girl meets boy d’Ali Smith, L’Olivier ou Divines amours de Michael Bracewell, Phébus), une Histoire des cheveux par Alan Pauls (Christian Bourgois) qui résonne avec cette Fille aux cheveux étranges de David Foster Wallace (Au Diable Vauvert).
En cette rentrée, nous entrons d’abord dans des maisons. La Tête en arrière, à la suite de Violaine Schwartz (POL), un pavillon de banlieue, envahissant, angoissant, mortifère, avec ses pièces vides et impossibles à meubler, son jardin en friche, son silence. « Maison du bonheur », avaient-ils promis, cauchemar plutôt, ferment d’une paranoïa qui étouffe la narratrice plus sûrement que le lierre qui gagne ses murs. Pourtant la maison se voudrait locus amoenus, échappée du monde et des pandémies qui nous menacent : ainsi Socorro, au centre de L’Eternité n’est pas si longue de Fanny Chiarello, une maison imposante, un havre de paix entre amis, dont les murs pourtant ne sont pas étanches au chaos du monde.
En élargissant la perspective, nous embarquerons pour des villes intérieures, fantasmées, moins des géographies réelles qu’intimes : New York (L’Envers du monde de Thomas B. Reverdy et Norfolk de Fabrice Gabriel, tous les deux au Seuil), Chicago (Barry Gifford, Une éducation américaine, 13ème Note), Sao Paulo (Fils d’Heliopolis de James Scudamore, 10/18), Buenos Aires (Histoire de cheveux mais aussi Dernier train pour Buenos Aires, Hernán Ronsino chez Liana Levi).
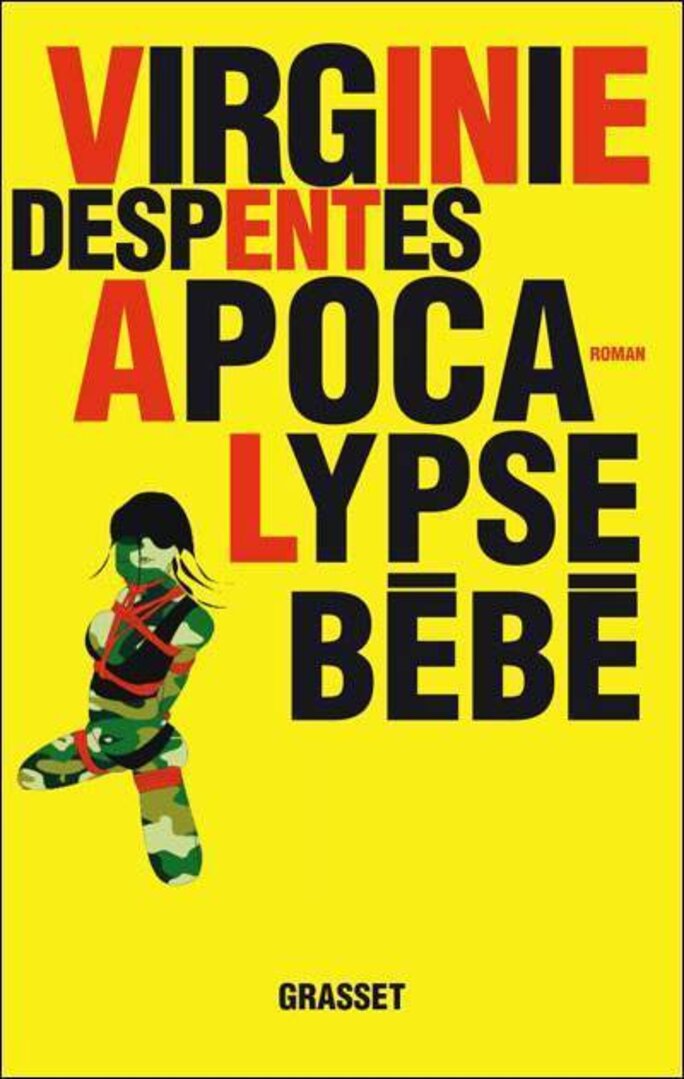
Agrandissement : Illustration 2
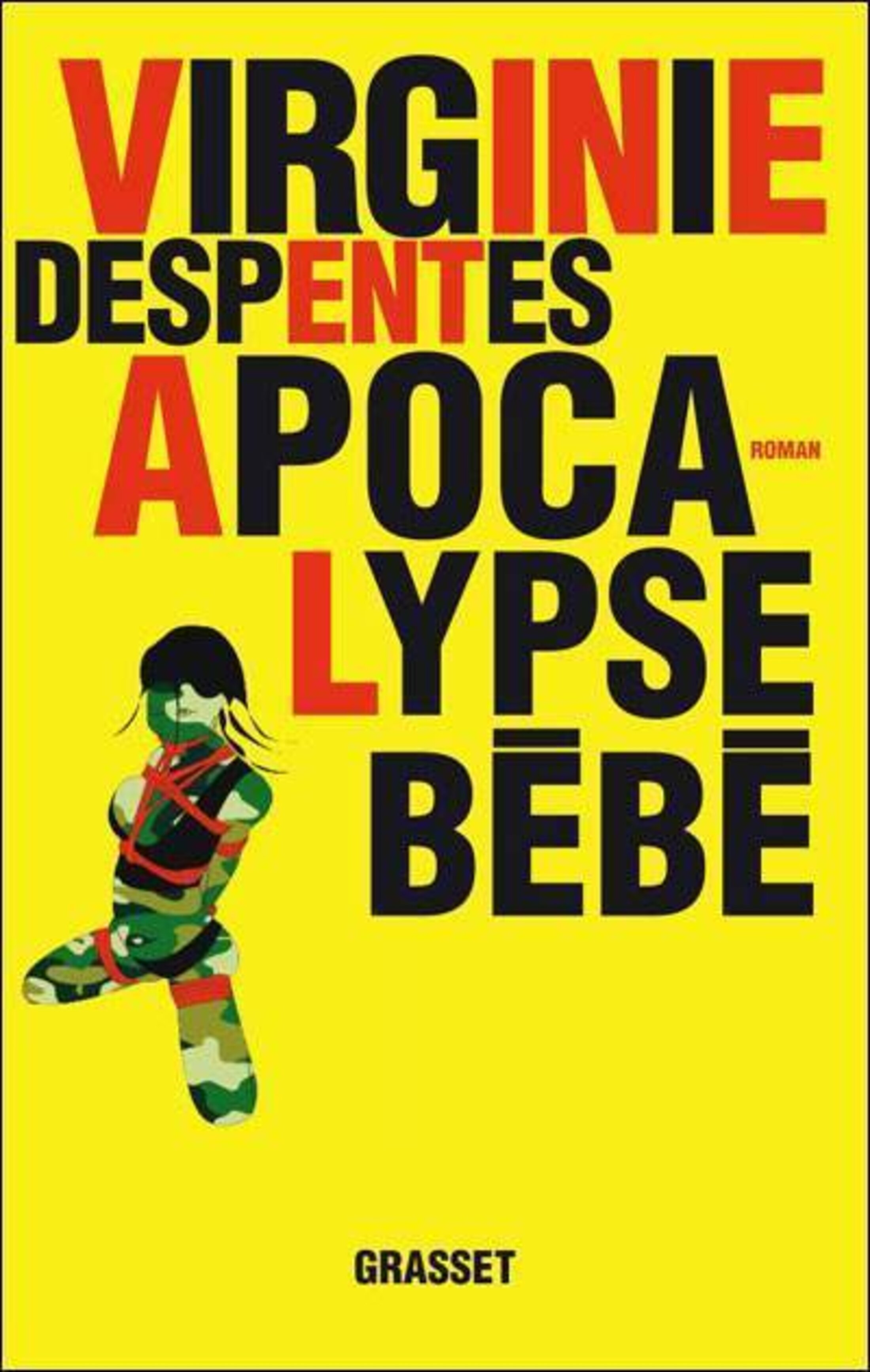
Au-delà des lieux, percent une inquiétude, une angoisse face à la marche du monde. Apocalypse bébé, selon Virginie Despentes (Grasset) : le titre de son roman semble un creuset de toute la rentrée littéraire. A sa suite, un testament (d’Olympe, par Chantal Thomas, Seuil), une Nécropolis (1209, Santiago Gamboa, Métailié), un Vice caché (Thomas Pynchon, Seuil, Fiction & Cie).
« C’est le dernier jour, mais je le sais pas encore », drôle de Prologue – qui sonne comme une fin – d’À la folle jeunesse d’AnnScott (Stock). Une littérature au bord des seuils, des abîmes.
Tout commence avec cet effondrement que nous avons tous vécu, intimement, par écrans télévisés interposés, une fin du monde paradoxalement infinie, obsessionnelle dans la narration contemporaine, dont les déflagrations ont changé à jamais notre perception de l’Histoire, de la terreur, de la médiatisation : le 11 septembre (L’Envers du monde, Le fond du ciel). La dévastation s’étend et la rentrée littéraire multiplie les Apocalypses. Celles d’une « civilisation au bord de la péremption » (Fanny Chiarello) : pandémie (L’Eternité n’est pas si longue), fins du monde (Le fond du ciel), ouragan (En attendant Babylone, Amanda Boyden, Albin Michel et Ouragan de Laurent Gaudé, Actes Sud), terres post-apocalyptiques de Sibérie (Marcel Theroux, Au nord du monde, Plon), « Ground Zero de la Ville lumière » (Virginie Despentes). Les romans se retournent sur le passé, dans le désordre, l’Algérie (Jérôme Ferrari, Où j’ai laissé mon âme, Actes Sud), un fait divers mettant en scène un chef d’Etat français juge et partie (Alice Ferney, Passé sous silence, Actes Sud), le Vietnam (Le Retour de Jim Lamar de Lionel Salaün, Liana Levi), la terreur brune vue par Agnès Desarthe (L’Olivier) et Arnaud Rykner dans Le Wagon :
« Tout ce qui est raconté ici est vrai. Tout ce qui est inventé ici est vrai aussi. Bien au-dessous de la réalité. Ce n’est pas une fiction.
J’ai dit qu’un historien avait enquêté, reconstitué, interrogé, avec rigueur et précision, des gens du train et hors du train. J’ai lu tout cela, pour ne pas mentir. J’ai lu tout ce que je pouvais, pour ne pas tricher. Ne pas faire le malin. Le moins possible.
Mais même en sachant ce que je savais, en lisant ce que j’avais lu, je ne pouvais que mentir. L’inimaginable doit être imaginé. Là où aucune image ne peut se former, il faut former une image. Une image injuste.
Alors tout ce qui est raconté est faux. Ce n’est pas un livre d’Histoire. L’Histoire est bien pire.
Irréelle.
Ceci est un roman » (Arnaud Rykner, Le Wagon, La Brune/Au Rouergue).
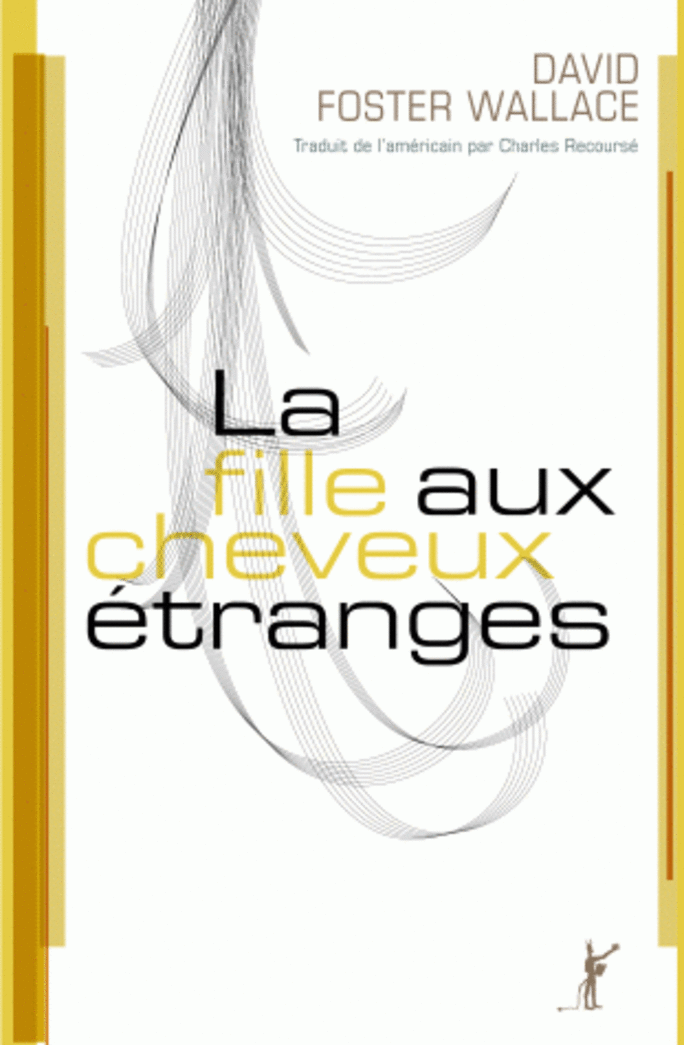
Roman de l’Histoire, histoire du roman, des formes qui s’écrivent sous nos yeux. Infiniment labiles, paradoxales, fascinantes. Triomphe de l’invention, de la fiction. Partout, des fins, des tragédies ironiques : Kennedy est assassiné une seconde fois dans Matamore n° 29 d’Alain Farah (Léo Scheer, « Laureli »), un George Clooney plus vrai que le vrai est pulvérisé en Irak, au Fond du ciel (Rodrigo Fresán, Seuil). What else ?
Comment survivre, comment continuer, échapper aux dépressions, qu’elles soient climatiques, historiques ou intimes ?
- Lever les yeux au Fond du ciel (Rodrigo Fresán, Seuil) ou les baisser aux Sols (Laurent Cohen, Actes Sud), deux récits exégétiques, mêlant roman et kabbale pour commenter la marche du monde.
- Construire des fables, faussement animalières : l’ânesse et le chien empaillés de Béatrice et Virgile (Yann Martel, Flammarion), les rennes d’Olivia Rosenthal (Verticales), les poissons dont le froid modifie la trajectoire (Pierre Szalowski, Editions Héloïse d’Ormesson), Maf le chien de Marilyn (Andrew O'Hagan, Christian Bourgois). Cela dit, « tout le monde n’a pas la chance d’aimer les animaux » (Olivia Rosenthal).
- Se réfugier dans l’art : le tableau d’un nu (L’Eternité n’est pas si longue, Fanny Chiarello), une artiste sans œuvre (Pauline Klein, Alice Kahn, Allia), Michel Ange (Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants, Mathias Enard, Actes Sud) mais aussi Warhol (Philippe Lafitte, Vies d’Andy) ou un homonyme de Jasper Jones (Craig Silvey, Le Secret de Jasper Jones, Calmann-Lévy), le cinéma (Vies et opinions de Maf le chien et de son amie Marilyn Monroe d’Andrew O’Hagan, chez Christian Bourgois ou CosmoZ de Claro, nouveau Magicien d’Oz, Actes Sud). Sans compter sur la part prise par l'art contemporain dans La Carte et le territoire de Michel Houellebecq (Flammarion).
De quoi patienter avec la prochaine rentrée, celle de janvier, en se demandant, avec Olivia Rosenthal (Verticales) ce Que font les rennes après Noël ? Et, en attendant, comme Cécile Coulon, Méfiez-vous des enfants sages (Viviane Hamy). De toute façon, Demain j'aurai vingt ans.
CM



