Dans son dernier ouvrage, le philosophe Jacques Bouveresse poursuit sa réflexion sur la religion. Après avoir écrit Peut-on ne pas croire ?, il nous propose désormais Que peut-on faire de la religion ?
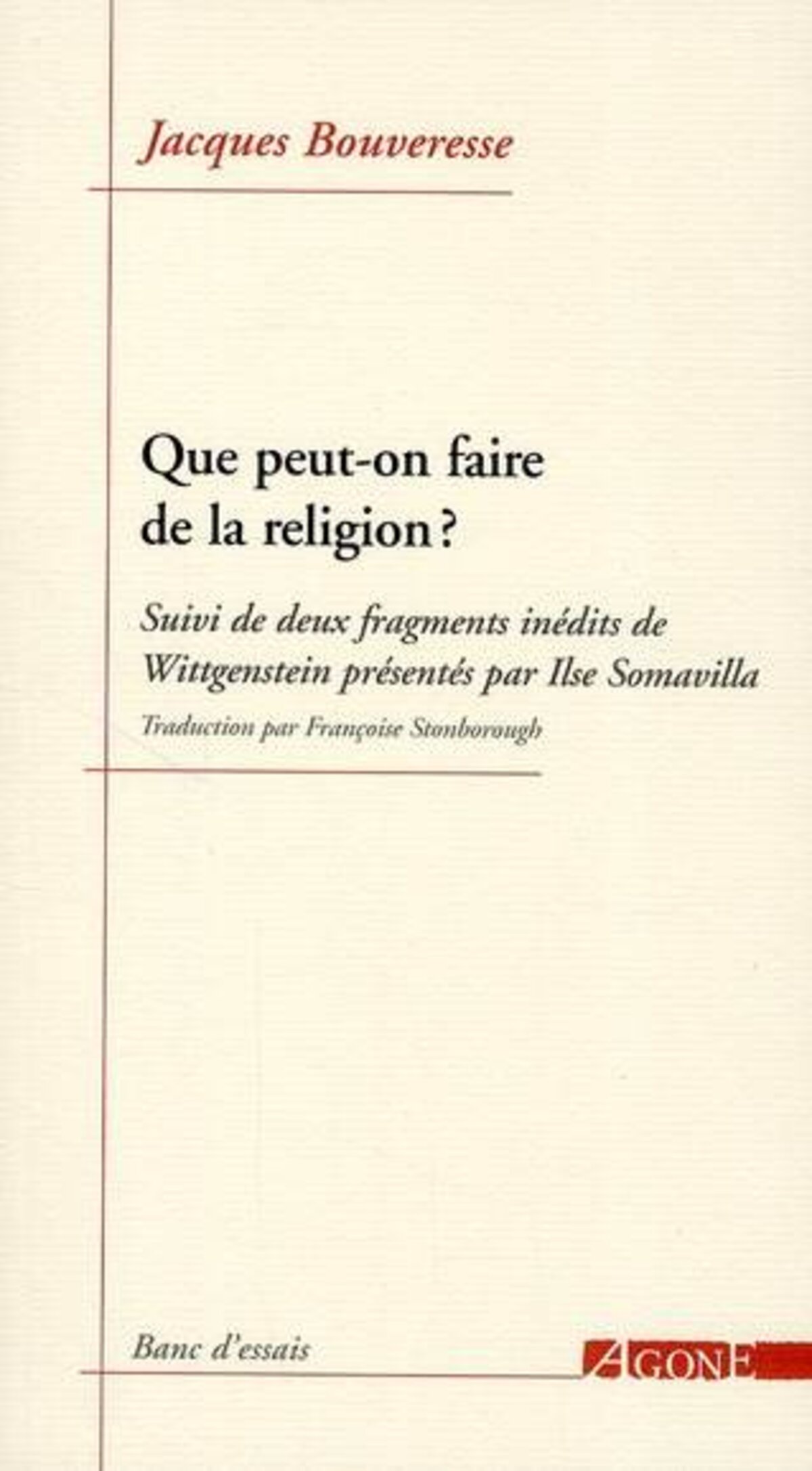
L'ouvrage vient à point nommé dans l'actualité. En effet, le pseudo-débat sur la laïcité et les véritables interrogations de citoyens laïcs (au sens de « pour une laïcité intransigeante ») pourraient poser ainsi le problème.
L'ouvrage est essentiellement constitué par la confrontation des deux philosophes que furent Bertrand Russell et Ludwig Wittgenstein. S'ils ont été relativement proches, le premier étant l'aîné et le protecteur en quelque sorte du second, leurs points de vue concernant la religion étaient diamétralement opposés. En effet, on peut dire que le rationalisme de Russell admettait peu de nuances en cette matière, tandis que Wittgenstein le logicien les multipliait.
Bouveresse se dissimule quelque peu derrière les citations des auteurs qu'il commente, mais cela nous amène à découvrir des œuvres peu connues en France, comme celle de John Henry Newman ou, tout récemment, celle de Charles Taylor : A Secular Age (2007). De toute façon, l'ancien professeur du Collège de France se trouve bien souvent derrière les réflexions de son maître à penser autrichien.
Ce que Newman et Wittgenstein - et donc Bouveresse - avancent, c'est que la croyance et l'incroyance sont à renvoyer dos à dos car basées sur des certitudes qui ne sont aucunement le fruit d'un raisonnement ou de preuves mais provenant bien plutôt de « l'imagination ». Autrement dit, le rationalisme athée de Russel rejoint celui de Leibniz qui pensait pouvoir fonder la religion par la lumière de la raison - à la différence de Pascal et de son pari. C'est pourquoi la foi n'a rien à voir avec la vérité telle que nous l'entendons philosophiquement, et lorsque la science se veut être l'exact contraire de la religion en matière de vérité, cela mène tout droit au scientisme et à un « irrationalisme scientifique » - on croit à la science - hérité de Popper (chapitre III).
Cela explique pourquoi Wittgenstein a déclaré ceci : « C'est un dogme de l'Eglise romaine que l'existence de Dieu peut être démontrée par la raison naturelle. Eh bien, ce dogme entraînerait pour moi l'impossibilité d'être catholique romain. Si je pensais à Dieu comme à un autre être semblable à moi, seulement infiniment plus puissant, alors je considérerais comme mon devoir de le défier. » (p. 36). Le fait de ne pouvoir philosophiquement considérer Dieu comme être renvoie - sans que Wittgenstein et Bouveresse l'évoquent - à la définition philosophique de Dieu comme étant par Spinoza.
Puisque la religion ne peut être seulement basée sur la croyance à la vérité, on lui trouve d'autres aspects qui n'ont pas trait à la lumière mais à la chaleur, voire aux couleurs. S'appuyant sur les réflexions de Taylor, Bouveresse en vient à dire que la religion est déclinable et, surtout, qu'elle prend des significations nouvelles dans les sociétés modernes, séculières. Progressivement, nous quittons un monde où croyants et incroyants s'opposaient pour accéder à un horizon généralisé de non croyance, c'est-à-dire que le religieux moderne ne se caractérisera pas par sa croyance mais par sa pratique, non d'une manière rituelle, « superstitieuse », comme dans le monde d'antan, mais d'une manière culturelle. Ainsi, « poser » la question que peut-on faire de la religion musulmane dans la république laïque n'a guère de sens dans une époque où pratiquer une religion ne sera pas s'opposer à une société séculière mais bien s'y agréger à sa manière.
Jacques Bouveresse, Que peut-on faire de la religion ?, Marseille, éditions Agone, 2011, 190 pages, 19 euros.


