«Süddeutsche Zeitung, ce matin, pages littéraires. Hellmut Freund a écrit son autobiographie ; le critique estime que si l'on a deux pantalons, il faut en vendre un et acheter ce livre avec le produit de la transaction. On lit rarement ce genre de conseils exaltés dans les journaux allemands». Et en France ?

Agrandissement : Illustration 1
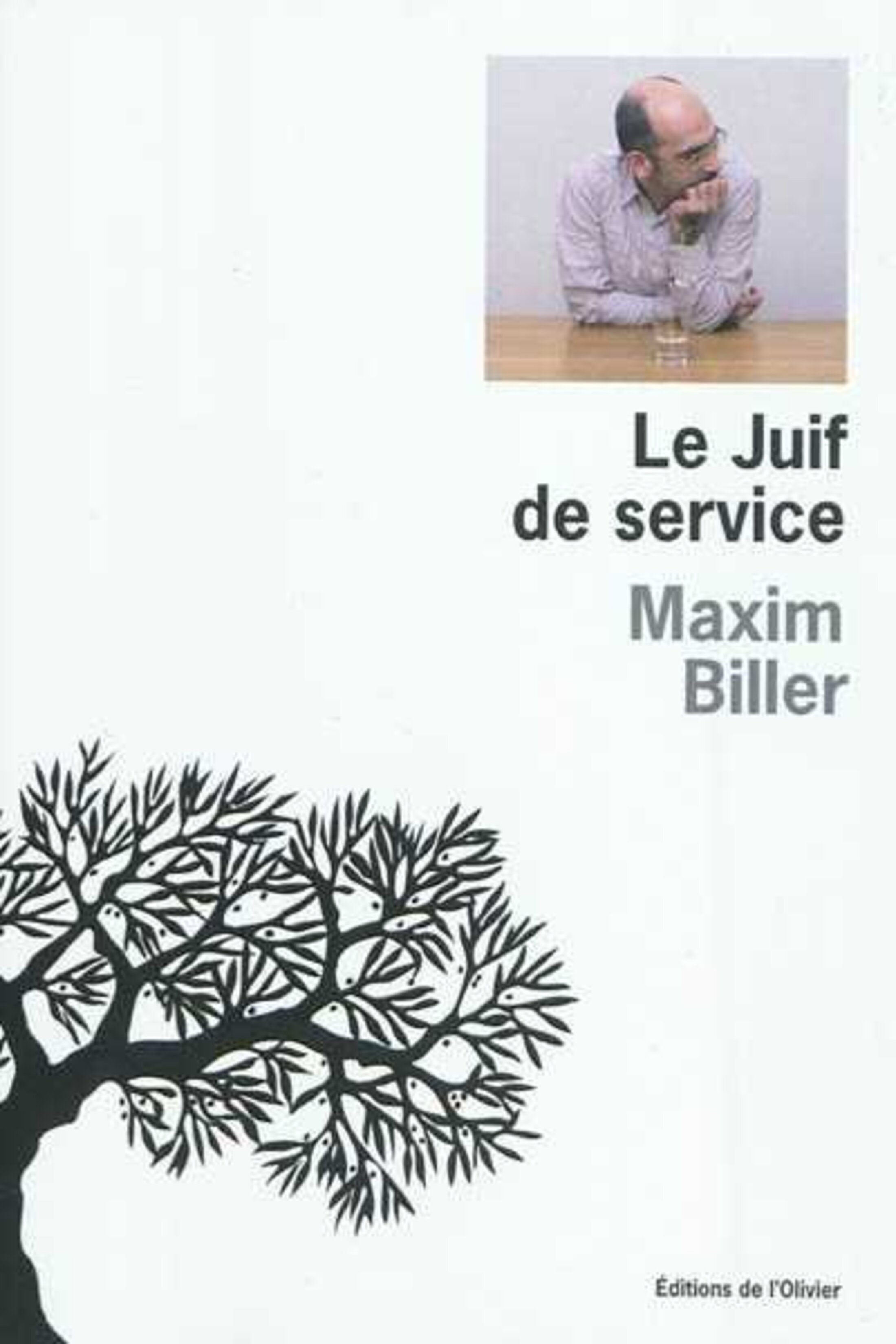
Howard Jacobson l'appelle La Question Finkler. Chez Philip Roth, le narrateur de Portnoy en plein «blues juif» et interrogations identitaires (de la sexualité à la religion) entend son oncle Hymie déclarer que «le seul endroit où doive vivre un Juif, c'est parmi les Juifs».
Cette question du lieu traverse Le Juif de service de Maxim Biller, «Autoportrait» caustique et emporté, comme L'Amour aujourd'hui, recueil de nouvelles, deux livres que viennent de publier les éditions de L'Olivier. Comme le narrateur de «Mon nom était Singer» Biller vit «à la mauvaise époque et dans le mauvais lieu», «un auteur juif moderne écrivant en allemand». Il a d'ailleurs lu Portnoy, pendant un voyage en Israël. Mais il n'y vit pas : «Dehors, c'était l'Allemagne, et moi j'étais dedans».
Comment être juif en Allemagne aujourd'hui? Comment être juif et écrire en allemand? Pourquoi accepter ce lieu impossible, ne pas émigrer en Israël? Ou à New York, «la capitale du judaïsme mondial», ce lieu où vivent des «Juifs sans Shoah» qui «n'avaient pas à grandir avec des pères et des mères qui, chaque nuit, dans leurs cauchemars, retournaient dans les camps», qui croisent sans doute aussi des antisémites «mais aucun n'avait honte d'Auschwitz ou n'était furieux parce qu'on ait fermé le camp avant que le travail fût terminé».
On ne peut en finir avec ces questions, en ce qu'elles sont intimes et collectives, religieuses et politiques. Maxim Biller, né à Prague en 1960, est allemand d'adoption. Ses parents, originaires de Russie, ont quitté l'Europe de l'Est et sont venus s'installer en RFA en 1970.
«Que j'étais juif, et rien que juif, je l'avais appris à la maison, d'un père juif qui, dans sa jeunesse, avait cru en Lénine comme en un Dieu. Puis des homme de Staline l'avaient chassé du Parti en 1949 - parce qu'il était juif - et le fait d'être juif - ce qu'il n'avait jamais été auparavant - devint sa religion, mais sans châle de prière ni synagogue. J'en ai hérité quelque chose: je suis juif et rien que juif parce que, comme tous les Juifs, je ne crois qu'en moi-même, et que je n'ai même pas un Dieu contre lequel je pourrais me mettre en colère. Je suis juif parce que presque tous les membres de ma famille avant moi étaient juifs. Je suis juif parce que je ne veux pas être russe, tchèque ou allemand. Je suis juif parce qu'à vingt ans je racontais déjà des histoires juives, parce que la perspective de prendre froid me fait plus peur que celle d'une guerre et parce que je considère que le sexe est plus important que la littérature. Je suis juif parce que j'ai constaté, un jour, quel plaisir me procurait l'embarras des autres lorsque je leur disais : 'je suis juif ‘».
Les autres? Les habitants d'une Allemagne qui n'a pas réglé son rapport au nazisme. Biller, «juif de service», incarne la culpabilité de l'Allemagne vécue de manière complexe et contradictoire: miséricorde béate, ignorance volontaire ou résurgences, terribles, de la haine du Juif (et au-delà, de l'étranger). Comme l'écrit Maxim Biller avec une ironie implacable, il est celui par lequel une identité allemande se définit: «Ils devraient m'être reconnaissants. Sans moi sauraient-ils qui ils sont?».
Le Juif de service est donc d'abord une dénonciation, celle de l'antisémitisme de Thomas Mann, de certains médias, de Fassbinder, d'un racisme plus général qui s'exprime dans une extrême-droite toujours florissante: «Je développais même une théorie personnelle: tout ce qui ne va pas en Allemagne, disais-je, tient au fait que les Allemands ne sont pas civilisés. Et tout ce qui est nouveau ou inconnu les déstabilise - les étrangers, l'humour, la démocratie, les invités à la fête quand ils ne les ont jamais rencontrés. C'est pour cette raison, concluais-je, que Hitler avait pu faire carrière. Il avait promis aux Allemands de libérer le monde de tout ce qu'ils ne connaissaient pas». Une théorie qu'il exprimera dans une chronique au titre explicite, Cent lignes de haine. La colère de Maxim Biller se dit tour à tour dans l'humour, le cynisme, la provocation, en un texte amer, désespéré, excessif, entre arrogance et rancœur.

Agrandissement : Illustration 2

Pourtant l'écrivain fait le choix de l'allemand pour écrire et il refuse de partir. De toute façon, ajoute-t-il non sans humour (même s'il dézingue par ailleurs aussi le cliché juif=drôle), son «hébreu est à peu près aussi au point que celui d'Eichmann»:
«L'été 1982, je décidai de ne plus rêver d'Israël. L'allemand était ma langue, l'Allemagne d'était donc mon pays». Et Le Juif de service, «Autoportrait», se fait alors quête identitaire: être juif, est-ce un héritage, une tradition, un choix? Est-on juif parce que l'on se définit ainsi ou parce que «la société dans laquelle je vis le sait parfaitement, elle. Pour elle, je suis et je reste un Juif, que je le veuille ou non, et cela fait beaucoup plus de moi un Juif que ce qui est peut-être juif en moi».
Biller finit par comprendre que son identité est dans l'écriture: «L'être-juif, c'était être écrivain, mais il fallait le vouloir». L'autoportrait se fait alors roman d'apprentissage, celui d'un jeune homme qui tente de percer dans le monde des lettres, d'abord journaliste, traducteur puis écrivain. Biller fait une peinture au vitriol du milieu littéraire, autour d'une figure centrale, père symbolique, double fantasmé et contre-modèle, le critique et écrivain Marcel Reich-Ranicki.
«Je ne veux pas être juif parce qu'on me voit comme un Juif. Je veux être juif, homme, écrivain, parce que je le suis». Habiter pleinement son identité, tel est le parcours de ce livre, «d'abord j'ai été le Juif jeune et doux, puis le Juif jeune et Kafkaïen, puis le Juif récalcitrant, ensuite le Juif destructeur, et pour finir le Juif juif».
La colère de Maxim Biller nourrit ce texte, souvent virulent, jamais gratuit, refusant l'oubli ou les simplifications hypocrites. Une colère parfaitement rendue, dans sa violence, par la structure du livre, 61 fragments comme autant de coups de gueule. Maxim Biller refuse d'être «le juif de service», l'alibi ou la bonne conscience d'un pays enfermé entre culpabilité et oubli.
Si vous avez deux pantalons, vendez-en un.
Maxim Biller, Le Juif de service, autoportrait, traduit de l'allemand par Olivier Mannoni, Editions de l'Olivier, 161 p., 19 €
Et
Maxim Biller, L'Amour aujourd'hui, traduit de l'allemand par Olivier Mannoni, Editions de l'Olivier, 192 p., 19 €.
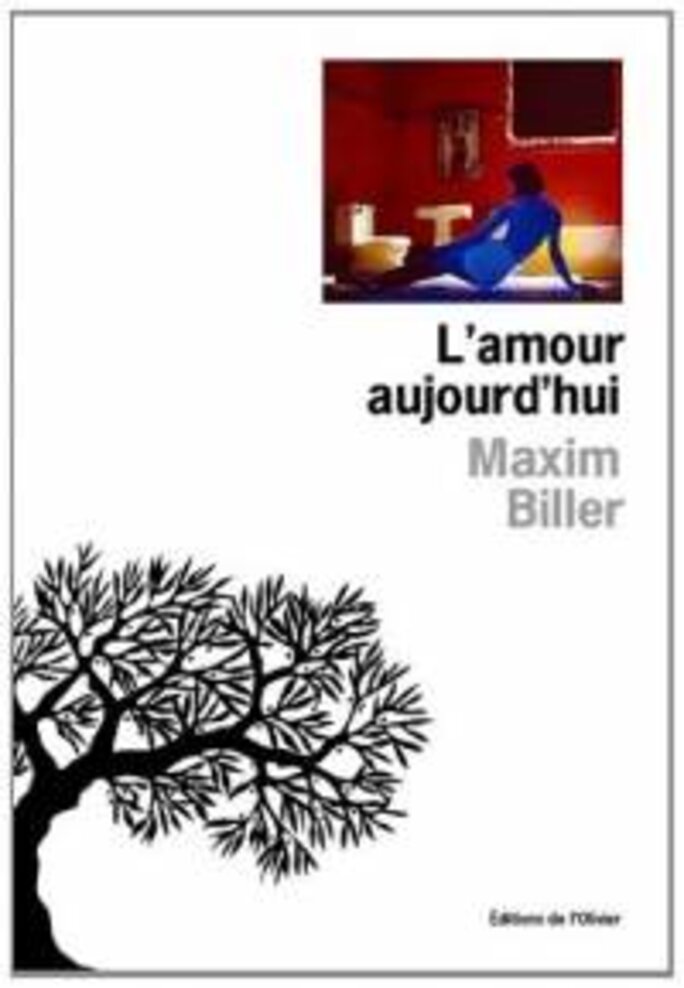
27 nouvelles déclinent l'amour aujourd'hui (Liebe heute) sous toutes ses formes: comment il résiste à l'absence («De grandes feuilles vertes et ondoyantes»), comment il s'inscrit dans une histoire intime, dans le silence de l'évidence que seule une frontière ténue sépare de l'impossible («Sept tentatives pour aimer»).
Les textes de Maxim Biller peignent des hommes perdus face aux femmes, indifférents ou dominés. Ils se centrent sur des moments de crise, ces instants où tout pourrait basculer dans un sens ou un autre, et où, bien souvent, rien n'advient. Il est aussi dans ce recueil, très inégal, des femmes fascinées par des figures d'écrivain, sublimant l'admiration en désir sexuel et Isaac Bashevis Singer mettant le narrateur en garde contre les «femmes qui aiment tes livres». On croise aussi Oz, Grossman et Kollek qui rédigent une lettre «sombre» sur le déclin d'Israël.
L'amour y est sexuel, intime, amical ou politique. Comme dans cette nouvelle, une des plus marquantes de L'Amour aujourd'hui, où un homme regardant la guerre à la télévision pense à son fils. Il a quitté la mère de Frédéric, son fils est devenu américain et doit aujourd'hui partir combattre au Koweït («Bagdad à sept heures et demie»): «Il était toujours assis au bar. Il avait les yeux levés vers le téléviseur, mais aucune idée de ce qu'il voyait. Il se dit, à l'époque j'aurais dû rester chez Marcia à Georgetown, je l'aurais trompée de temps en temps et elle m'aurait trompée elle aussi, mais nous aurions été heureux tout de même et Frédéric ne serait pas soldat à l'heure qu'il est, j'y aurais veillé.»
Les textes de Maxim Biller jouent d'entre-deux, quasi imperceptibles, de personnages qui ne comprennent pas pourquoi ils s'aiment ou ne s'aiment plus et la forme brève de la nouvelle accentue le désespoir, l'inconsistance des quotidiens ou l'ironie tragique de certaines décisions, de certaines identités, comme celle d'Edna dans Ziggy Stardust : «Son père venait de Hongrie et ce n'était pas un Juif, ou alors il en était un sans vouloir l'être. Ce genre de choses était souvent arrivé après la guerre».
Toutes les nouvelles pourraient poser la même question que le tableau que la narrateur du Dos d'Aviva s'imagine peindre, «pourquoi» comme un « pour quoi » en miroir, pour quelle raison et dans quel but, question centrale de l'œuvre de Maxim Biller:
«Quel tableau aurais-je peint, aujourd'hui si j'avais su peindre? Quelque chose avec de la neige, une très grande quantité de neige qui recouvrirait une grande ville, le ciel serait lilas ou gris bleuâtre, et quelques petits bonhommes plongeraient la tête dans de grands tas de neige, et je l'intitulerais POURQUOI».



