Ludo dos Santos est né à Héliopolis, favela de São Paulo. Adopté par Zé Carnicelli, richissime propriétaire de la chaîne de supermarchés MaxiMarket, il poursuit ses études aux Etats-Unis, mène une carrière de publicitaire, vit parmi les nantis brésiliens. Mais peut-on couper avec son passé, oublier avoir été un favelado, se sentir libre dans le piège doré que la vie lui a réservé ?
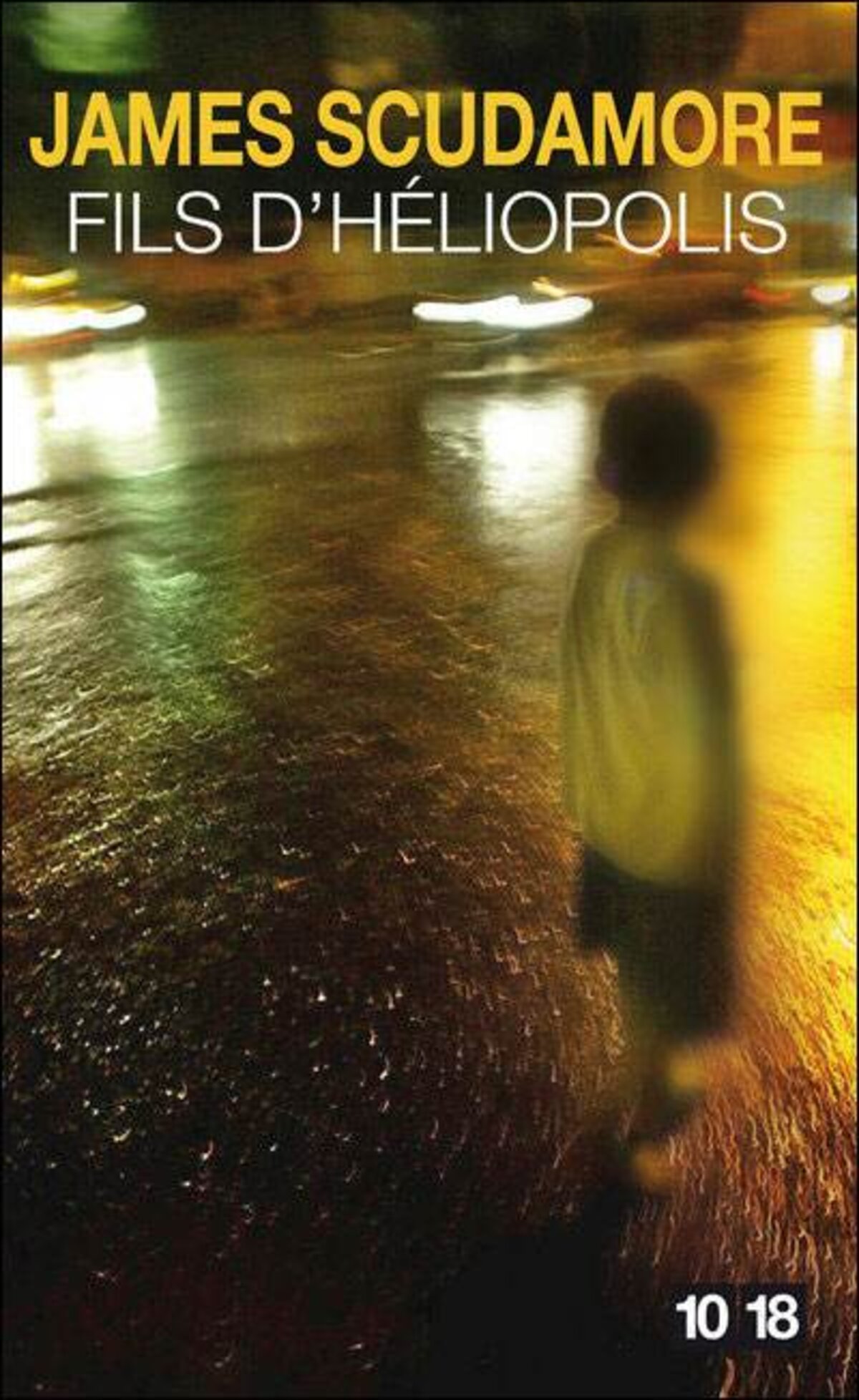
Agrandissement : Illustration 1
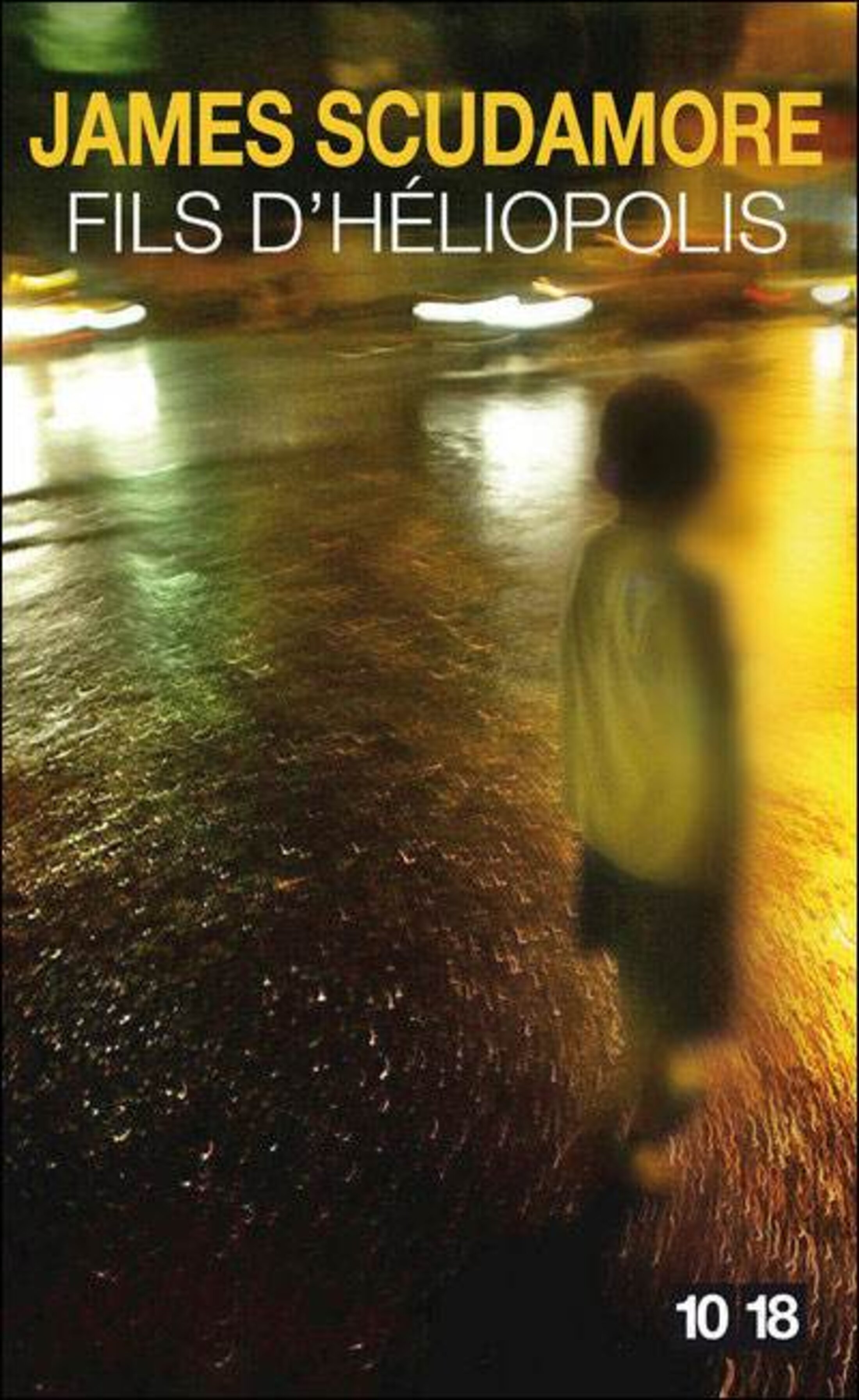
Fils d’Héliopolis suit l’itinéraire de Ludo, trentenaire pris dans un grand écart, un vertige, une colère et un questionnement identitaire, dans un roman coloré et sensuel qui télescope souvenirs et présent, récit et interrogations.
Ludo a le sentiment d’être « un passager en transit », il vit dans un entre-deux, le São Paulo des nantis et l’attrait de ces favelas dans lesquelles il est pourtant, désormais, un étranger. Sa mère biologique, cuisinière des Carnicelli, et sa mère adoptive, Rebecca, engluée dans ses projets humanitaires. Sa peau, ni tout à fait noire ni tout à fait blanche, « noix de cajou ». Et Melissa, sa sœur adoptive, fille de Zé et Rebecca, avec laquelle il entretient une liaison incestueuse. Le roman s’ouvre sur ces lignes :
« Il est tôt, pas encore sept heures, et une fois de plus je me réveille aux côtés de ma sœur adoptive.
Il faut que ça s’arrête. Elle est mariée ».
Un début en forme de coup de poing, comme ceux que la vie réserve à Ludo, dans sa quête identitaire. A travers lui, c’est le Brésil contemporain que saisit James Scudamore, un pays écartelé lui aussi, entre richesse et pauvreté, tout aussi indécentes l’une que l’autre. Deux mondes, deux espaces, le haut et le bas. Zé et ses amis vivent dans des lieux à part, dans les airs, avec leurs hélicoptères qui les déposent de tours et tours, ou dans des quartiers résidentiels hautement sécurisés. Ludo, lui, a choisi de vivre au rez-de-chaussée, dans cet espace qui figure cet entre-deux, une tour, comme les nantis, mais au ras du sol :
« Contrairement à Melissa, je ne vis pas dans les nuages. Je n’habite pas non plus une forteresse, comme son père. J’occupe un studio dans un quartier convenable – trois blocs d’immeubles oblongs, de couleur beige, rose et blanche, regroupés autour d’une piscine privée commune. Mon studio est niché au rez-de-jardin, dans un renfoncement du bâtiment blanc : c’est comme habiter une grotte au pied d’une falaise ».
Roman social, politique, économique, identitaire, Fils d’Héliopolis emporte, par la puissance de ses questionnements, sans jamais s’appesantir, en ouvrant des brèches, des béances, à travers une destinée à la fois unique et symbolique. Le roman est le portrait d’une ville, São Paulo, « métropole chaotique, impossible à cartographier », à l’énergie « grisante, fascinante, excitante », « féroce », comme de l’un de ses enfants. Deux portraits en parallèle, indissociables, dans leurs mutations, leurs écarts identitaires, leur quête :
« La ville est livrée aux assauts conjoints des forces de la croissance et du délabrement : la seule constante est sa capacité à se métamorphoser. »
Ludo tente de cerner son passé, devenu une légende, à travers les récits lacunaires et mensongers de sa mère, la photographie prise à l’époque de son entrée dans la famille Carnicelli – la clé du roman –, la publicité faite par Zé autour de l’adoption du « favelado », d’aller vers sa vérité intérieure. Mais au Brésil, tout se monnaie, tout se paie d’une manière ou d’une autre, tout a une contrepartie. Ce que Ludo comprendra à son corps défendant, tout en découvrant qui est son véritable père.
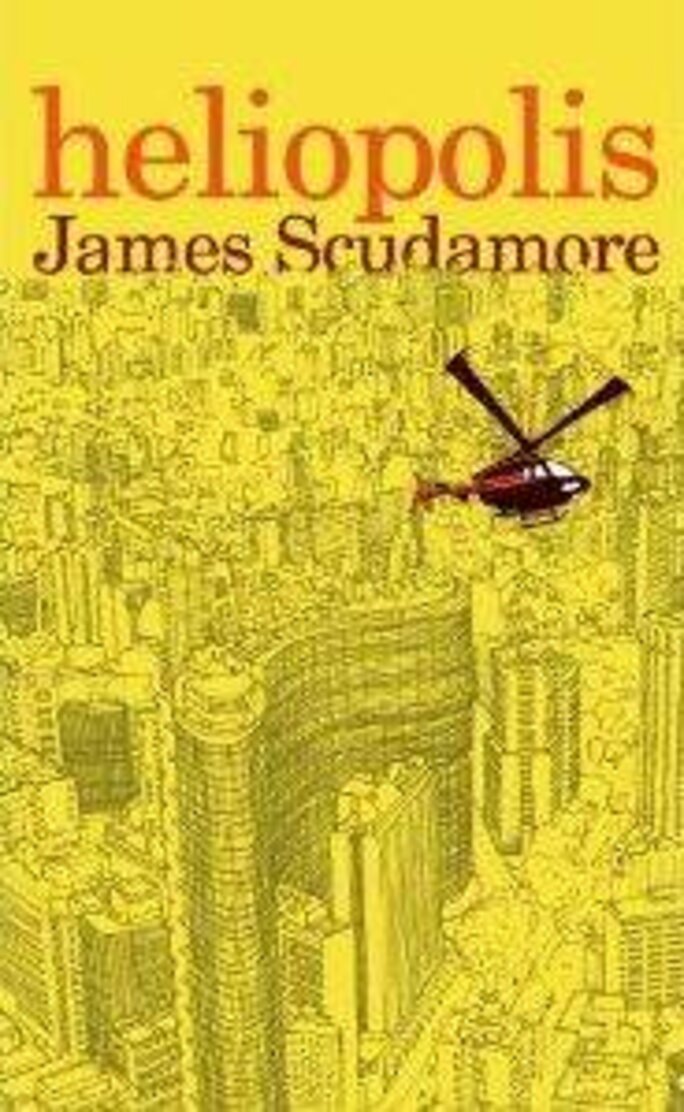
L’identité suspendue de Ludo sert de fil rouge à un récit qui ne recule devant rien, dévoile les dessous des aides humanitaires comme des grandes fortunes, se déploie aussi bien dans les quartiers nantis que dans les favelas. Tout se dit à travers la nourriture, chaque chapitre porte le nom d’un plat ou d’un aliment, chacun associé à une part de l’histoire de Ludo, clé de sa mémoire sensorielle, en une table des matières qui serait comme un menu de ses souvenirs, des moments climatériques de sa destinée et de ses revers de fortune. Ludo a « faim », « depuis mon premier cri, la faim m’a toujours poursuivi ». Une faim des plats préparés par sa mère, qui n’exprime ses sentiments que dans la cuisine et les condiments, une faim de savoir, de comprendre, enfin, qui il est :
« Mon histoire n’est pas une histoire ordinaire. Ce qui m’est arrivé n’arrive jamais ».
L’extraordinaire advient dans et par la fiction, qui seule permet de cartographier le réel, de dire son chaos et ses énigmes, ses dessous, ses fossés sociaux. Le lecteur est emporté par ce roman comme par Ludo, ce « drôle d’inconnu », cet être qui ignore quelle est sa place dans le monde et dans une histoire qui semble avoir été écrite sans lui et veut désormais aller de l’avant, seul, dans « la beauté de la ville, la nuit, immense de tous les possibles ».
James Scudamore, Fils d’Héliopolis, traduit de l’anglais par Anne-Marie Carrière, 10/18, Inédit Grand Format, 324 p., 18 €
Fils d’Héliopolis, long-listé pour le Man Booker Prize en 2009, est le second roman de James Scudamore, un jeune auteur anglais (il est né en 1976) qui a passé sa vie entre le Japon, le Brésil et l’Angleterre. C’est le premier traduit en France. Un auteur à découvrir d’urgence, avant la traduction, toujours en Grand Format Inédit chez 10/18, de son premier roman, The Amnesia Clinic qui a reçu en 2007 le Somerset Maugham Award.



