Un recueil hypnotique. Nul doute que la nouvelle Mourir à Naples et sa « douce chute » vous poursuivront longtemps. Mary Gordon prend la mesure, de texte en texte, du vacillement des certitudes, du flou des sentiments : « Ma grand-mère ne sait trouver sa place dans cette compagnie que d’ailleurs elle méprise. D’un œil expert, elle évalue le prix des robes, le gaspillage de bonne nourriture qu’impliquent les plats encore à demi pleins sur les tables en désordre. Elle sait qu’elle est sauvée et eux perdus, qu’elle a raison et eux tort, qu’elle est sage et eux stupides.
Est-ce vrai ? Peut-être, au lieu de les juger, les envie-t-elle ? Adore-t-elle ces personnages légers et nonchalants, aux mains vides ? Leur joli teint, leurs membres déliés impropres au travail ? Leurs chaussures qui ne pourraient les mener nulle part ? Peut-être qu’elle n’est pas ma grand-mère, je veux dire une vieille femme, mais une toute jeune fille. Elle a une ossature délicate. La peau de ses mains est d’un blanc bleuté, diaphane. Elle espère que l’un de ces dîneurs dira : « quelle charmante enfant ! Si nous l’invitions à prendre une glace ? »
Alors elle s’assoirait avec eux dans le pavillon et dégusterait une glace à la pistache ou au citron servie sous la forme d’une fleur ou peut-être d’un oiseau. Et ils l’interrogeraient sur sa personne.
Mais elle, elle ne répondrait pas car elle saurait que cela gâcherait tout. Elle secouerait la tête en silence, porterait sa cuiller à ses lèvres, tout heureuse, réfléchissant au mot « glauque » sans qu’on attende quelque chose d’elle et sans qu’elle ait besoin de faire quoi que ce soit » [Ma Grand-mère du côté de chez Proust]
Cet extrait condense une partie du recueil, la difficulté à trouver une place, les monologues intérieurs des personnages, leurs questionnements, les peut-être comme rapport au monde et à l’écriture, les échappées dans les rêves, au conditionnel, les silences opaques… La nouvelle s’intitule Intertextuality dans le texte original, comme une signature de sa valeur d’art poétique du recueil dans son ensemble. Il en donne quelques clés, qui ouvrent vers un espace de sens, parcellaire, lacunaire, en attente de construction par le lecteur.
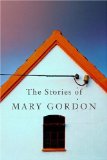
La majorité des nouvelles du recueil sont écrites à la première personne du singulier, au sens plein du terme, il s’agit chaque fois d’un je absolument subjectif, souvent féminin, Mary Gordon donne à entendre directement la voix de ses personnages. La sienne disparaît ou plutôt se diffracte de nouvelle en nouvelle, sans jamais se recomposer entièrement, sinon à travers quelques motifs récurrents : la famille, l’éducation, l’écriture, le couple, la crise de la cinquantaine, la vie aux USA d’émigrés irlandais, la mise à mal de l’american dream ou american way of life. Marie Gordon est un véritable caméléon, elle se fond dans ses personnages, dans leurs troubles, leur complexité, elle les expose sans tout révéler ; aux lecteurs de lire et relier, d’aller au-delà de ce qui est énoncé.
Mary Gordon creuse les souffrances de l’enfance, la manière dont elles isolent ensuite l’adulte, l’enferment dans un rapport biaisé au monde. Ainsi Nettoyage. La mère de Loretta « pète les plombs », le jour même où un homme marche pour la première fois sur la lune, elle franchit les limites de l’indécence. Loretta est placée dans la famille Lavin. Elle vit dans une peur qui est celle de nombre des personnages du recueil : « être condamné pour un acte qu’on n’a pas commis ». Porter le poids de la faute, même celle d’un autre. Vivre dans la honte. Cette tache de son enfance pèse sur sa manière d’être, sur ses gestes les plus quotidiens, comme le simple fait de savoir prendre une douche :
« La maison où elle avait vécu avec sa mère ne possédait pas de douche, juste une baignoire. Loretta ne s’était jamais douchée de sa vie. Elle sentait que les Lavin aurait trouvé bizarre qu’elle prît un bain le matin. Ou même le soir, comme leurs enfants. Pour eux, il s’agissait d’un long rituel, d’un jeu qui n’avait pas grand-chose à voir avec l’hygiène. Loretta se disait qu’en prenant un bain elle se hissait au même niveau que les enfants du couple, exprimant des besoins semblables et donnant ainsi l’idée qu’elle croyait y avoir droit.
La difficulté, c’était qu’elle ne savait pas se servir de la douche. Elle ignorait s’il fallait mettre le rideau à l’intérieur ou à l’extérieur de la baignoire. Et elle n’osait pas demander : « comment prend-on une douche ? » Elle aurait paru trop pitoyable, trop minable – bref, trop bizarre. Or elle ne voulait donner aucune de ces impressions-là. Aussi pendant les six semaines de son séjour chez les Lavin ne se lava-t-elle qu’au lavabo. Elle ne savait pas ce qu’ils en pensaient. Mais elle était certaine d’une chose : jamais ils n’auraient pu la soupçonner de prétendre tenir dans leur famille une place qui ne fût pas la sienne ».
Les études brillantes de Loretta, son doctorat sur les Odes d’Horace, son poste à la fac, rien la lavera de cette souillure de l’enfance, de cette honte, de la « mare sombre d’une rancune qui n’épargnait personne », de son indifférence aux êtres et aux choses, comme une barrière, une frontière qui la coupe de tout sentiment. La seule manière de se sauver serait – ce qu’elle fera, je ne révèlerai pas comment – de transmettre cette tache, cette punition, « au nom de sa mère ». Même schéma dans la nouvelle initiale du recueil, Vivre en ville, où Béatrice tente de rompre avec un passé de « crasse » et de « laideur » en construisant un refuge avec son mari Peter, « une vie de linge propre et de chambres claires, de vaisselle assortie et d’une panoplie de linge de cuisine ». Elle est heureuse de déménager à New York, pour l’anonymat de la grande ville, l’apaisement de ne plus avoir à craindre « à chaque instant qu’on ne découvrit la vérité sur elle, d’où elle venait, de quel milieu elle sortait, qui elle était véritablement ». Mais son passé viendra bien sûr la rattraper, de manière aussi brutale qu’inattendue.
Nombre de personnages du Mari de la traductrice sont ainsi enfermés dans leurs solitudes, leurs complexes, comme Florence (La Bibliothèque) qui, comme d’autres personnages du recueil (Mourir à Naples), se donne une amie imaginaire et valorisante, est incapable de se déplacer dans New York au-delà des cinq rues qui entourent son domicile, vit dans et par les livres et a pour seule occupation – hors la lecture – l’observation des autres lecteurs de sa bibliothèque. Elle est un jour intriguée par la manière de faire d’un homme, le « gentleman européen », proche de la composition comme du mode de réception de ce recueil. Il ne lit que les ouvrages que d’autres ont empruntés et reposés :
« Toute ma vie, j’ai travaillé dans une spécialité, la philologie de la langue romane. Maintenant, j’explore d’autres domaines. J’adore passer derrière les gens pour glaner dans les champs du savoir. Je ramasse ce qu’un autre a laissé. Je vois dans cette activité une sorte de patchwork confectionné à l’intérieur d’une communauté du savoir. Je pique une miette de ce qu’un autre a assimilé et, par l’intermédiaire de cette miette, j’entre en rapport avec cette personne. N’est-ce pas plus sympathique comme ça ? »
Empathique, certainement. Mary Gordon épouse les pensées de chaque personnage, nous fond en eux, distille un attachement presque viscéral à ces histoires, aux dessous de leurs apparences fuyantes. L’attachement est d’ailleurs un autre thème unificateur du recueil, cette mince distinction entre l’amour et l’attachement pathologique (lire Séparation, histoire d’une femme qui ne parvient pas à se détacher de son enfant, même pour le laisser jouer ou aller à l’école, ou Trois Histoires d’amour et de mort).
Le Mari de la traductrice est un recueil de rancœurs tues, de rencontres manquées, de sentiments d’imposture, de honte, d’étrangeté. Souvent poignant, parfois drôle, décalé, comme dans la nouvelle Mon podologue me raconte l’histoire d’un garçon et d’un chien, où la fille du podologue joue du… « cor anglais », ou Le Mari de la traductrice, un des rares textes écrits à travers une voix masculine, qui donne son titre au recueil, où le narrateur, n’a pas dit à sa femme depuis douze ans, Barbara, qu’il a déjà été marié à Brenda. L’une est un auteur à succès, l’autre traductrice. « Quelles chances y avait-il que put se produire une telle coïncidence ? mon ex-femme traduisant une œuvre de ma femme actuelle ? » Une seule, celle qui crée les fictions les plus saugrenues, décalées et drôles.
Le recueil de nouvelles de Mary Gordon s’offre comme un « patchwork » de vies, de tons, de non dits superbement mis en relief dans leur opacité même, un ensemble impressionniste. La frustration en est sans doute une des clés ou celle des lecteurs, qui voudraient toujours aller plus loin. Celle des personnages représentés : « Quelque chose les attend. C’est tout ce qu’ils comprennent » (Trois hommes me parlent de leur enfance ».
Dans Rosecliff, maison de Newport dans le Rhode Island, je demande : « si l’on sait qu’il y a eu de la souffrance, mais qu’on ignore qui a souffert, comment raconter cette histoire ? ». A la manière de Mary Gordon, sans aucun doute.
Mary Gordon, Le Mari de la traductrice [Stories of Mary Gordon], nouvelles traduites de l’américain par Lisa Rosenbaum, Quai Voltaire, 416 p., 22 €.



