Son écriture creuse, scrute, dissèque, rend les chaos de l’histoire, reconstitue peu à peu le puzzle des décombres, des cauchemars, des fracas, en conservant leurs brisures.
Day est l’histoire d’Alfred Day, Alfie – Alfred est son « prénom du dimanche ». Il a quinze ans lorsqu’éclate la seconde guerre mondiale. Il devance l’appel, moins comme une avancée que comme une fuite (quitter son enfance, son père violent et alcoolique), comme un appel de la liberté, pour être « tout là-haut dans l’air pur, en liberté dans le bleu du ciel ». Il devient mitrailleur arrière sur un bombardier Lancaster, seul survivant de son équipage. Alfred est seul, irrémédiablement seul, malgré la camaraderie que crée la peur parmi les soldats, malgré la photo de Joyce, cette femme lumineuse, de « l’éclat », qu’il n’a pas eu le temps d’aimer, cette femme « tellement », « trop » qui « ébranle ce qui avait toujours été là, solide, un endroit de lui-même qu’il ne connaissait pas ».
A.L. Kennedy nous conduit dans le cerveau d’Alfred, brisé par la guerre, prisonnier de ses souvenirs, de ses attentes, d’un retour impossible à la normale après le bruit et la fureur des combats. Il tente de se reconstruire en acceptant un travail de figurant dans un film. Peine perdue. On ne se délivre pas ainsi du réel : « Seulement le camp de tournage était différent de ce qu’il s’était imaginé. Au début, les choses s’étaient passées en douceur et il avait pensé que ça lui convenait, il s’était trouvé plus satisfait qu’il ne l’avait été depuis des années. Il lui avait paru presque possible, avec un peu de chance, de jouer sa petite pantomime personnelle dans le cadre de la fiction professionnelle et de se creuser un tunnel jusqu’à l’endroit où il s’était perdu, ou plus exactement jusqu’au trou noir, inerte, qu’il savait sommeiller en lui ».
Malgré les costumes et les décors « bidon », Day voit renaître ses peurs et ses vertiges. Day vit la guerre deux fois, la première dans la Royal Air Force, la seconde, en 1949, quand il fait de la figuration dans ce film centré sur la seconde guerre mondiale. Les deux sont des faits réels, attestés, le film auquel participe Day s’inspire de The Wooden Horse de Jack Lee (1950), dans lequel jouèrent d’anciens prisonniers de guerre. Le tournage rend encore plus flous et labiles les rapports du réel et de la fiction, impossibles les définitions du vrai. Ainsi lorsque Day, épuisé, s’évanouit en plein « simulacre d’Appell », la scène plaît tant au réalisateur qu’il la fait jouer à un acteur, « qui s’évanouit aussi. Il réussit sans doute beaucoup mieux que toi à être toi ».
Day est l’autopsie d’un désastre, d’une mémoire brisée qui fait coexister passé et présent, souvenirs et vécu, réel et imaginaire. Le roman dit le paradoxe de la guerre, ce moment où l’on se sent le plus intensément en vie, libre dans les airs, les sensations décuplées – « toi en plein dans une guerre (…) tu es si vivant, si infiniment, infiniment vivant » – et ce moment de déconstruction absolue de soi, dont on ne peut jamais se remettre tout à fait : « Ton cœur brisé, il n’est toujours pas guéri. Tu ne peux pas oublier, à cause des jours où, si tu te retournes trop vite ou changes de position dans ton lit, les fragments de ton cœur, encore tranchants, s’entrechoquent. Ça te fait tousser ».
Cette prose du cauchemar, sublime, incandescente, incantatoire, met à mal toutes les conventions du genre « roman de guerre ». Les combats ne sont pas décrits sous un angle héroïque mais sous leur versant intime, individuel. Nulle trace d’idéalisme grandiloquent dans ce texte. L’ouverture du roman rappelle d’ailleurs Un balcon en forêt de Julien Gracq, roman de l’attente vide, des cigarettes, de l’introspection, de la volonté de se conformer à une certaine image du soldat, collective comme personnelle, sans trop bien savoir ce que cela signifie. Day est dans cette quête identitaire : « Alfred n’allait certainement pas se mettre à parler comme Pluckrose, mais comme son moi modifié, comme ce qui lui paraissait ressembler le plus à ce que devait être un sergent Day ».
Il veut être ce sergent, « apprenant ses manœuvres, son nouveau personnage, l’homme au centre de la tourelle, le cœur de la mitrailleuse ». Cet homme qui voudrait choisir, trouver une liberté dans ses choix. Confronté à ceux que lui impose l’histoire : l’engagement, aimer une femme mariée à un autre soldat, se reconstruire. « Tu t’étais vraiment senti comme un personnage de roman et ça ne t’avait plus jamais quitté. L’idée que quelqu’un d’extérieur à toi imaginait, inventait, devinait, ça pouvait te faire paraître plus réel, plus apte à survivre »… Ces mots dont il a besoin, ces « mots qui n’avaient pas encore été inventés », ces « mots dont il ne savait pas qu’ils se cachaient déjà, tout prêt, sous sa peau », A.L. Kennedy les écrit.




La prose syncopée, immensément poétique d’A.L. Kennedy est une plongée dans l’âme d’un personnage, prisme d’un désastre intime comme historique. Day, en référence au D-Day, au jour le plus long, à la lumière du jour, à une identité morcelée. Le récit mêle trois moments, trois strates de conscience : avant la guerre (l’enfance, l’adolescence), pendant la guerre, après la guerre. Les trois moments se mêlent, se télescopent, s’enchevêtrent au point que, souvent, le lecteur se demande quand et où il est, comme « le personnage ». D’autant plus que chaque moment se décompose entre récit, pensées, dialogues et discours intérieurs (en italiques), vécu et souvenirs, rêves éveillés et cauchemars. Et que l’ensemble, narré du seul point de vue d’Alfred Day, est écrit le plus souvent à la deuxième personne du singulier.
Chaque moment est comme une étape dans la descente aux enfers : une enfance sous le signe d’un père alcoolique ; la guerre et son lot de morts, de sang, l’après-guerre dans ce camp « bidon » dans lequel Day se rend pour tenter de comprendre, de reprendre le contrôle de sa mémoire, de sa vie. L’histoire d’une Grande Evasion, par essence impossible, – « se creuser un tunnel jusqu’à l’endroit où il s’était perdu » – quand on n’est que physiquement un survivant de la guerre : « Le camp était en train de gagner, de le vaincre encore une fois, et il y avait des chiens à la lisière de ses rêves, qui se rapprochaient de jour en jour. ».
La guerre est ici tout autant réelle qu’imaginaire, extérieure qu’intérieure. Les blessures tout autant physiques que psychologiques. Comme être encore quelqu’un quand tout a été brouillé, dévasté par l’histoire ?
« Je ne fume pas.
- Tout le monde fume, monsieur Alfred.
- Alors, c’est que je ne suis personne, Basil ».
Day nous confronte à une réalité tout à la fois banale, monstrueuse et drôle. Un roman complexe, dense, profondément troublant. Nécessaire.
A.L. Kennedy, Day, traduit de l’anglais par Paule Guivarch, Editions de l’Olivier, 330 p., 23 €.
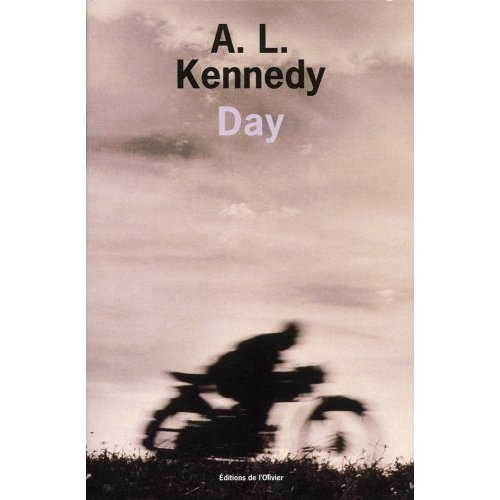
Photo : © http://www.a-l-kennedy.co.uk/



