La thèse de Burkert est différente et moins universelle. En effet, pour lui le sacrifice n’est pas le reflet et le réceptacle de la violence de la société, il est la violence même faite à l’animal, et cela depuis les temps préhistoriques où celui-ci était chassé. Son approche est évolutionniste, prenant en compte les données du paléolithique pour arriver jusqu’à l’Antiquité, et n’hésitant pas à se baser sur les résultats de l’éthologie. Si pour Girard, les mythes reflètent – si on sait les lire – la violence du meurtre rituel en le justifiant, pour Burkert, les rites sacrificiels gomment la violence par ce qu’il appelle une « comédie de l’innocence ». Pour la première théorie, la violence générale est assumée plus ou moins consciemment, pour la seconde, la violence envers l’animal est dissimulée. La première propose une clé pour saisir le sacrifice humain et animal, donc la violence humaine, la seconde cherche une origine au sacrifice animal.La communication de Smith est fort différente car l’historien ne reconnaît pas le sacrifice comme spécifiquement violent. S’appuyant sur une thèse plus ancienne, il comprend la pratique du sacrifice animal comme étant liée à la domestication des animaux. Si cela permet d’expliquer en partie ce type de sacrifice, il n’en est rien en ce qui concerne le sacrifice humain. La courte communication de Rosaldo est en quelque sorte là pour pallier ce manque puisqu’il évoque la pratique de la chasse aux têtes chez une population des Philippines. Ainsi, le sacrifice humain pourrait être lié à ce type de pratique entre la guerre et la vendetta – bien que cela repose surtout la lourde question du cannibalisme et que le sacrifice humain peut être tout aussi multiple que le sacrifice animal.
Le livre est très intéressant car il permet de mettre en interaction les théories et les approches diverses. Les discussions qui suivent chaque communication sont aussi stimulantes car non politiquement correct – il faut avouer que René Girard se défend particulièrement bien. Il comporte en outre un texte annexe de Burton Mack revenant sur les trois théories. Bref, avec cet ouvrage bien conçu, on a de quoi discuter l’explication de la violence par Girard.Si sa théorie paraît ne pas tenir compte des différents types de sacrifices – principalement les sacrifices d’offrande et les sacrifices apotropaïques de type bouc émissaire –, on peut toutefois reconnaître qu’il a courageusement mis l’accent sur une violence qu’on voudrait ne pas voir – certains spécialistes ont même tenté d’éluder la question du sacrifice violent chez les Aztèques… Pour autant, n’y a-t-il que violence dans le sacrifice ? Surtout, on pourrait lui reprocher de généraliser quelque chose qui ne l’est pas : pour qu’il y ait sacrifice, il faut des dieux ou des esprits, les aborigènes d’Australie n’en ayant pas, ils n’offraient pas de sacrifice. Ainsi, pratiquant la vendetta, ayant tout de même des crises de violence internes, ils n’en ont pas pour autant ritualisé le bouc émissaire.
La théorie de René Girard est également quelque peu déterministe car elle indiquerait que les hommes ne peuvent pas sortir de cette violence récurrente sans meurtre ritualisé ou symbolisé (christianisme). Or les événements actuels dans les pays arabes montrent des foules qui se rassemblent sans autre exigence que celle de la démocratie, sans vouloir à tout prix lyncher le dirigeant en place ou déplacer cette violence sur un bouc émissaire. Des actes de violence sont perpétrés – bien plus dus aux tyrans en place – mais ils n’obéissent pas forcément à ce schéma et l’action politique générale est bien éloignée de tout cadre religieux quel qu’il soit. Sa théorie est aussi fragile à la base. En effet, elle s’appuie sur une conception du désir bien particulière que Girard a identifié dans la littérature du 19ème siècle (voir son excellent ouvrage : Mensonge romantique et vérité romanesque). Or le désir n’est pour lui que mimétique : « Je réserve le mot désir pour ce qui arrive aux appétits et aux besoins naturels une fois qu’ils sont contaminés, voire intégralement supplantés, par l’imitation. Il s’ensuit que, pour moi, le désir proprement dit ne repose pas sur une base biologique spécifique et qu’on peut donc en faire une étude ‘phénoménologique’. »
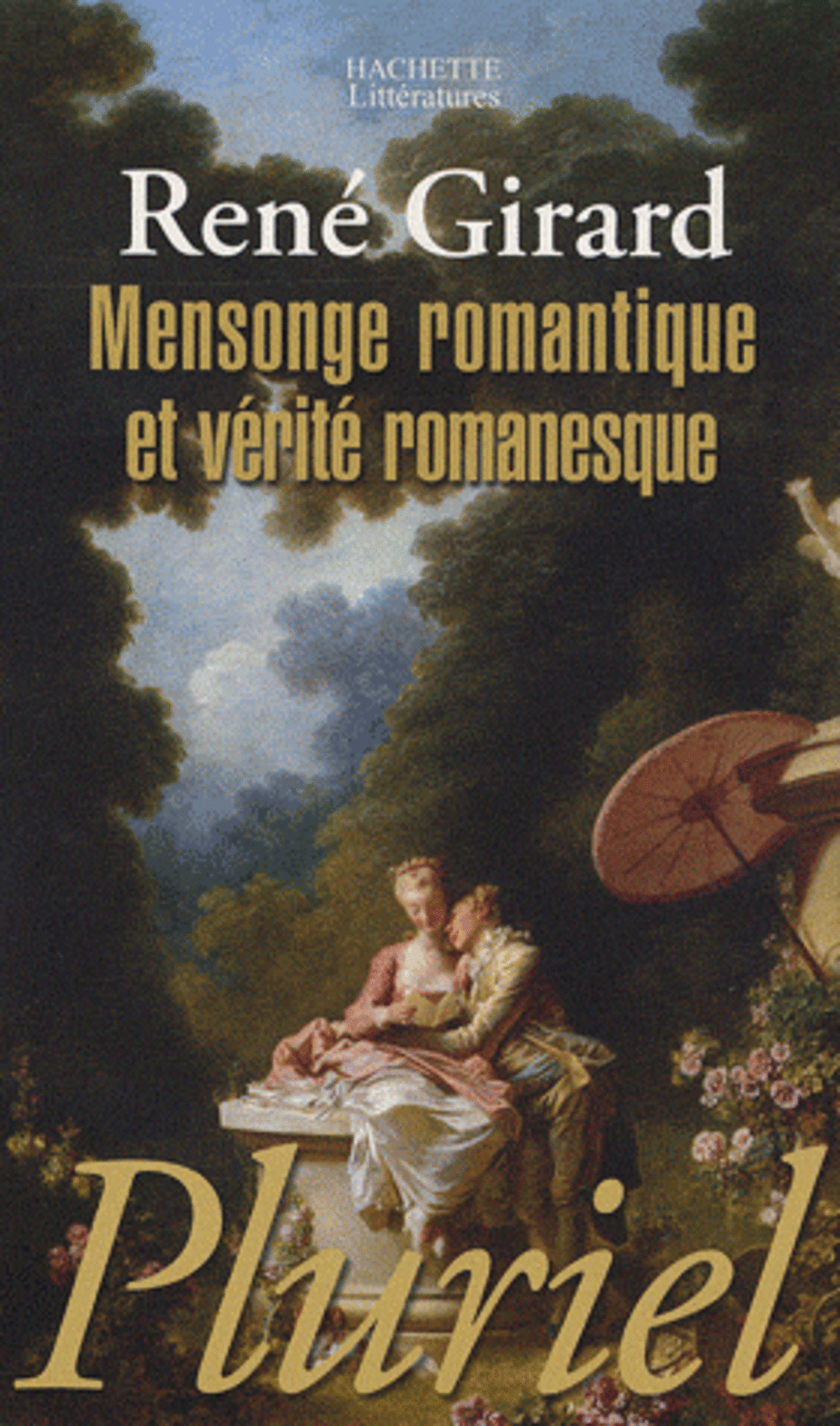
Puisque Burkert n’hésitait pas à s’appuyer sur l’éthologie et que Girard lui-même ne paraît pas distinguer en nature l’homme et l’animal, il serait bon d’interroger l’homme en tant qu’animal à partir, justement, de la question du désir : ne s’agit-il que d’un banal appétit ou bien d’un aspect déterminant pour l’individu et le groupe ? Or si le chimpanzé commun et l’homme ont bien un désir qui crée des rivalités, des enjeux de pouvoir et de territoire, ce désir est d’abord et avant tout une libido à assouvir, libido que les chimpanzés pygmées (bonobos) ont détourné pour en faire du lien social dans le groupe et même entre groupes, disqualifiant ainsi tout recours à un bouc émissaire et toute guerre potentielle (voir mon billet « A l’origine de la violence »). Dans cette optique, ce qui crée la violence, ce n’est pas la rivalité mais la difficulté d’assouvir son désir, la rivalité n’étant que la conséquence de cette difficulté et faisant naître dans le groupe la notion de pouvoir.
L’éthologie moderne, et plus particulièrement la primatologie, n’invaliderait pas totalement la théorie de Girard – violence il y a, rivalités il y a – mais elle la relativiserait considérablement : le désir n’est pas par essence mimétique, il le devient en fonction de l’organisation sociale du groupe, et ce n’est pas le mimétisme lui-même qui conduit à la violence mais le désir à assouvir comme enjeu. Si Girard nous met face à notre difficulté pour saisir pleinement la violence humaine, il semble quant à lui avoir des difficultés à reconnaître le désir pulsionnel chez l’homme, c’est pourquoi sans doute sa lecture de Freud a consisté à contourner tout ce qui relevait de la libido pour ne conserver que ce qui est le plus contesté, c’est-à-dire les essais anthropologiques à partir de la psychanalyse (Totem et tabou).
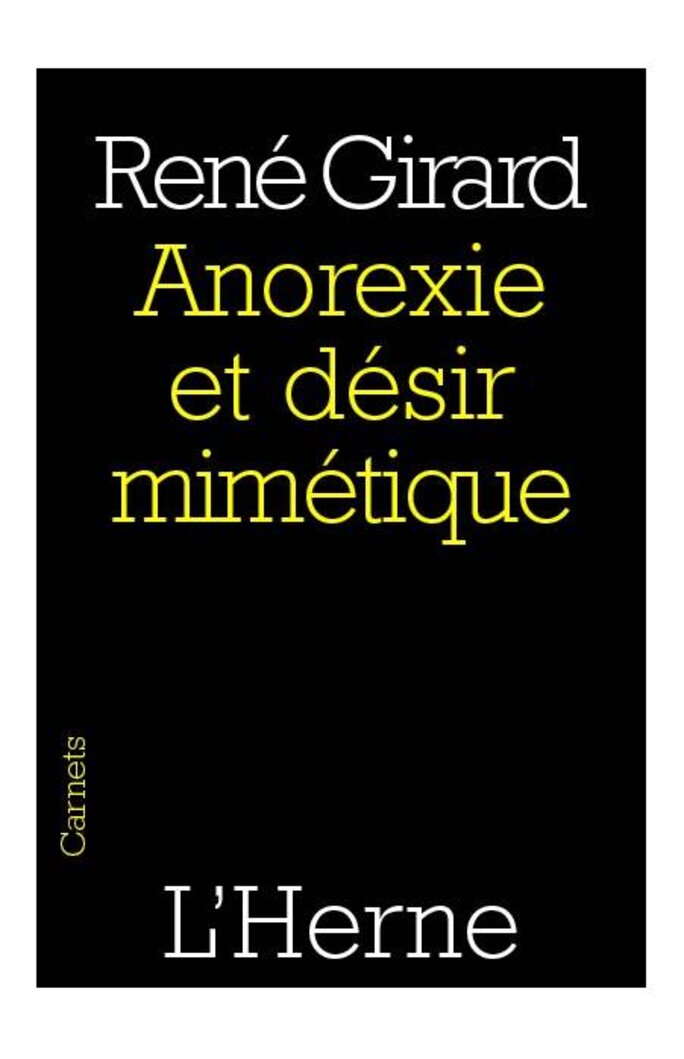
Agrandissement : Illustration 2
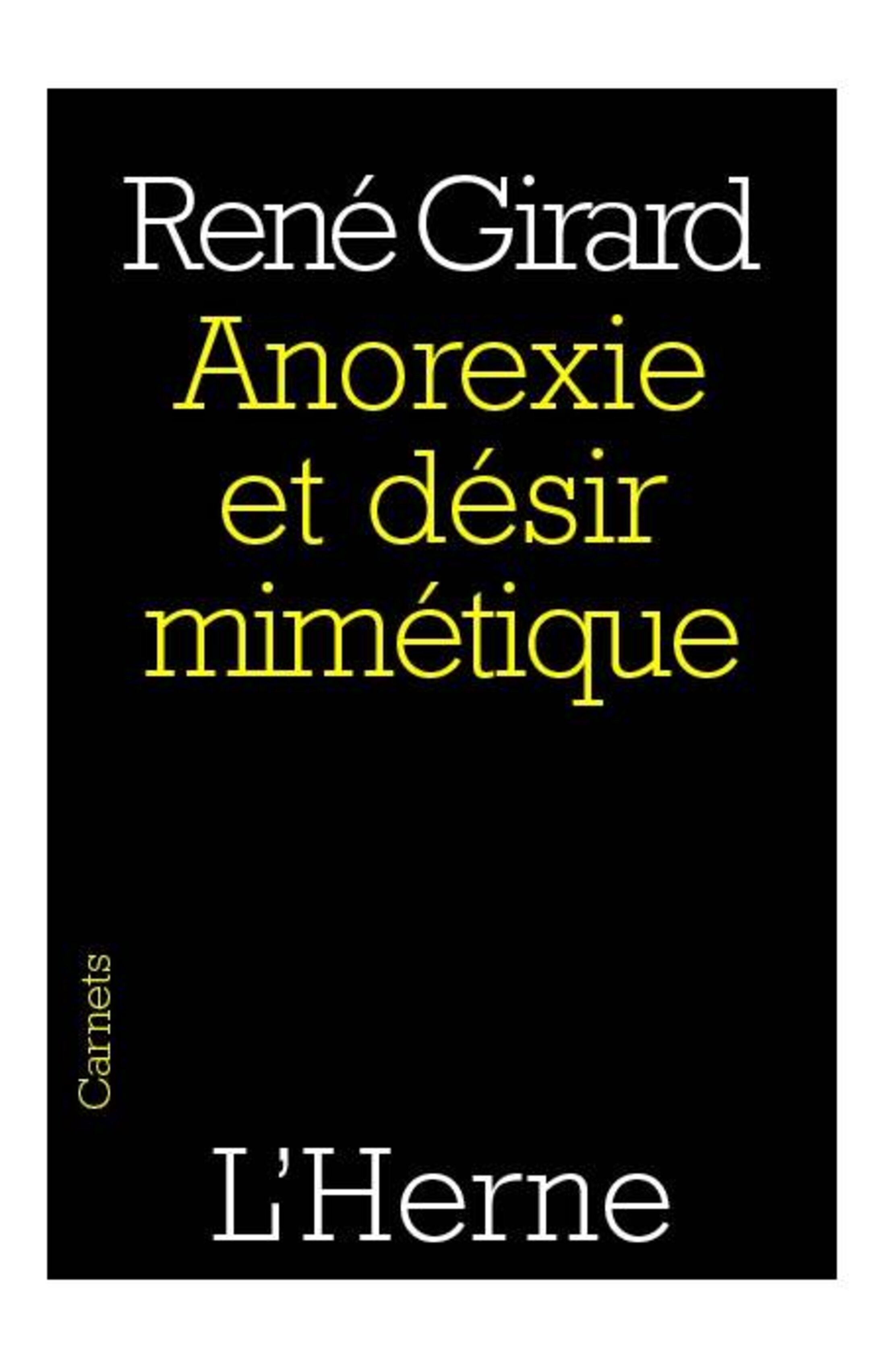
D’ailleurs, son petit essai sur l’anorexie visant à comprendre cette maladie par le seul désir mimétique a dû laisser bien dubitatifs les psychanalystes : s’il y a un tabou de la violence, il y a aussi un tabou du désir, et le désir mimétique en est une expression – de même que le désir romantique de la littérature où Girard a puisé pour élaborer sa théorie. Et dire cela, c’est redonner du crédit au Malaise dans la civilisation de Freud.René Girard [et alii], Sanglantes Origines, Paris, Flammarion, 2011 [Violent Origins, 1987], 23 euros.



