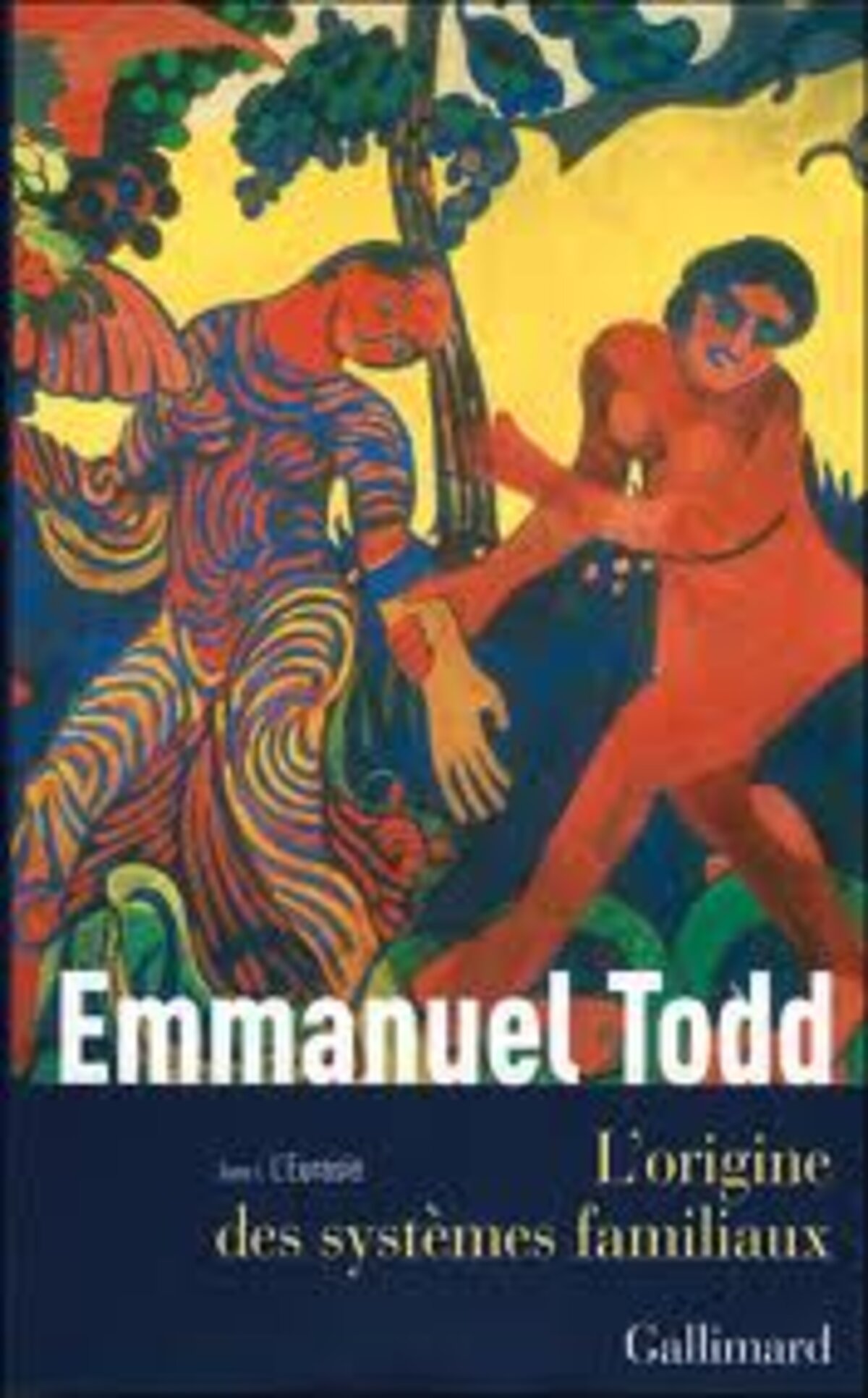
L’ouvrage d’anthropologie de la famille que vient de publier Emmanuel Todd porte en lui une véritable révolution. En effet, non seulement il remet en cause les approches structuralistes sur le sujet mais il met en évidence une évolution qui prend à rebours l’évolutionnisme habituel : ce que l’on croit moderne serait en fait primitif, premier.
Il n’est évidemment pas possible de résumer un ouvrage de plus de sept cents pages en quelques paragraphes. Aussi vais-je m’attacher à trois aspects : la typologie proposée par Todd (ch 1, p. 45-83), l’étude du Moyen-Orient ancien (ch 12, p. 521-590) et la réflexion épistémologique sur la parenté en regard de l’ouvrage de Maurice Godelier, Métamorphoses de la parenté (Fayard, 2004).
I. TypologieAvant d’en venir à la typologie véritable, il faut d’abord dire la pertinence et la clarté de l’introduction (p. 13-44) – l’ouvrage illustre parfaitement l’adage qui veut que ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. Dans cette introduction, Todd retrace quelque peu son parcours universitaire à Cambridge tout en critiquant l’approche structuraliste finalement plus ou moins consciemment évolutionniste puisqu’elle suppose des stades de développement (p. 22). Surtout, il présente une loi linguistique quelque peu négligée et applicable au champ anthropologique de la parenté : le principe du conservatisme des zones périphériques (PCZP), qui permet de distinguer des zones géographiques périphériques de conservatisme des structures familiales et des zones centrales d’innovation. C’est ce principe qui permet le renversement de nos idées reçues car ce que nous considérons comme un type familial archaïque – par exemple, communautaire basé sur un système patrilinéaire polygamique – se révèle être le moins ancien et donc le plus innovant tandis que la famille nucléaire réputée moderne est en fait première. C’est à tort que nous attribuons la fameuse exclamation « Eurêka ! » aux seuls scientifiques des sciences dites dures, car Todd a bien fait un tel type de découverte dans le champ des sciences sociales.
La typologie retenue en matière d’organisation familiale se veut souple et ouverte, basée sur celle de Le Play au dix-neuvième siècle. Il s’agit d’« admettre une plus grande complexité » sans que cela mène à un « suicide méthodologique » (p. 72). C’est ainsi que l’on a plusieurs types de familles nucléaires, de familles souches et de familles communautaires. Deux aspects me semblent importants à souligner : d’une part, Todd souligne le fait que sur le terrain ethnologique, la proximité et la concentration des familles nucléaires a souvent eu tendance à faire penser à une famille étendue, renforçant le présupposé évolutionniste, d’autre part, que la sédentarisation n’a sans doute pas grand-chose à voir avec les structures familiales, favorisant d’ailleurs plutôt des formes complexes que la forme simple nucléaire.
II. Le Moyen-Orient ancien
Après avoir étudié l’ensemble de l’Eurasie dont le Moyen-Orient récent, n’hésitant pas à entrer dans la complexité et l’immensité de la Chine et de l’Inde, Emmanuel Todd se lance dans l’étude du Moyen-Orient ancien et, notamment, de la Mésopotamie des IIIe-Ier millénaires. L’audace d’une telle démarche ne s’explique et ne se comprend que par la volonté d’embrasser in extenso un phénomène. S’appuyant sur les spécialistes actuels les plus réputés de Babylone (Dominique Charpin, EPHE) ou de la cité de Mari (Jean-Marie Durand, Collège de France), Todd en vient à énoncer quelques hypothèses – la documentation ancienne en cunéiforme a beau être importante, elle ne permet toutefois pas d’établir des statistiques chères au démographe de l’INED – bien intéressantes pour l’historien : « La famille nucléaire aurait été remplacée à Sumer par une forme souche selon une évolution endogène (...). Le passage au stade communautaire (…) aurait été rendu possible, comme en Chine, par l’irruption conquérante du système généalogique nomade, symétrisé » (p. 558). Et c’est dans ce contexte évolutif que le statut de la femme aurait été considérablement revu à la baisse alors que, dans le même temps, ce statut restait élevé dans l’Égypte pharaonique régie encore par la famille nucléaire (p. 561-579). Todd interprète ainsi l’imposition du voile aux femmes dans l’Orient préislamique (en Assyrie à la fin du IIe millénaire) comme il interprète la pratique des pieds bandés en Chine : une marque de domination masculine propre à la famille patrilinéaire devenue communautaire. Mais, selon lui, cette domination aurait été atténuée par la pratique du mariage endogame.
Le fait difficile à interpréter dans ce contexte est le fait semi-nomade. En effet, Todd n’ignore pas la présence importante d’Amorrites dans cette aire géographique. Or l’importance du lignage patrilinéaire le conduit à penser à une influence amorrite légitime sur les systèmes familiaux sédentaires (p. 558-560). Cela sous-entend donc que les semi-nomades pasteurs avaient depuis bien longtemps remplacé la famille nucléaire par des structures permettant l’indivision du patrimoine. Ainsi, le schème évolutif proposé par Todd invalide tout évolutionnisme simpliste entre nomades et sédentaires. Cependant, on peut se demander si ce fait nomade du Moyen-Orient ancien – et récent puisqu’il n’est pas sans rappeler les structures familiales des tribus bédouines – ne requiert pas des approches qui lui soient propres. Sans nier la validité de l’approche de l’anthropologue-démographe, on reste un peu dubitatif devant le peu de cas qu’il fait de la notion de culture – en Arabie, le voile est un attribut féminin et masculin même s’il couvre la tête sans masquer le visage de l’homme – et de l’organisation d’une société, comme on lui pardonnera son imprécision conceptuelle lorsqu’il amalgame trop lestement structuralisme lévi-straussien et fonctionnalisme durkheimien. On lui pardonnera également sa candeur lorsqu’il énonce les principaux « faits » de l’histoire sainte (p. 474) puisqu’il se trouve incapable de situer les « Hébreux » dans le champ moyen-oriental étudié, de même l’interprétation de la primogéniture dans l’Israël ancien dans un contexte de culte exclusif sacrificiel (p. 542). Assurément, c’est dans un cadre de culture semi-nomade amorrite puis araméenne – et de populations apparentées – qu’il eût été préférable d’intégrer les conceptions bibliques.
III. La parenté aujourd’huiDans son ouvrage de 2004, Godelier – l’anthropologue qui « mouille sa chemise » – était revenu avec rigueur et esprit critique sur la conception de la parenté chez Lévi-Strauss. En effet, il avait dénié toute validité au principe de la prohibition de l’inceste comme marqueur culturel de l’humanité – préjugé philosophique typique, et Lévi-Strauss avait une formation de philosophe – étant donné que les éthologues ont depuis remarqué que cette prohibition n’est pas le propre de l’homme – mais, comme le souligne Godelier, il ne faut pas y voir « un mécanisme purement biologique destiné à prévenir les conséquences génétiquement néfastes d’union sexuelles consagnines », car « aucune preuve décisive n’a encore été avancée à l’appui de cette assertion » (p. 453), si ce n’est l’absence de dégénérescence génétique dans des cultures endogames multimillénaires. Il avait également remis en cause l’analyse de la parenté par le grand anthropologue uniquement considérée dans l’optique d’une alliance exogamique consistant en un échange de femmes entre les hommes. Ainsi, L.-S avait négligé la notion de descendance et refusé donc de considérer le mariage endogame dans les structures patrilinéaires arabes, ce que Todd aborde avec beaucoup de rigueur, ne faisant plus du cas arabe un cas atypique quasi inexplicable dans les études de la parenté. Mais l’approche de Godelier, bien que fondée elle-même sur un « propre de l’homme » contestable, n’avait pas consisté qu’en une remise en cause de la parenté classique chez les anthropologues, il s’était aussi beaucoup interrogé sur les nouvelles formes de parenté dans nos sociétés comme l’homoparentalité dont on parle tant désormais.
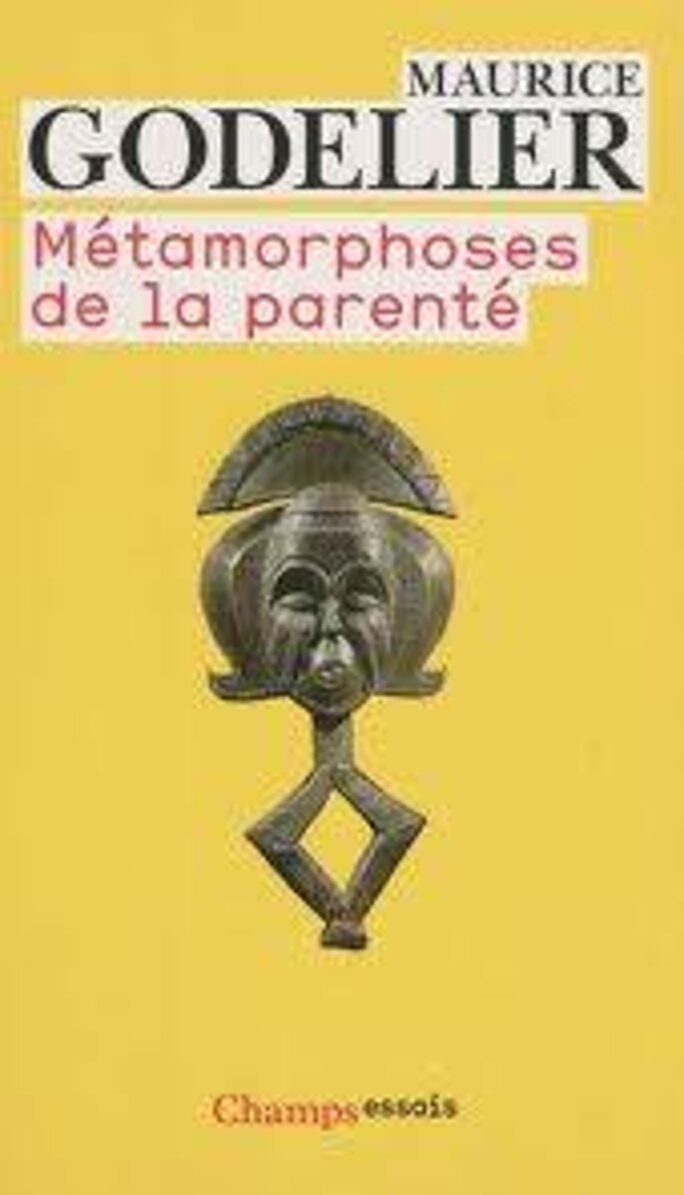
Si l’ethno-anthropologue s’est interrogé avec profit sur les nouvelles formes de parenté, Todd met en lumière, par son approche quantitative et historique, les formes traditionnelles et notamment la forme arabo-musulmane qui fait tant débat. Il nous permet de nous défier de toute conception simpliste de la modernité car la forme familiale réputée la plus moderne se révèle en fait être la plus archaïque. Si nous devons toutefois la préférer, c’est parce qu’elle a en germe un trait moderne consistant en l’égalité des conjoints. Mais, comme il le ponctue avec suffisamment d’insistance, la famille communautaire, patrilinéaire endogame, du monde arabe a peu à voir avec l’islam (p. 519-520), elle évolue de toute manière puisque les populations de ces cultures ont toutes entamé – charia ou non – leur transition démographique (baisse de la mortalité) pour entrer dans un régime démographique moderne (natalité basse), annonçant le printemps arabe et annoncé dans le précédent ouvrage de Todd avec son collègue Courbage (Le rendez-vous des civilisations, Seuil, 2007).
L’approche mondiale que le démographe a des systèmes familiaux nous fait songer à celle du socio-anthropologue Alain Testart étudiant à cette échelle les types de société (Éléments de classification des sociétés, Errance, 2005) et qui, semble-t-il, prépare lui aussi une somme à venir. Y a-t-il une comparaison à mener entre types de sociétés et systèmes familiaux ? On aimerait que les grands spécialistes de ces questions entrent plus souvent en dialogue dans la presse écrite.
Emmanuel Todd, L’Origine des systèmes familiaux. Tome I. L’Eurasie, Gallimard essais, 2011, 755 pages, 29 euros.



