Ce peuvent être des objets – La Porte – des éléments – L’Arbre – la magie ou le piment d’un instant, auxquels les effets propres à la nouvelle (brièveté, concentration) donnent une portée symbolique.
Dans La Porte, une jeune femme se voit contrainte de remplacer une porte de service après un cambriolage, quelques mois après un enterrement auquel elle n’a pas assisté car « mon bien aimé disparu était marié, bel et bien marié » :
« J’étais devenue un fantôme dans ces pièces, invisible, nerveuse, parlant toute seule, laissant en suspens mes phrases à moitié finies. […] Je n’étais pas folle, j’étais bouleversée, ébranlée jusqu’au fond de moi-même quand je me rappelai ce qui s’était passé. Mon esprit se comportait comme un feu de joie, nourrissez-le d’un petit souci bien sec et craquant et il s’embrasait ».
Et la nouvelle suit la manière paradoxale dont la commande puis l’installation d’une porte vont permettre à cette femme, sinon de surmonter le deuil, du moins de retrouver pied dans le réel, à l’image de cette porte qui doit rester ouverte quelques heures pour sécher. Métaphore de la capacité nouvelle de cette femme à s’exprimer, à sortir de sa douleur et ne plus « ressasser jusqu’à l’obsession, remâcher sans jamais digérer ».
Toutes les nouvelles du recueil reflètent cette densité sous l’apparente banalité, avec en fil rouge une réflexion sur le temps, les changements infimes, la mort et sa présence venant troubler le quotidien. Ainsi la jeune femme de La Vie amoureuse de l’infirmière que les images aux infos de la guerre en Irak empêchent de vivre et d’aimer. Ainsi l’épidémie de cancers d’Une pensée sur trois : « C’est arrivé sans prévenir. Un jour, tout le monde a commencé à mourir », comme si la mort soudaine, imprévisible, précoce, injuste était devenue « une épidémie, une atroce maladie contagieuse ». Le mari de la narratrice en plaisante : « ces choses arrivent par vagues, tu sais, c’est comme les autobus, aucun pendant une éternité, puis trois à la fois ». La narratrice, elle, vit dans cette obsession de la mort qui rôde, dans ce climat délétère, relevant les cas d’amis décédant subitement, les manières de vivre plus sainement, les pourcentages, les vertus du bio, dans un pessimisme si fort qu’il en devient presque drôle, qu’il signe en tout cas du sens de la dérision de l’auteur :
« Bien sûr j’aurais pu aller chez le médecin et lui demander des antidépresseurs ou de quoi me remonter le moral, mais bon, il me semblait que ce n’était pas moi le problème. C’était tout le reste, toutes ces choses atroces qui arrivaient partout. C’était le système dans son ensemble. Le problème était là ».
Et, ironie de l’histoire, c’est justement en se faisant heurter par un autobus, et en perdant une jambe, que la narratrice retrouve le goût de la vie et perd cette conscience obsédante de la mort.
Le registre adopté par Helen Simpson dans ce recueil est extrêmement particulier : on pourrait la croire dans une empathie totale avec ses personnages. Elle semble épouser leurs flux de conscience (ses personnages méditent beaucoup dans les embouteillages ou en se promenant), mais la distance est là, dans l’ironie, dans la structure même du texte : ainsi lorsque Tom, dans Si je m’en tire, correspondant de guerre, grand reporter, se croit atteint d’un cancer des poumons. Il menait jusqu’alors une vie faite d’adrénaline, de voyages, d’égoïsme, dans la satisfaction immédiate de ses plaisirs et de ses pulsions. L’annonce de sa maladie le conduit à reconsidérer les priorités de sa vie : la présence de sa femme qui l’irritait le réconforte, il décide de s’occuper un peu de sa petite fille qu’il a si peu vu grandir. Il découvre l’introspection, la valeur nouvelle des choses et des mots :
« Il était fasciné par ce coup du sort, ne savait comment le prendre, comment l’absorber, quelle attitude adopter. Il était habitué aux catastrophes, mais uniquement aux catastrophes des autres. Maintenant il en avait une bien à lui. Qu’êtes-vous censé dire dans cette situation, n’y a-t-il pas une phrase toute faite ? J’ai bien profité de l’existence, voilà, pour montrer que vous prenez les choses du bon côté. Non, il ne pouvait pas dire ça ».
Mais le cancer n’est qu’une tuberculose… et Tom reprend sa vie d’avant. Si Tom n’a rien compris, le lecteur lui reçoit une leçon de vie, implicite, jamais pesante, en creux dans la nouvelle.
Helen Simpson s’attache ainsi aux tout petits riens qui tissent le quotidien, lui donnent sens. Elle soulève les voiles et s’attache tout particulièrement à ce que recouvre l’apparente platitude des expressions toutes faites, aux pulsions souterraines des non-dits dans les euphémismes :
« Pour finir, [Tom] inhala la fumée avec volupté et joua avec quelques clichés utiles. « J’ai besoin d’espace » était une expression tellement stéréotypée, tout comme « J’ai besoin d’un peu de temps pour moi », l’employer en ce moment dénotait un manque total d’imagination. « La vie n’est pas une partie de plaisir » était plus intéressante car, bien que largement plus utilisée comme échappatoire, elle signifiait en réalité : « Je vais accomplir quelque chose d’incroyablement brutal et mal venu ». Non, l’euphémisme le plus élégant était probablement : « il est temps d’aller de l’avant ». Pas mal, s’il fallait en arriver là. Digne, précis, une façon épatante de se disculper. Il est temps de passer à autre chose. Il n’y avait aucune réponse à cela ».
Les nouvelles proposent aussi des réflexions centrées sur le couple, la condition des femmes, le rapport masculin / féminin aux choses, souvent en une phrase lapidaire ou un court paragraphe. Helen Simpson ne s’appesantit jamais, et l’on conçoit que la nouvelle soit son mode d’écriture et presque de respiration*. Ses textes interrogent la question d’une différenciation possible entre la mémoire de l’ordinaire et la mémoire de l’exceptionnel (Tôt dans la matinée), creusent tout ce qui tisse un sens, présent ou a posteriori. Comment tenons-nous, supportons-nous le quotidien ?
L’Arbre offre une superbe double métaphore pour y réfléchir, une métaphore qui peut être lue comme une allégorie, celle du lierre qui tient artificiellement debout un mur pourtant sur le point de s’écrouler et inversement celle de la moisissure qui opère un travail souterrain dans le mur jusqu’à sa destruction :
« Bon, un architecte conseil doit vraiment s’inquiéter. Il est là pour ça, s’inquiéter. C’est son boulot. C’est à lui de déceler la fissure imperceptible qui obligera à recourir à des soutènements dans cinq ans. Tu vois cette tâche d’humidité ? Elle cache de la moisissure, qui va se transformer en pourriture sèche dont tu peux être sûr qu’elle se répandra à son tour dans la maison comme un cancer. Il faut dégager la maçonnerie si ça devient sérieux.
Lorsque vous visitez une maison pour la première fois, vous voyez immédiatement tout ce que vous devez savoir, à condition de bien regarder. C’est la même chose entre un homme et une femme à leur première rencontre. Vous savez tout dès le début, si vous êtes attentif. Et au cours du temps, ce sera le premier regard sévère, la première petite vacherie qui mettra à nu les défauts structurels ».
Les textes qui composent Le Jeu de l’horloge s’attachent tant au lierre qu’aux moisissures.
Comment nous débarrasser de nos « chaînes imaginaires » ? Comment (sur)vivre malgré le deuil, la colère, la maladie, le poids du passé que nous nous sommes construit ?
« Je suis de plus en plus consciente, lorsque je rencontre des gens pour la première fois, qu’à la minute où ils disent bonjour, ils s’exposent devant moi comme des diagrammes scientifiques qu’ils expliquent alors, spécimens compliqués, analysés et résumés avec leurs propres mots. Ils parlent de leur passé dans le moindre détail, me racontent leur histoire, et ensuite – c’est ce qu’on entend par intimité aujourd’hui – ils me demandent de leur narrer la mienne. J’ai essayé. Mais j’en suis incapable. Cette histoire-là, elle semble toujours avoir été trafiquée. Et comment pourrait-elle être autre chose que la version actuelle ? » (Une promenade de santé).
Pour aller au-delà, il nous faut nous regarder dans un miroir, au sens concret comme abstrait, ainsi que le met en lumière La Chambre verte, jouant de la polysémie de l’expression lorsqu’une créature étrangement surgie d’Internet, Holly, vient présenter, dans un miroir, différentes facettes de ce que fut, est et sera Paula.
Le Jeu de l’horloge est ce « miroir psychique », décapant.
Helen Simpson, Le Jeu de l’horloge [Constitutional], traduit de l’anglais par Anne Damour, éditions Christian Bourgois, 160 p., 17 €
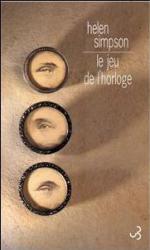
* Encore trop peu connue en France, Helen Simpson, qui vit à Londres, est l’auteur de quatre recueils de nouvelles : Four Bare Legs and other stories, 1990 (Quatre jambes nues, 1992) – Dear George, 1995 – Hey Yeah Right Get a Life, 2001 et Constitutional, aujourd’hui traduit aux éditions Christian Bourgois. Elle a reçu de nombreux prix en Angleterre et aux Etats-Unis et a été retenue, en 1993, sur la liste des vingt meilleurs jeunes auteurs britanniques de la revue Granta – qui publie une liste tous les 10 ans.



