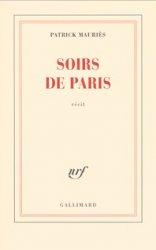Patrick Mauriès aime les « vies remarquables », les « cabinets de curiosités », il offre ici deux lieux comme espaces de rencontres, analogiques, écholalies, lignes de fuite. Deux récits comme ces « peut-être » en anaphore finale du Nietzsche à Nice. « Il y aurait un livre à écrire ». Il y a deux récits à lire.
La promenade, l’errance sont modes d’écriture, de pensée, donc de lecture. C’est un double itinéraire que nous propose Patrick Mauriès avec la publication ces courts récits, Nietzsche à Nice, Soirs de Paris, à lire en échos subtils, ou de manière singulière, dans la liberté absolue de dilettantes, le caprice de lecteurs invités à l’art des conversations intimes, des croisements, des souvenirs. Tout est ici pluriel, effleurement, sans fixité. Une manière de lire dont Nietzsche, découvrant Dostoïevski à Nice, donnerait la clé :
« Pour moi, il en va de Dostoïevski comme autrefois de Stendhal ; le contact le plus fortuit, un livre feuilleté dans une librairie, un auteur dont on ne connaît que le nom, et soudain un brusque instinct vous avertit que vous avez trouvé un parent ».
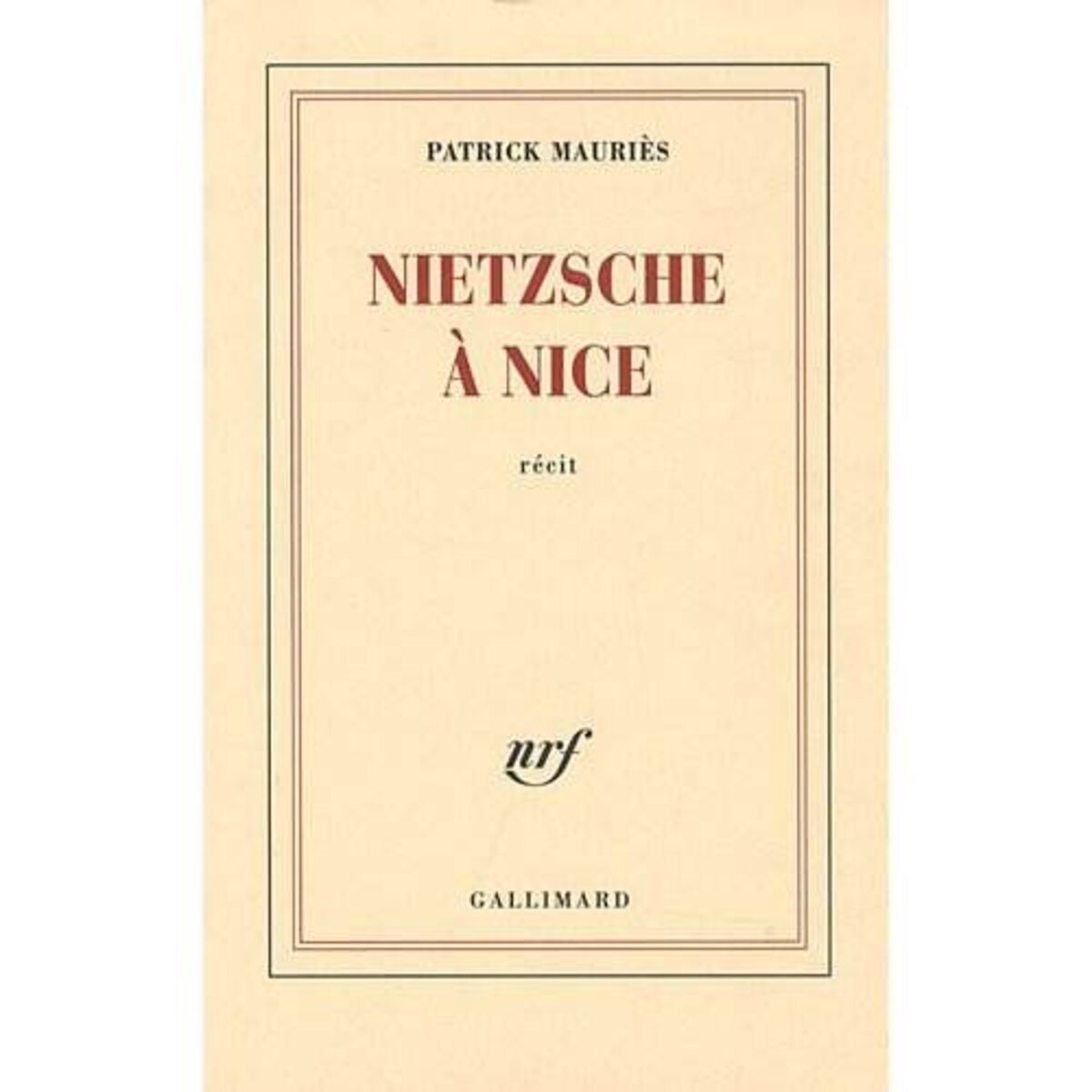
Nietzche à Nice s’offre comme une rêverie, un acte manqué. Mauriès raconte dans les premières pages de son récit comment Guyau est apparu dans sa vie, il y a une dizaine d’années, « au détour d’une page », au hasard d’une lecture, le Nietzsche de Daniel Halévy. La rencontre sonne comme une évidence, le manque creuse le désir de connaître. Mauriès cherche, lit, annote, copie. Perd le cahier qui reconstituait peu à peu le portrait « lacunaire » du philosophe - autrefois salué, lu, réédité, aujourd’hui méconnu –, rejeté dans l’oubli par cette perte, la « figure s’évanouit laissant une trac légère, comme un dessin sur la buée, un sillon de regret, la promesse – l’alibi ? – d’y revenir un jour ».
Il y revient dans Nietzsche à Nice, récit né de la perte, de l’absence et de la trace, récit où chaque élément se fait l’écho d’un autre : Guyau alter ego de Nietzsche, lui-même expression de Nice, « traduction naturelle de sa couleur et de son rythme », de sa lumière africaine, ville du surgissement des fantômes, d’une mélancolie particulière, éclatante. « Nice trouve en Nietzsche son style même ».
Le récit est rêverie, broderie, tissage, roman d’une ville, prose de noms, portraits croisés : celui de Nietzsche, ouvert, affiché, dont des lieux portent la trace (il a donné son nom à un chemin sur la corniche, des plaques rappellent où il vécut), celui de Guyau, l’oublié, celui de Mauriès, en creux, tous se retrouvant, affinités électives, dans une librairie au nom prédestiné : Visconti.
Nice se donne comme le croisement « géométrique » de désirs, d’itinéraires, « une sorte de précipité », « un lieu catalysant tous les possibles » : Nietzsche, « philosophe errant », Guyau le nomade, Mauriès, promeneur, tous trois pris dans une « poursuite vitale », dans un rapport esthétique à l’espace qu’il soit le monde ou le livre (est-ce si différent, d’ailleurs ?).
Le désir est le seul maître de cette prose qui croise rêverie et recherches, réel et imaginaire, qui mêle des proses, récit et citations. Un texte délicat, somptueux, chatoyant.
« On n’est frappé que de ce qui vous rappelle quelque chose tout en différant. Comprendre, c’est, du moins en partie, se souvenir ».
« Un livre n’ouvrant jamais que sur un autre livre », comme l’écrit Patrick Mauriès dans Nietzsche à Nice, on ouvre alors Soirs de Paris. Au titre comme un parfum suranné, comme un lointain écho d’un Barthes posthume. Après la lumière africaine de Nice, les nuits parisiennes, les errances d’un homme abandonné par son amant. La promenade devient déshérence, adresse directe à « mon amour » perdu, en un hiver qui est une saison de l’âme, détresse, appel de la douleur comme seul lien qui encore attache à l’être aimé. La perte est fuite en avant, autre forme de marche :
« Marcher donc inlassablement, parcourir sans but et jusqu’à épuisement rues et quartiers désertés de la ville, le dimanche ».
Parcourir Paris pour se perdre, oublier ; nommer des rues, des lieux, croiser silhouettes et fantômes, passer des frontières. « J’en étais réduit à revenir inlassablement sur ces métaphores de la réalité aux portes de laquelle tu m’avais laissé, maigres traces de la vie qui s’était, le jour de ton départ, définitivement arrêtée ».
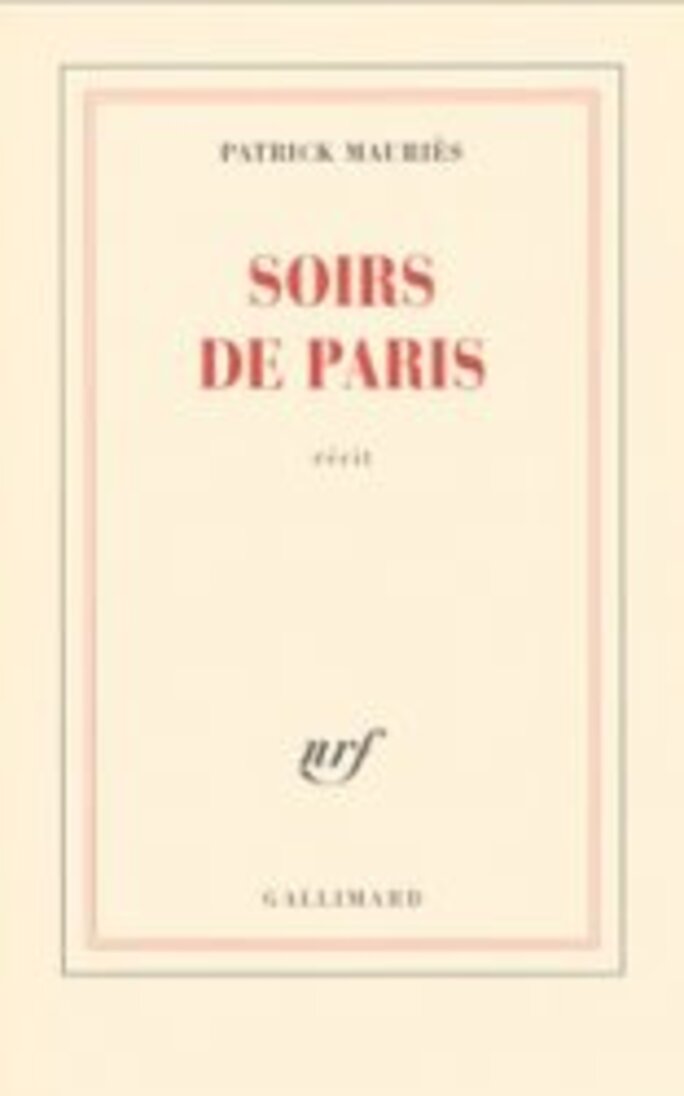
La promenade n’est plus alors liberté mais contrainte, chemin de croix, labeur. La halte dans un café un ancrage de solitude et d’isolement. Un magnétisme aussi, une « routine obstinée » qui pousse les habitués « invinciblement », « à revenir à heures fixes, et à jours donnés, autour de ce comptoir ». Surgissent alors des êtres mi réels mi fantasmés qui font naître souvenirs, fantômes et anecdotes. Warhol, Barthes passent, présences fugitives et obsédantes, manières obliques de mener le portrait de l’absent. Mais aussi, pour Mauriès, de se dire, de se retrouver, comme Barthes, « être de frontière, irrégulier » : « S’en tenir à sa part d’irrégularité, faire de cette impossibilité à se laisser décrire, à rentrer dans le rang, de la manière la plus douce, une valeur de vie et de création ». A l’image de ces deux récits, également inclassables, irréguliers, portraits en échos et miroirs, en ombres portées. Excentrés et excentriques.
Patrick Mauriès, Nietzsche à Nice, Gallimard, 68 p., 10 €
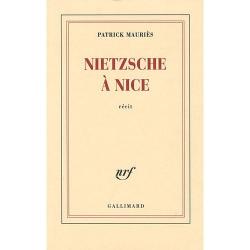
Patrick Mauriès, Soirs de Paris, Gallimard, 67 p., 10 €