« Santiago Boroní est devenu fou quelque part entre Tel-Aviv et Safed, je ne sais pas exactement où, et je n’ai pas cherché à le savoir, au fond peu importe ». Première phrase, premier choc. Un roman qui vous attrape, ne vous quitte plus, vous hante pendant près de 300 pages, vous transporte aux frontières d’Israël et de la Palestine, de la normalité et de la folie, du réel et de l’imaginaire, du deuil et de la reconstruction.
300 pages de perte des repères, d’entrée dans un univers romanesque d’une densité rare.
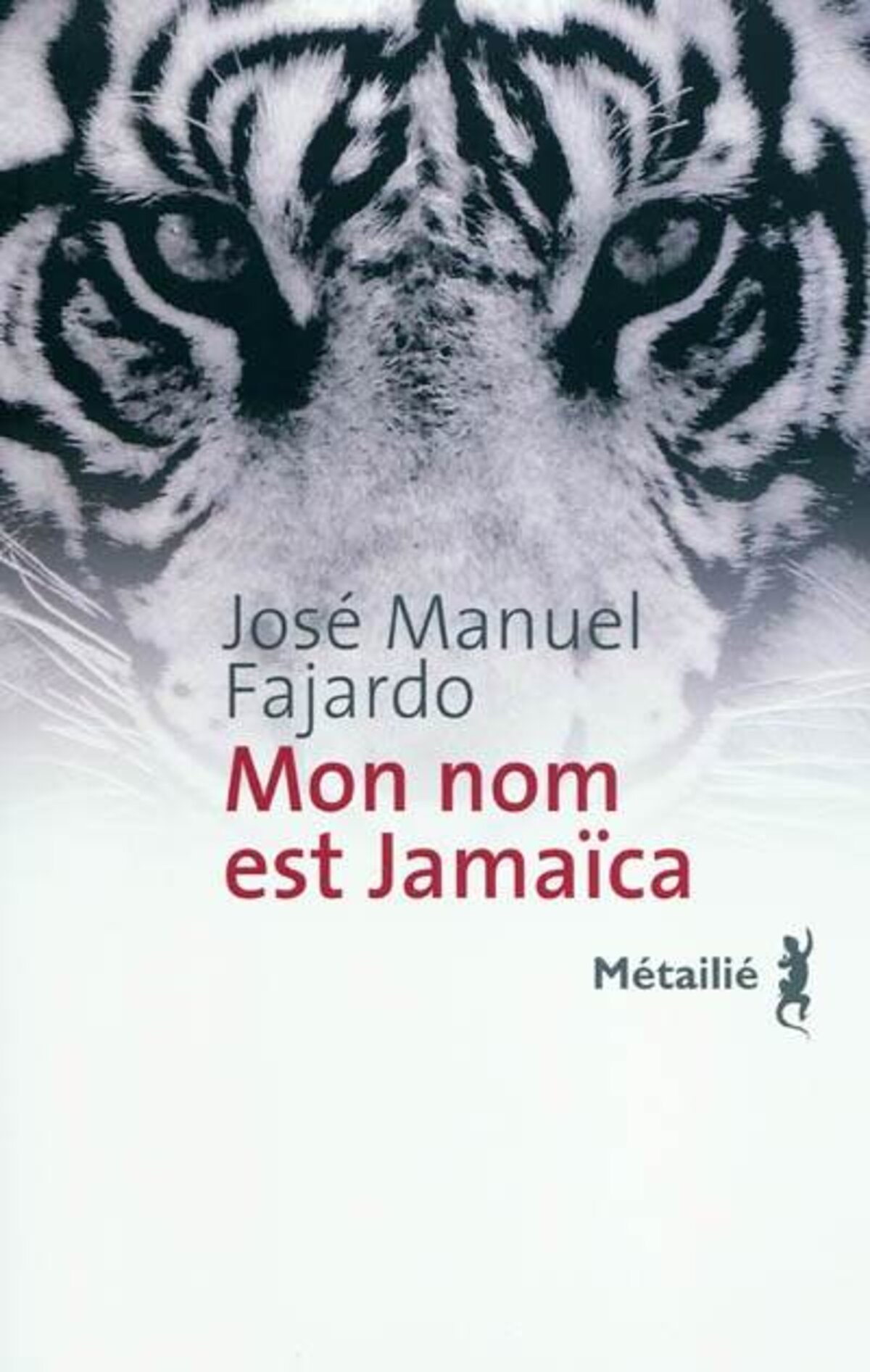
Agrandissement : Illustration 1
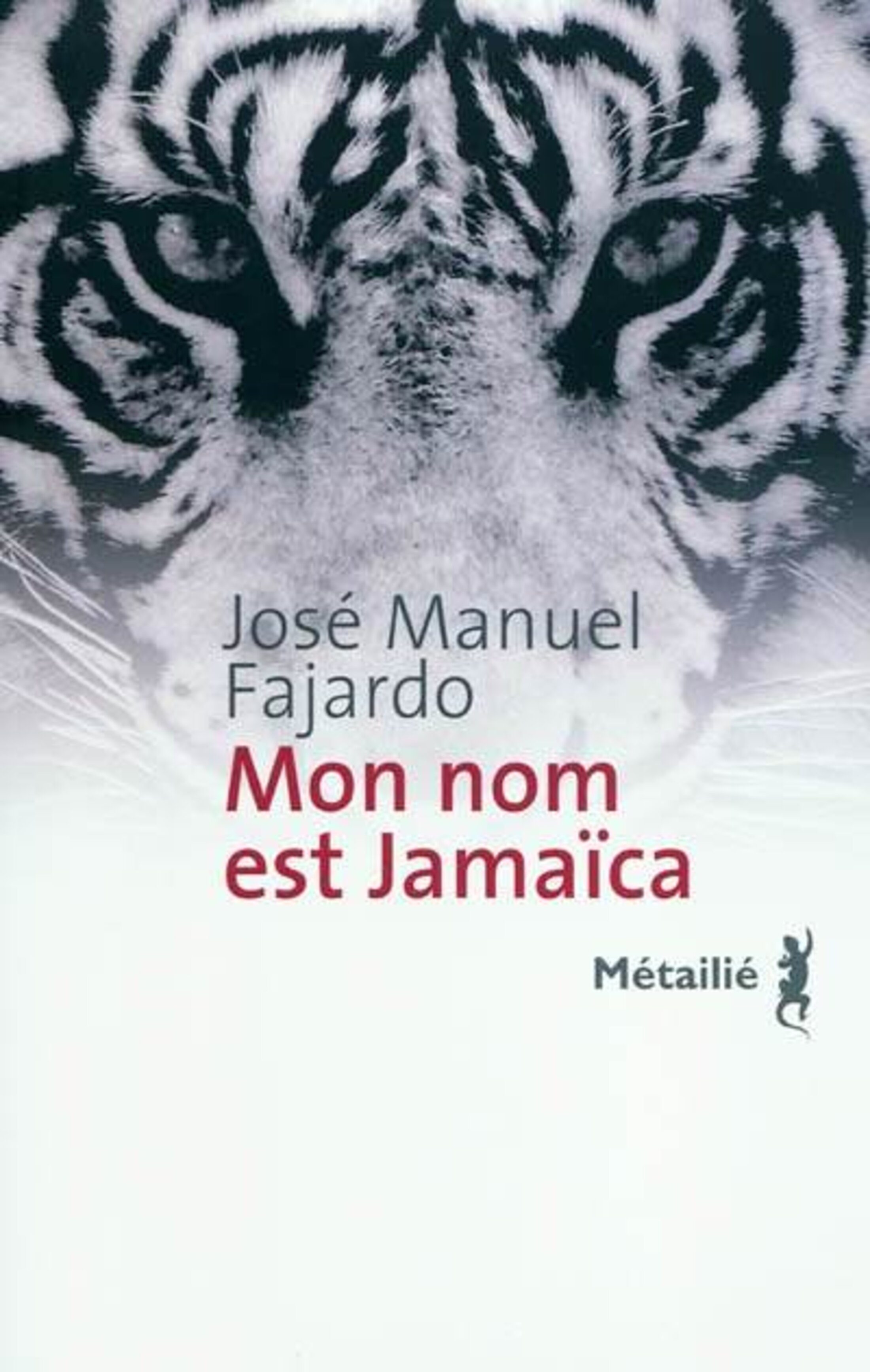
L’histoire se tisse d’abord autour de deux êtres : Santiago qui semble devenir fou lors d’un colloque, part, se fait arrêter, se veut juif, s’invente une nouvelle identité, « mon nom est Jamaïca », « je suis un tigre ». Et Dana qui narre ce qu’elle croit comprendre, elle aussi historienne spécialisée en histoire du judaïsme espagnol, elle aussi présente au colloque, en novembre 2005, amie de longue date de Santiago, sa maîtresse depuis la veille. Tous deux « champions universels de la perte ».
Un divorce pour Dana, deux deuils pour Santiago : sa femme, Nicole, son fils, Daniel, 18 ans, qui vient de mourir dans un accident de voiture. Jusqu’au deuil de son nom, une erreur de l’histoire selon lui, « d’où sort ce nom ? D’où est-ce que je sors, Dana ? ». Six jours d’errances, six jours de conquête du sens, de périples, des territoires occupés à la banlieue parisienne, de Tel-Aviv à Grenade, au cœur du chaos de l’histoire, collective comme intime. Et un roman qui ne cesse de s’élargir, de s’échapper, de nous échapper. Six jours comme une autre guerre, intérieure cette fois.
Dana rationnalise, tente de comprendre, de suivre Santiago, de garder trace de son délire, de le retrouver quand il dépasse les frontières, géographiques et mentales. Elle écoute, consigne, raconte. Transcrit les errances de Santiago, ses réflexions sur le hasard (qui n’existe pas), l’identité (à trouver, à construire), le deuil, la violence historique et sociale, les diasporas de l’histoire. Tente de comprendre pourquoi Santiago/Jamaïca se croit désormais juif (syndrome de Jérusalem ?), se demande si sa démence est une manière de se reconstruire après le deuil, voire une lucidité supérieure. Cherche jusque dans un récit de Diego Atauchi, en 1599, un homme du Nouveau Monde.
Une voix surgit du passé, dans sa mémoire, cette première phrase en écho au délire de Santiago, « j’ai décidé d’être un tigre ». Dana lit La Relation de la guerre du Bagua,fascinée, interloquée par les clés que le texte – centré sur la lutte des Indiens d’Amérique du Sud contre la conquête espagnole – lui offre peu à peu, par ce hasard improbable, ce cercle de l’histoire qui se referme, ouvre des abîmes, et le lecteur suit sa quête, au rythme du récit inséré, par bribes, comme un suspens, comme une trouée dans la narration principale.
«Le hasard n’existe pas, Dana, il n’existe pas, il n’y a que des cercles qui se referment.»
«Tout se superpose, Dana, murmura-t-il, sur la même terre, sang après sang, tout se superpose et tout continue, c’est un cercle sans fin.»
Mais où sont les frontières ? Dana qui se pensait si posée s’égare elle aussi, découvre des parts inconnues d’elle-même, la vérité est entre le souvenir et la quête, dans ces cicatrices, coutures de la peau, de l’histoire, jonction des filiations et des identités construites.
«Tout semblait déréglé, comme si la folie de Tiago était contagieuse, une maladie qui peu à peu se répandrait sur le monde, reléguant les autres problèmes au rang d’anecdotes».
José Manuel Fajardo nous transporte, loin, d’Israël à l’Espagne, en passant par Paris, loin dans l’intimité de ses personnages, Dana, la narratrice, Santiago/Jamaïca, et sa tête « nef des fous », David l’ami. Il interroge les fondements de la souffrance, du deuil, de la folie, de l’Histoire, dans un roman lourd et troublant, avec, en clé de l’énigme, un texte de 1599, mais aussi une nouvelle de Borges, un aleph, ou la bibliothèque de Tiago, « un chaos de lignes et de volumes », un « désordre, un ordre différent », manière de célébrer le livre dans sa puissance à tout contenir, sans frontières.
CMJosé Manuel Fajardo, Mon nom est Jamaïca, Traduit de l’espagnol par Claude Bleton, Métailié, 303 p., 21 €


