
Face au concert de louanges adressées à Aurélien Bellanger avant et depuis la parution de La Théorie de l’information (Gallimard 2012), peut-on dire du mal de son livre ? Oui. On le peut.
On a pu lire à propos de La Théorie de l’information des affirmations péremptoires (« roman le plus innovant (…) d’une très riche rentrée littéraire » - Libération), « il a écrit le roman-choc de la rentrée » (Technikart) ou des questions en forme d’adoubement potentiel : Aurélien Bellanger, le nouveau Houellebecq ? (Les Inrocks). On en appelle même à Balzac dans La Croix et si Le Monde est plus circonspect, on retient une quasi unanimité autour de ce premier roman et la volonté commune — sinon suspecte — de souligner l’avènement de la littérature « geek » au cœur de la rentrée littéraire 2012.
Face à ses intervieweurs, Aurélien Bellanger a rodé son discours (mais peut-on l’en blâmer ? Oui, on peut) : interrogé dans Les Inrocks et Libération sur la genèse de son livre, il a répondu respectivement : « Dans les premiers temps, je ne faisais rien, je n’écrivais pas. Alors j’ai relu toute La Comédie humaine de Balzac. Plus je lisais, plus je devenais hyperfan. Un ami m’a alors suggéré d’écrire un roman balzacien. » ; « Mon premier mois sans emploi fut classique: effondrement complet, jeux vidéo en ligne, je ne faisais plus rien…Sauf lire la Comédie humaine de Balzac. Du coup, un ami m’a suggéré d’écrire un roman balzacien ».
Début de l’agacement : Aurélien Bellanger est « hyperfan » (sic) de Balzac et La Comédie humaine compte 137 livres qu’il aurait donc lus en un mois. Mais avant de tirer des conclusions forcément hâtives et d’être taxé de vouloir intenter un procès en intention (répétition volontaire) sans avoir lu le livre, je l’ai donc acheté. Et lu.
Commençons par les amabilités : il ne sert à rien de choisir Leibniz en épigraphe — et Shannon en référent du titre — d’un livre si c’est pour convoquer Paul-Loup Sulitzer quelques pages plus loin. On a beaucoup et longtemps reproché à celui qui a signé Cash, Money ou Fortune de ne pas avoir écrit tous ses livres et de s’être adjoint les services d’écrivains fantômes successifs. On pourrait à l’inverse presque en vouloir à Aurélien Bellanger d’avoir écrit seul La Théorie de l’information.

À l’entendre, ce ne serait d’ailleurs pas le cas : dans Libération (qui titre même Ce roman n’aurait jamais vu le jour sans Wikipedia), Aurélien Bellanger déclare que l’encyclopédie en ligne l’a « sorti plusieurs fois d’impasses narratives ». Las, placé sous le signe de Balzac (par son auteur), Houellebecq (par les médias), et Wikipedia (intronisé consultant technique) La Théorie de l’information ressemble davantage à L’histoire de l’informatique pour les nuls qu’à Illusions perdues ou aux Particules élémentaires.
Certes, l’entreprise est titanesque : balayer plus de trente ans d’histoire technologique en près de 500 pages est un défi de taille. Prenant comme sujet principal le destin de Pascal Ertanger, tycoon fictionnel ou presque (sorte de croisement, sous forme de grand écart, entre Xavier Niel et Michael Jackson) depuis sa naissance en 1967 à nos jours, La Théorie de l’information est présenté comme « une épopée économique française » qui, « de l’invention du Minitel à l’arrivée des terminaux mobiles, de l’apparition d’Internet au Web 2.0, du triomphe de France Télécom au démantèlement de son monopole », entendrait dresser un portrait en creux de la société moderne. Une société qui s’est enorgueillie (et s’en félicite toujours une larme au coin de l’œil) d’inventer le Minitel avant de manquer de peu la correspondance avec le TGV Internet. Une société qui aurait été livrée aux mains de cyniques talentueux (dont le héros d’Aurélien Bellanger), dans une France « post-industrielle », « post-humaine », « post-moderne »… Chez Aurélien Bellanger, tout semble « post » quelque chose. On peut même se poser la question : qu’est ce qu’il va encore inventer de « post » ? La post-littérature, peut-être ?
Dire que le résultat n’a pas été à la hauteur de mes espérances de lecteur est un euphémisme : composé de trois parties linéaires à la chronologie plus ennuyeuse qu’un calendrier de l’Avent, La Théorie de l’information déçoit dès les premières pages et sa structure se dévoile plus vite que la strip-teaseuse du peep-show que le personnage principal fréquentera vers la page 108. Une grande quantité d’informations didactiques précède invariablement quelques éléments diégétiques : la jeunesse du héros en banlieue parisienne, les ressorts psychologiques sous-jacents tandis qu’il évolue au sein d’un contexte familial transparent, ses émois sexuels balbutiants, sa nature de « nerd » ou de « no life » avant l’heure…) ; puis la nature (qui a pourtant horreur du vide) reprend ses droits et le métarécit (terme employé par l’auteur lui-même en interview et dans le livre à la page 155) se poursuit, assénant au lecteur le descriptif d’une sonde thermique ou le nombre de kilo-octets contenus dans la mémoire du défunt ordinateur ZX81.
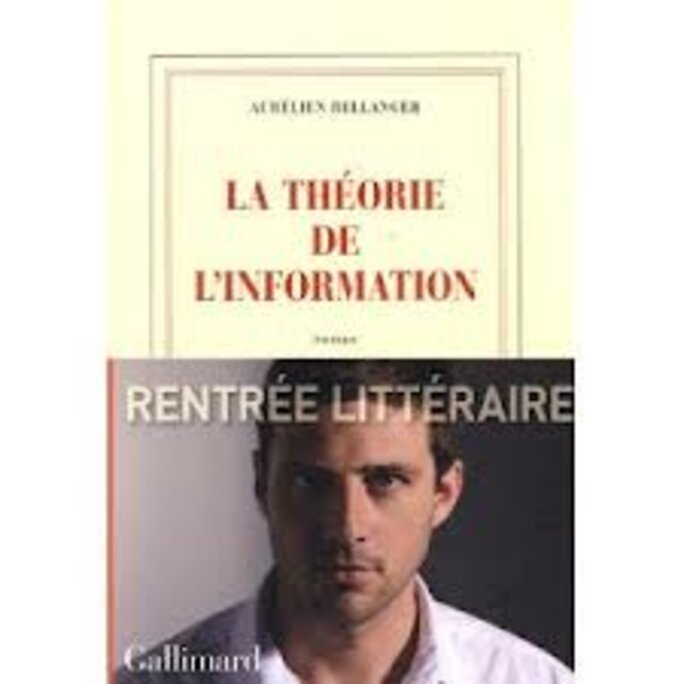
Entre chaque chapitre, d’absconses notules en italiques (répondant aux noms fumeux de « steam », « cyber » ou « bio punk ») scandent le récit et l’on se demande à chaque fois si l’on a acheté un roman de la collection blanche de Gallimard ou un Que sais-je ? consacré à la thermodynamique ou à la logique floue. Affectant un style clinique (une volonté de l’auteur, aux dires de certains critiques), Aurélien Bellanger se livre d’entrée à un panégyrique de Vélizy-Villacoublay dans une énumération qui souffre du name dropping autant que de sa platitude intrinsèque. Vers la page 34 j’en suis même venu à me demander s’il n’aurait pas mieux valu que le héros meure quelques pages plus tôt afin d’abréger nos souffrances. Les siennes et les miennes.
Dès lors, les chapitres se suivent et se ressemblent. Des pans entiers du livre font la part belle à l’exégèse systématique de tel ou tel phénomène scientifique avec des explications de textes indigestes sur l’anatomie du Minitel, la programmation en BASIC ou l’impossibilité déprimante de plaquer plusieurs circuits imprimés dans une « boîte ». On avance péniblement, pris sous le feu croisé de digressions technologiques ou les interventions ex nihilo et ex machina des grands noms de l’informatique et même de la politique (le name dropping frappe encore et encore) et les interstices encyclopédiques incompréhensibles.
Lire La Théorie de l’information devient alors une épreuve. Quelques idées sont bien avancées ça et là (on sent alors poindre une sorte de spontanéité inconnue au détour d’une phrase), mais la distance imposée par l’auteur achève de les noyer sous une masse d’informations qui, loin de servir le récit, l’alourdissent au-delà du supportable. Rien n’est épargné au lecteur ou presque. Des formules scientifiques complexes à la fréquence idoine d’une bande passante, on en vient à regretter l’absence de notice explicative ou de schémas de montage qui viendraient illustrer ce que les mots d’Aurélien Bellanger rendent difficilement auprès de ceux qui seraient (il y en a) imperméables au jargon technophile.
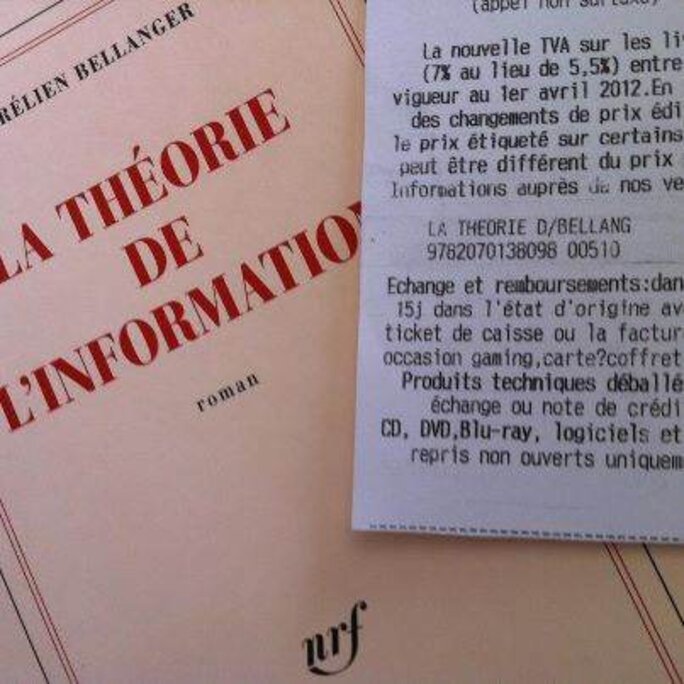
Là où les auteurs d’anticipation les plus sérieux construisent, brossent, brodent à partir de faits réels ou putatifs, Aurélien Bellanger se contente donc d’égrainer son chapelet et semble avoir renversé la donne (ce qui n’est pas le pire défaut du livre mais pas non plus son principal atout) et construit son roman autour des notules explicatives, là où Houellebecq (pour ne citer que lui, élevé au rang de parangon du jeune auteur dans plus d’un média) a utilisé Wikipedia pour servir son histoire, Aurélien Bellanger semble avoir fait exactement l’inverse.
Plus loin et plus encore, ce qui frappera le lecteur courageux, c’est bien le manque patent de recul, l’absence de regard surplombant qui viendrait rayer ce disque longue durée et donner un peu de relief à une histoire désespérément lisse. Trop rarement (deux scènes de dialogue avec Nicolas Sarkozy, quoique trop écrites, ou quelques fulgurances éparses dans lesquelles l’auteur se serait peut-être impliqué, voire égaré) le livre dépasse le niveau d’un manuel scolaire insipide et rébarbatif. Tout y est factuel, aride, sec. Nulle métaphore ne vient perturber le ronronnement de la machine didactique. Mais la sécheresse ne serait pas un obstacle si (à l’instar de Michel Houellebecq encore) quelques espaces de respiration permettaient de voir affleurer une ironie bienvenue. La Théorie de l’information en est complètement dénué et nul humour à froid ne vient sauver le livre victime d’un aplatissement généralisé.
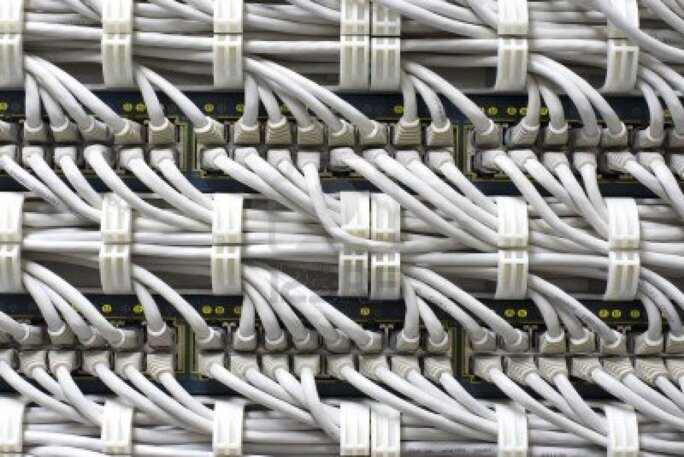
Agrandissement : Illustration 5
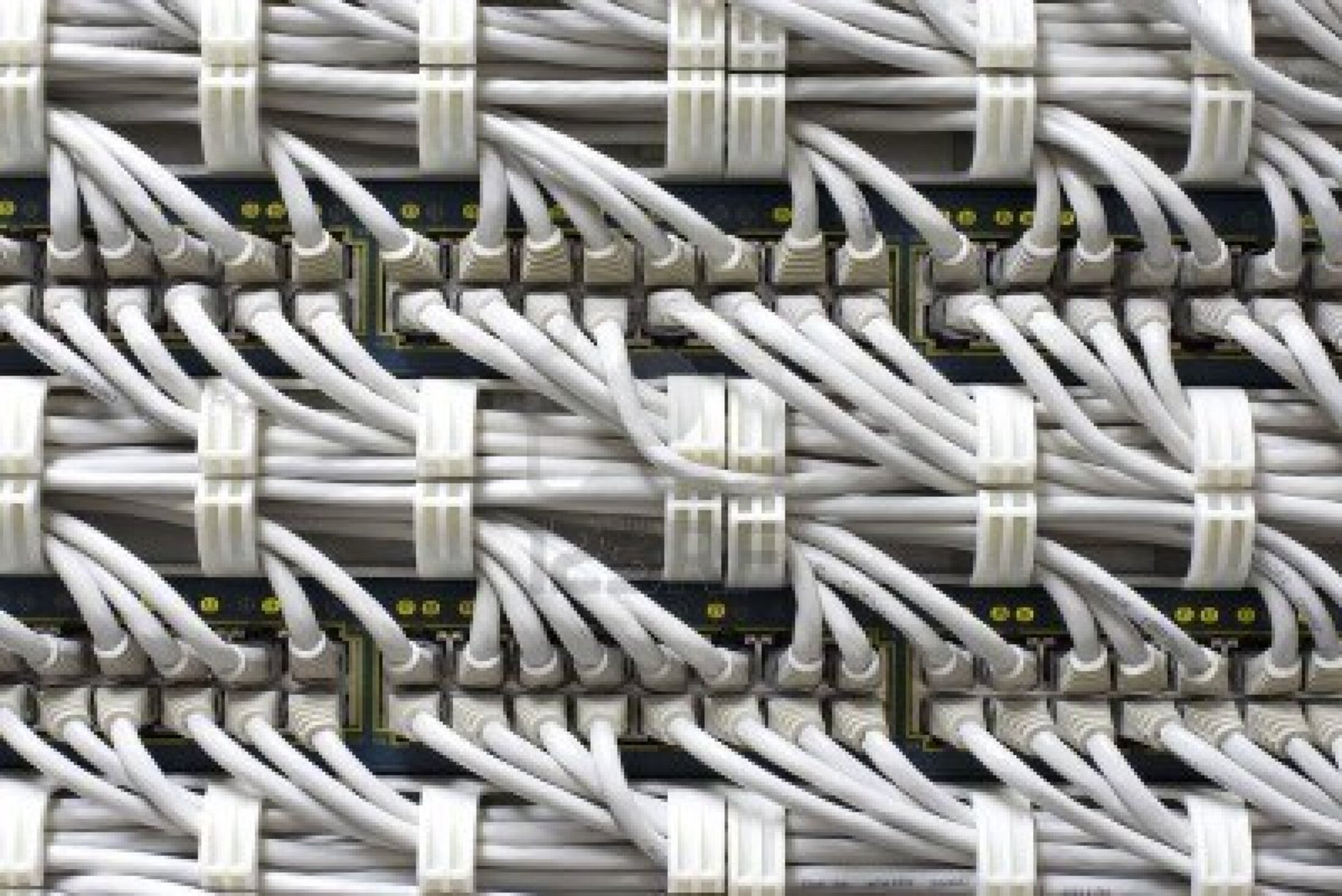
Hors un rare moment de mise en abyme tout en contrition au cours duquel on apprend que le meilleur ami du héros « Xavier Mycenne avait fini par abandonner la littérature pour enseigner la philosophie de la technique à Nanterre (…) », on se prend à rêver de l’apparition d’un quelconque regard critique. La suite vaut son pesant de câbles Ethernet, à propos du même Mycenne : « Il tenait aussi le blog hapaxetqualia.tumblr.com. (…) C’était un vulgarisateur assez doué et un esprit plutôt brillant, mais son absence de connaissances se ressentait assez vite. Mycenne était un intellectuel mineur ». Philosophe de formation et tenancier du blog « Hapax » (tiens donc !) le jeune auteur a-t-il succombé à la tentation du caméo littéraire en deux phrases lapidaires ? Mais il est déjà trop tard, on arrive déjà à la page 415 (sur 487 de texte). J’aurais dû m’arrêter avant. Bien avant. Avant de me présenter à la caisse par exemple.
Aurélien Bélanger, La Théorie de l’information, Gallimard, 496 p., 22 € 50



