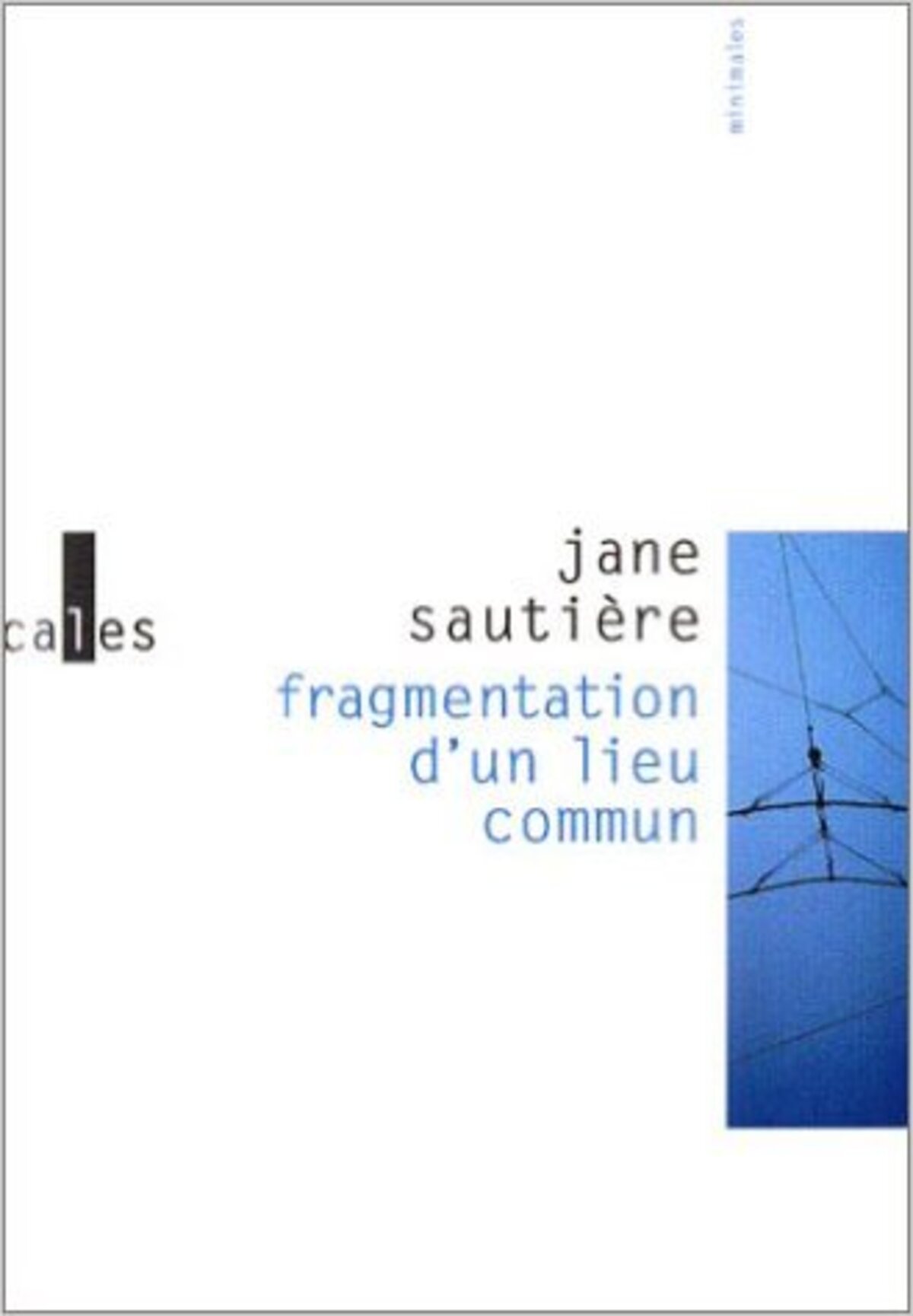
À partir de son expérience professionnelle (elle était éducatrice pénitentiaire au moment de l'écriture de ce livre), elle élabore un ouvrage d'une haute tenue littéraire et humain, qui nous touche, nous fait comprendre ceux et celles qui fréquentent ce lieu, et qui nous hante nous même après que nous en avons renfermé la dernière page.

Agrandissement : Illustration 2

Il y a quelque chose de la Tentative d'épuisement d'un lieu parisien de Georges Perec dans l'analyse fouillée que nous donne Jane Sautière de l'univers carcéral. Georges Perec avait inventé une forme nouvelle qui permettait de sortir des discours convenus par accumulation de détails. Détails qui font sens, séries de listes qui finissent de rendre étrange un lieu qui semble pourtant d'une banalité à pleurer. Jane Sautière reprend en partie ce dispositif, en l'adaptant à l'univers qu'elle explore. Elle adopte la forme fragmentaire et en arrive à des « effets de vérité » surprenants de justesse sur de l'univers carcéral. Il y a cependant une différence fondamentale avec ce livre de Perec : ce n'est pas nous qui épuisons le lieu, c'est le lieu qui nous épuise, par la force de ses hauts murs, de son organisation panoptique, de la misère et de la violence qui y
règnent.
Il est si difficile d'être juste, en particulier pour parler de ce lieu. Lieu qui est aussi un non lieu (même si l'expression est étrange, dans ce genre de lieu). Lieu qui est celui de l'oubli, du silence, de la mort. D'une misère qui ne se dit pas. D'une clôture qui ne fait pas de bruit dans un
monde pourtant si bruyant. La prison, on en parle lors d'une évasion spectaculaire, et on l'oublie. Quelquefois le scandale éclate (suicide, violence, « personnalité » jetée dans un cul de basse fosse) et éclabousse la prison, et on l'oublie. La révolte gronde, l'émeute éclate, les journaux font leurs gros titres sur la prison, et on l'oublie.
Jane Sautière, à travers cette fragmentation d'un lieu commun, son premier livre, s'attaque à cette absence qui ne s'oublie pas, à cette humanité grouillante placée dans un lieu de relégation. « J'ai commencé à écrire ce texte quand je vous ai écouté. Il ne s'agit pas d'écrire une douleur (la mienne ou la vôtre) Il s'agit d'être là. »
La première difficulté pour raconter et être juste est de trouver la distance ad hoc : ni trop loin ni trop près, ne faisant preuve ni de misérabilisme (alors qu'il serait si tentant de le faire) ni d'une vision trop idéalisée d'un univers pourtant glacé et violent. Il faut tenir sa place, celle d’où on parle, mais respecter également celle des autres intervenants peuplant cet univers singulier.
Dans la présentation faite par l'éditeur de l'ouvrage, cette question est ainsi présentée : « Elle parle des instants qu’ils ont vécus en commun et lui dit «vous», ou parfois «tu», ce qui confère au ton de ce texte sa particularité, un ton et un regard porté d’une rare justesse. Ceux dont elle parle et à qui elle s’adresse ont peuplé sa vie comme ils ont peuplé la prison. Il y a des détenus, mais aussi des surveillants qui comme elle, habitent la prison sans y être enfermés. Il y a ceux qui en sont sortis mais qui n’arrivent pas à s’en sortir. Il y a ceux qui y sont restés. Et ceux qui y restent. »
Le tutoiement est réservé aux « collègues » : surveillants, personnel administratif, direction de la prison, personnels du service social. Le vouvoiement est une marque de respect accordée aux détenus, bien avant qu'elle soit une obligation contractuelle de l'ensemble des personnels en fonction des « règles européennes carcérales » (qui interdisent le tutoiement vis à vis du détenu).
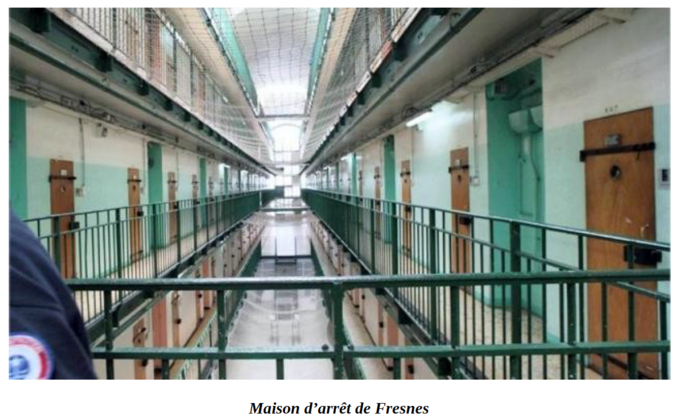
Agrandissement : Illustration 3
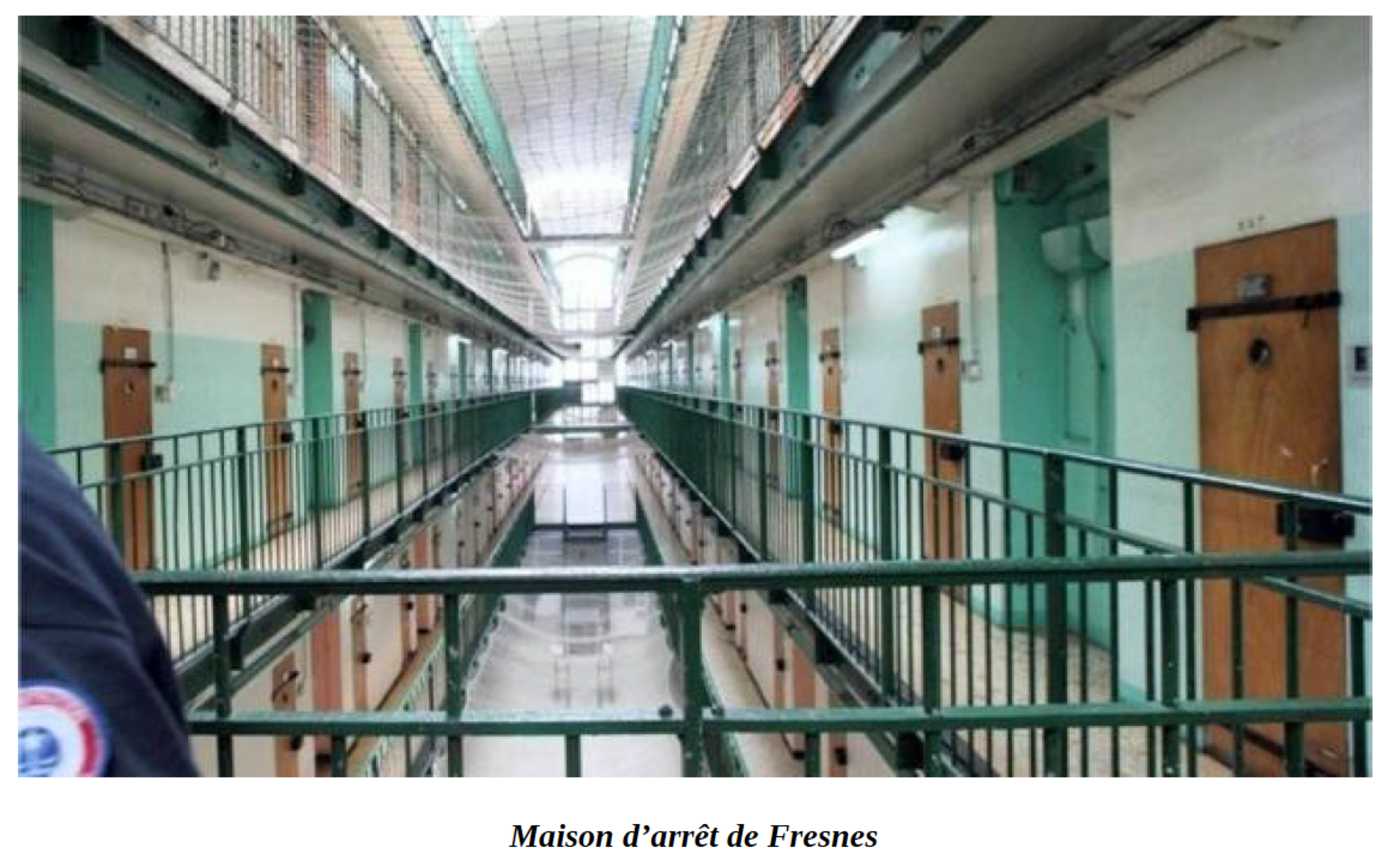
C'est que l'univers de la prison est divers, fondamentalement clivé : il y a les surveillants et les prisonniers, quelquefois plus proches que ce que les deux parties voudraient bien l'admettre. Il y a le personnel « social » (dont faisait partie Jane Sautière) qui cherche sa place entre ces deux catégories. Ils (et surtout « elles », mais nous y reviendrons) ont en commun avec les surveillants de pouvoir sortir de cet univers le soir, mais elles sont souvent considérées par certains surveillants comme « étant du côté des détenus ».
C'est le sentiment contraire qui peut prévaloir de l'autre coté des barreaux, pour peu que la demande faite par le détenu au service social n'aboutisse pas, d’où le sentiment de certain(e)s d'entre eux et elles d'être « entre le marteau et l'enclume » doté(e)s d'une mission impossible. Du côté des détenus, il y a aussi de multiples « publics » : il y a les habitués, il y a les paumés, il y a ceux qui se demandent ce qu'ils font là, il y a ceux dont l'administration même se demande ce qu'ils font là.
Il y a les « riches », qui « cantinent » (cette pratique qui consiste à pouvoir acheter un ensemble de produits dans un magasin dédié, aux tarifs généralement prohibitifs). Il y a des pauvres, qui sont obligé de se contenter du minimum et qui sont quelquefois entraînés à servir les premiers contre de menus avantages. Il y a les multiples « catégories » dans lesquelles ils se classent eux mêmes :
braqueurs (autrefois, ils tenaient le haut du pavé, maintenant…)
pointeurs (les délinquants sexuels, qui font l'objet d'une vindicte générale de la part des autres détenus)
dealers (mais même dans cette catégorie, il faut distinguer le dealer « charbonnier » (celui qui vend la dope au pieds des HLM) qui moisit en maison d’arrêt et la grosse prise ( le « beau mec » disent les policiers) enfermée en centrale.
Mais outre cette « multitude » si perturbante à gérer, il y a la prison elle même, cet univers de bruits (portes qui claquent, hurlements, bruits impossibles à déterminer) d'odeurs (il y a une « odeur de la prison » connue de tous ceux amenés à la fréquenter, et si difficile à décrire). Un
ensemble de sensations vives qui éclate lors de la « première visite », si bien raconté par Jane Sautière :
« La première fois où j'ai traversé la prison, j'avais 23 ans, je devais me présenter à la maison d’arrêt pour y passer ma visite médicale d'embauche. Ça avait lieu dans l'infirmerie destinée aux détenus (il ne serait venu à l'esprit de personne, à cette époque, de nous envoyer à l'extérieur. La prison gobe tout, prison et personnels. Une infirmière, vieille comme les murs, est venue me chercher à la porte d'entrée (Elle avait plus de 70 ans : elle travaillait toujours. Bénévole, religieuse ? Elle faisait « couleur locale », comme tant d'autres anomalies. Il y avait, il y a toujours, la fierté d'une « exception pénitentiaire » ICI, C'EST COMME ÇA. Elle m'a fait traverser la prison, je me souviens d'un chemin long, tortueux. Je n'aurais su revenir seule. Trop de symétrie égare. Puis on m'a fait attendre dans une grande cellule qui puait le tabac froid et la sueur. J'étais torse nu, selon la recommandation du médecin. Assise face à la porte à oeilleton, j'attendais, désorientée par le cadre et la nudité de mes seins presque incandescente dans cet endroit. J'ai senti des ombres passer devant l’oeilleton. J'ai compris que des surveillants venaient se rincer l’oeil ; j'ai entendu des rires étouffés. J'ai hurlé en tapant à la porte. Le médecin est venu. Il n'y a pas eu de suite : c'est-à-dire, mon attitude ayant été jugée « excessive » n'a donné lieu à aucun commentaire. C'est-à-dire : personne n'a demandé à ces hommes de ne plus faire ça.
Était-ce ma première visite en prison ? Je ne sais plus mais c'est la première fois où je l'ai éprouvé. »

Agrandissement : Illustration 4

Voilà ce qu'est un « univers de sensation » : des odeurs, des bruits, des rapports de force... On y approche des fondamentaux de la vie carcérale : les règles (en général non écrites dans un monde de règlement) spécifiques à « la carcérale », les rapports de pouvoir (car avant même de se rincer l’oeil, les surveillants viennent signifier à l'impétrante « qui est le chef »), la violence, ouverte ou sournoise. Évidemment, les surveillants ne sont pas forcément des brutes (l'immense majorité de ceux que j'ai été appelé à fréquenter ne l'est pas). Tous ceux qui participent à la vie de la prison ont une « première fois » gravée de façon permanente, un peu comme la première fois que l'on aime, la première fois que l'ont constate le décès d'un être cher. La première naissance. Tous ces événements qui vous font grandir, et, irrémédiablement, vieillir.
Cela dit, il faut aussi se garder de l'excès inverse, et de faire de cette expérience un récit paroxystique, fait de jamais vu, une expérience limite de notre humaine condition. Jane Sautière montre par de multiples « petites touches » que cette « expérience de la prison » n'est pas non plus
autre chose que l'expérience de la nature humaine, sans doute plus souvent confrontée à la misère dans ses multiples acceptations. Il y a ces destins brisés, marqués par la drogue, par l'abandon familial, par la déréliction. Ces SDF ayant enfin trouvé un logis. Il y a aussi tous les sans-papiers qui peuplent les maisons d’arrêts. Ceux que l'on nomme « X, se disant…. ». Ceux dont on ignore à tout jamais l'identité véritable, même le jour de leur mort. Ceux qui trouvent refuge dans les bois. Ceux dont la prison est le seul domicile fixe.
« Parfois, les paroles des étrangers. Des tapis volants. Dans votre village d’Afrique, les enfants à qui était confié l’élevage des poussins les teignaient de couleurs vives pour que l’épervier ne les reconnaisse pas. En un mot, toutes ces couleurs, celle de la terre rouge, celles des poussins, le bleu du ciel,l’immensité du monde autour. Et voilà. Terminus dans le lieu le plus atone du monde. C’est précisément du fait de votre couleur que l’épervier vous a chopé ».
Il y a aussi la folie, toujours présente. La prison est devenue le réceptacle de toutes les détresses psychiques et un lieu d'enfermement pour psychotiques. Le nombre de malades mentaux graves enfermés est estimé entre 15 et 20 % et la France est régulièrement condamnée par la cour européenne de justice pour sa gestion erratique de la question mentale en détention. Mais il y a la folie qui conduit en prison, et celle qu’entraîne la détention. Ceux qui viennent fous, et ceux qui le deviennent. Ne parlons pas des « longues peines » : être enfermé plus de 15 ans entraîne des conséquences, toujours : on n'en ressort que rarement indemne. Mais il y a aussi la folie quotidienne, celle qui ne conduit pas directement au bureau des soignants.
« Dans la salle d'attente, vous croyez voir des caméras. Pour qui, pourquoi ? Ça surgit d'un coup, ce délire d'être filmé. On mesure la souffrance de la persécution, la stupeur affligée qui vous saisit ; la douleur crispe votre visage. On ne peut rien faire, on reste là, transis. La douleur si violente, si forte, qui rebondit bord à bord ».
Évidemment, ceux-là sont doublement enfermés : ils participent rarement (pour ne pas dire jamais) aux « activités » diverses : travail, activités d'apprentissage, initiatives culturelles. Certains ne sortent jamais de leur cellule, même pour la « promenade ». Mais on en entend quand même parler, ne serait ce que par les autres détenus qui partagent leur lieu d'infortune (en maison d’arrêt, si souvent surpeuplée).
Une des particularité de ces écrits, est d’être des écrits de femmes qui se positionnent toujours en tant que telles, dans un univers si fortement masculin. Les détenus sont des hommes à 95 %, les surveillants tout autant, même si depuis quelques années on commence à voir quelques
« surveillantes », d'ailleurs souvent « sous pression » de ce point de vue (marquées par le machisme ambiant, attendues au tournant par leurs collègues, elles sont souvent dans une position « plus royaliste que le roi » assez typique de ce type de positon subjective). Évidemment le personnel « social » et « administratif » se compose pour son immense majorité de femmes, selon le « partage des genres » qui réserve la compassion et le traitement administratif au caryotype XX.
« On a accepté de garder quelques affaires, depuis on est envahi. On est surtout envahi de notre trouille à vouloir que vous deveniez autonomes, que vous ne nous restiez pas sur les bras, que nous ne devenions pas vos pères et mères, car on ne répare pas, vous êtes des personnes, de l'humain et non des objets. On ne répare pas ici, alors circulez, circulez ! Les affaires s'entassent dans la salle des archives. On ne veux plus savoir que pour devenir autonome, il faut avoir pu peser sur quelqu'un, lui prendre et son temps et sa chair. On a six mois pour vous aider. On a si peu d'argent, vous avez besoin de tout. La peur d’être tout, la peur de n'y rien pouvoir. Rien, tout. Les grands récits, les monuments. Être là, c'est le moins facile. Être là, face à face. Il y a de beaux regards, yeux dans les yeux, ces histoires qui se déplient, ces visages qui prennent figure. Ces silences qui sont comme un repos. On finira par oublier qu'il y a cela, ce silence, après que l'on se soit parlé »
Peut-être ressent-on plus vivement cette situation d'exclusion qu'est la prison quand on est une femme, si souvent victime de violence « à l'extérieur », et dont la place « interne » est si nouvelle (jusqu’à la guerre d’Algérie, la prison était un monde d'hommes exclusivement, sauf quelques rares religieuses). Il y a une « tension sexuelle » évidente en détention, qui découle en grande partie de la situation particulière des détenus (sinon des raisons pour lesquelles un certain nombre est là). La privation de toute sexualité entraîne quelquefois des explosions incontrôlées, dans un monde où la sexualité n'a pas même le droit d'exister.
« Votre violence. Dans cette prison si neuve, si propre avec deux jeunes femmes « emploi jeune », je traverse une cour qui donne sur un bâtiment de détention. Des hurlements fusent « je te bouffe la chatte ». On rit pour couvrir la gêne. Ma fureur de voir ces jeunes femmes insultées, leur malaise, la nature de l'insulte sexiste qui est acte de guerre bien avant que d'être insulte, à qui le dire ? À vous, derrière vos barreaux ? Ne plus pouvoir se parler, voilà l'horreur ici, pire que les rats et les cafards Ce silence de haine, la salissure des mots, bien plus pestilentielle que les chiottes bouchées. Une femme surveillante me dit avoir été en poste au quartier d'isolement pendant plusieurs
semaines. La pluie des insultes permanentes à elle, à son sexe, la rage de la maltraiter dans sa féminité. N'en plus pouvoir. Elle dit qu'elle entend des acouphènes dont on ne guérit pas. Enlevée de ce poste, elle retrouve une audition normale. »
Non seulement Jane Sautière n'oublie jamais qu'elle est une femme dans un monde majoritairement composé d'hommes, elle n'oublie pas non plus les jeux de séduction, les ambivalences mêmes si celles-ci sont d'abord niées par un système qui réprime toute expression de ces tensions sexuelles, et tout rapport d'égal à égal dans un monde aux multiples hiérarchies.
« On rentre dans les cellules après avoir tapé à la porte avec nos clés. Chaque geste compte : avoir les clefs, mais taper à la porte. On passe la tête « je peut entrer ? » C'est souvent une certaine irréalité, au début. Une femme ici ? Parfois notre regard voltige vers des photos pornos. Avec une collègue, on remarque que dans les cellules où on pénètre souvent, les photos ont disparu au profit du féminin, le nôtre. Ce qu'on y met de pudeur. Ce que vous y mettez de contrôle. Rare que vous passiez la barre dans les relations de vous à nous, dans les relations singulières. Là, ni insultes ni agressions. Souvent, cette façon de s'épargner, nous et vous. Parfois, un aveu qui fuse avec une dignité rare. « J'ai des sentiments pour vous », vous me l'avez dit. Je savais que vous étiez là pour proxénétisme aggravé, en l’occurrence des violences physiques terribles exercées sur des prostituées. Cela n’ôte rien à cela. Le contraire non plus. »
Les relations entre prisonniers et surveillants peuvent également être entâchées de cette ambiguïté qui est la marque même de la prison. La prison n'est pas uniquement une « perte de liberté » qui consiste à être enfermé, elle implique également, à l'intérieur de ce lieu, de dépendre tout le temps d'une administration et de son personnel pour les plus petits détails de la vie quotidienne : prendre une douche, aller aux toilettes, sortir de cellule pour aller au parloir, voir son avocat prendre l'air en « promenade », participer aux activités, travailler. De multiples demandes sont souvent nécessaires pour obtenir ce qui en dehors de la prison ne poserait aucun problème. Le détenu est totalement dépendant du surveillant et de l'administration pénitentiaire.
« Il n'y a pas de petites choses dans la prison. Tout compte : un timbre, une clope, un savon. Dans le désert, tout est relief »
Assurément, comme chaque fois qu'il y a un pouvoir, le risque d'abus de pouvoir n'est jamais loin, ce que montre de multiples exemples fournis en général par les détenus eux-mêmes (même si l'on peut toujours douter de leur témoignage) ou par d'autres « collègues » de celui dont le
comportement est condamné (la « jalousie » professionnelle ou l’opposition personnelle ne peut pas systématiquement être évoquée). Il y a des exemples qui montrent de façon factuelle la vérité de cette loi générale. Mais les surveillants eux-mêmes sont de multiples compositions : il y a le jeune zélé, le vieux auquel « on ne la fait plus », le surveillant « dur mais juste », le surveillant sympa (celui-ci on l'appelle chef même quand ses galons attestent du contraire) et le surveillant sadique, jouissant de son pouvoir dérisoire. Ce dernier n'est pas si courant que ça, le fonctionnaire sympa n'est pas si rare. Et il y a surtout un entre deux. Ceux qui oscillent : sympa avec l'un, peau de vache avec l'autre, ceux dont l'humeur est indexée sur la météo ou sur le rapport de notation, le résultat aux concours administratifs, voir les amours, toujours aléatoires. Le surveillant n'a pas un type particulier, même si en général on ne fait pas ce travail totalement par hasard (même si la plupart ne l'ont pas choisi). Mais il existe aussi des « profils atypiques », pas aussi rare qu'on pourrait le penser.
« Cela tu me l'as raconté, je ne l'ai pas vu. Au moment de la commémoration de la révolution française, des anarchistes ont mené l'assaut de la maison d'arrêt. Tu me dit cela en rigolant, atypique surveillant assez heureux de trouver quelque chose à son goût dans le fatras commémoratif. Il te semblait que seul cet événement avait eu un sens. Tu racontais l’embarras de la direction quand les assaillants sont arrivés sur le mur d'enceinte. Tu aurais aimé que cette prise ait lieu, tu aurais rejoint ces sans-culottes qui t'auraient débarrassés de ton uniforme. Je te revois dans les couloirs, traînant une cohorte de détenus arrivants du dépôt, sales, usés, fatigués. Et toi, aussi blême qu'eux. »
Mais au-delà de ces différences de tempérament et d'attitude, il y a un aspect fondamental de la relation surveillant / détenu, c'est le temps que ces deux catégories que tout oppose doivent partager. Et ce temps peut être plus ou moins long. Dans un univers délinquant par exemple, la confrontation avec la police est faite de brèves relations, qui se comptent en heures plutôt qu'en jours. Mais en prison, la confrontation, ou la cohabitation, peut être bien plus longue et complexe. Complexe en ce qu'elle entraîne de conflits, mais complexe aussi en ce qu'elle entraîne
d'instants partagés, d'une association sans objectifs, et d'une rencontre illusoire. Évidemment, l'ensemble des dispositifs mis en jeu dans cet univers clos conduit à rendre impossible ces rencontres. Mais peut on toujours les empêcher ?
« […] Un jour vous arrivez en chaussettes extrêmement sales, avec des lentes dans les cheveux emmêles. Et pas de chaussures. Mon regard s'attarde sur vos pieds en chaussettes grises. Je demande « vous n'avez pas de chaussures, monsieur » et c'est le garde qui me répond que si il en a, mais avec des fers au bout qui faisaient sans cesse sonner les portiques, du coup les chaussures sont restées au dépôt. Le garde dit cela en rigolant, et vous riez avec lui. Vous êtes aussi jeune l'un que l'autre. Je comprend que je ne dois pas être la première à vous avoir posé la question. Et celle qui suivront non plus. Et que celui qui vous escorte a déjà entendu les réponses, puisqu'il vous accompagne depuis ce matin et que la journée se termine. Deux jeunes gars soudés l'un à l'autre, l'un dans le camp de l'ordre, la maréchaussée, l'autre dans le camp du désordre, l'homme déchaussé. Tout les deux ensemble, sans se plaindre, ni lui de vous, ni vous de lui. Sans trop s'étonner non plus. C'est la vie, les uns d'un coté, les autres de l'autre. Peut être sachant l'un et l'autre l'aléa de choisir. De quoi parlez-vous ensemble ? Vous échangez quels savoirs, de part et d'autre de votre ligature ? »
Dans le livre de Jane Sautière, chacun se trouve à sa place, sans que celle-ci soit assignée par la violence constante de la société (qui place les individus sans se soucier des conséquences. Reste à déterminer la question de la place même de Jane Sautière, et surtout de celle qu'elle revendique dans le livre. C'est celle du greffe, mais d'un greffier soucieux de son paysage et de ceux et celles qui les peuplent.
Il faut lire Fragmentation d'un lieu commun, qui mériterait mieux que ces quelques lignes malhabiles. Ces leçons de vies, témoignage précautionneux de vies brisées, et de destins tragiques. Ces petites touches, quelquefois drôles, quelquefois bouleversantes. Cette version moderne et désolée du Château de Kafka, mais un château qui vit au rythme du quotidien carcéral. Un livre qui nous bouleverse et qui nous tient.
« Le jour où on se réveille malade comme un chien, c’est qu’on est devenu un chien. Lié à sa meute, aboyant avec les autres, malheureux mais aboyant. Emmurant les mots vifs et sanglants, le corps qui refuse d’y aller. Ne disant plus rien que ce qui doit être dit. »
Jane Sautière, Fragmentation d'un lieu commun, Verticales, 2003
Un entretien d'une intensité rare sur « remue.net », créé et animé par François Bon
Christine Marcandier a présenté l'œuvre de Jane Sautière dans le Bookclub.
Cet article (réservé aux abonnés) nous présente le dernier ouvrage de Jane Sautière, Stations (entre les lignes).



