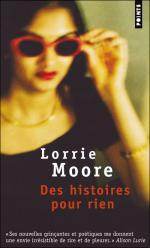A-t-il suffi à l’Amérique d’élire Barack Obama à la présidence pour régler la question du racisme ordinaire, quotidien ? Telle pourrait être la question centrale du roman de Lorrie Moore, La Passerelle, publié en 2009 aux USA (A Gate at the Stairs), qui vient de paraître aux éditions de L’Olivier.
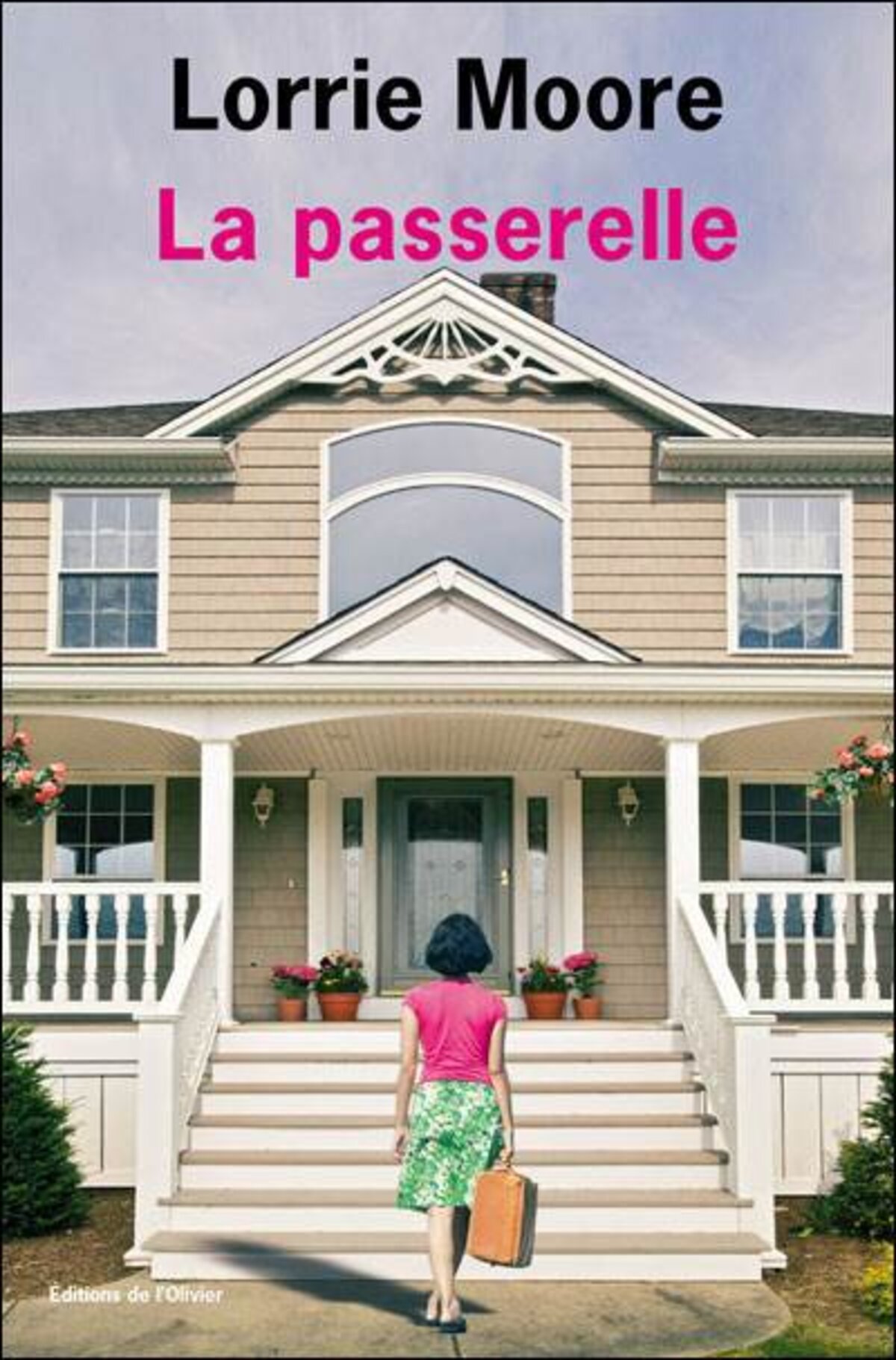
Agrandissement : Illustration 1
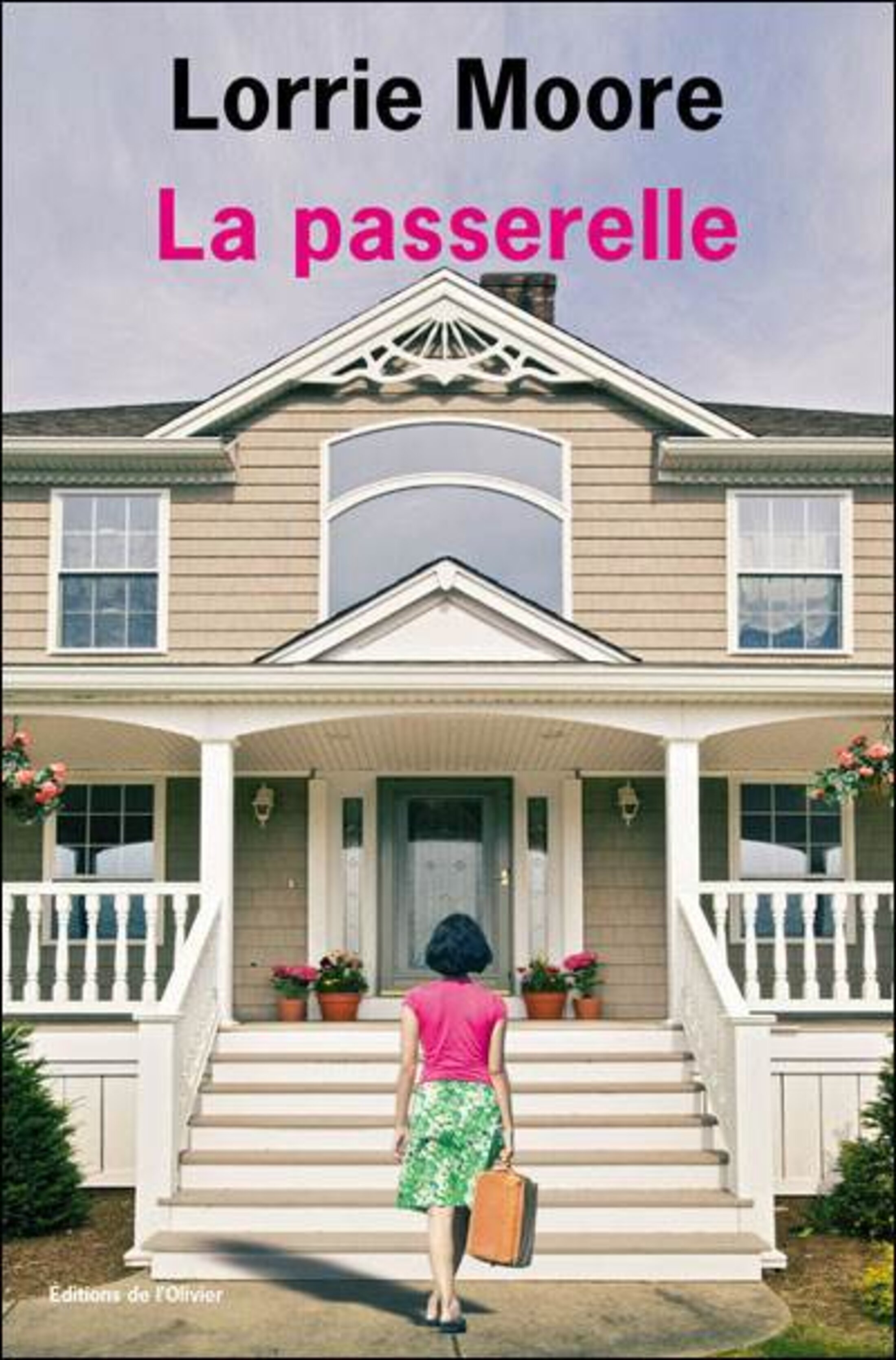
La Passerelle tisse deux fils romanesques principaux qui se diffusent en une infinité de motifs, d’échos, de détails à la fois ironiques et cruels : d’abord l’initiation au monde d’une jeune fille du Midwest, Tessie Keltjin, étudiante et baby-sitter qui se défait peu à peu de ses illusions, (dés)apprend, s’initie, ouvre les yeux. Lorsque la country girl a quitté la ferme familiale pour Troie, elle n’avait jamais encore pris un taxi ou un avion, jamais mangé chinois.
« Quand je revenais à Delacrosse, ma place dans le monde universitaire, dans celui de Troie et l’univers adulte se dissolvait, et je me transformais en un improbable ramassis de moi antérieurs qui se télescopaient les uns les autres ».
Tessie a vingt ans dans un monde post « événements de septembre – on n’appelait pas encore ça le 11-Septembre – (…) à la fois récents et lointains ». Elle découvre le campus, les étudiants (dont le mystérieux Reynaldo), les cinémas, des objets étranges, comme le vibromasseur de sa colocataire Murph qu’elle utilise pour mélanger son chocolat… et le couple, à travers son propre apprentissage amoureux comme à travers Sarah et Ed qui l’engagent pour s’occuper de leur fille.
Là intervient le second fil romanesque de La Passerelle : l’adoption, celle d’une enfant métisse, Mary-Emma par Sarah et Ed, couple étrange et atypique, dont les bizarreries cachent un lourd secret. Engagée quelques semaines avant l’arrivée de l’enfant chez les Brink, Tessie va suivre les étapes de l’adoption et découvrir un monde qui lui est, là encore, inconnu :
« Je n’y connaissais rien en adoption. (…) En général, je pensais à l’adoption comme à la plupart des choses dans la vie : avec embarras. Cela me semblait tout autant une plaisanterie cruelle qu’un beau rêve – une manière agréable d’éviter le sang et les douleurs de l’accouchement, ou, du point de vue de l’enfant, le fantasme concrétisé que vos parents ne sont pas vraiment vos parents. Vos gènes faisaient le signe de la victoire. Yes ! On n’a aucun lien de parenté avec ces gens-là ! Par hasard, au distributeur de la poste, j’avais récemment acheté des timbres qui vantaient les mérites de l’adoption : « Adoptez un enfant, fondez une famille, créez un univers », et je les collais avec jubilation sur les lettres que j’envoyais à ma mère. C’était le genre de méchanceté que je m’autorisais. Cela n’allait pas bien loin et pouvait être renié ».
Ce que découvre Tessie, suivant le parcours du combattant de Sarah, est bien moins conte de fée ou blague potache : elle voit la douleur d’une femme en attente d’un enfant, d’une autre femme qui ne peut garder le sien, et tout ce que ces douleurs recouvrent de transactions financières et petits arrangements commerciaux. L’adoption est un commerce, avec ses marchés (national, international), ses intermédiaires et… son racisme (« Il y a beaucoup de succès avec l’Amérique du Sud, en ce moment. Le Paraguay vient de rouvrir, ainsi que d’autres pays. Et ils ne sont pas tous marron. Il y a eu là-bas un apport allemand important, et certains de ces enfants sont magnifiques, blonds, ou bien avec des yeux bleus, voire les deux »). Argent, petites douleurs et grands deuils, arrachements aux familles d’accueil, voire aux parents adoptifs, tout est un jeu cruel avec l’identité d’un enfant, sa culture, jusqu’à son nom.
Mary, adoptée, devient Mary-Emma Bertha Thornwood-Brink (« j’avais compris ça en première année de fac : les noms aussi longs que des trains étaient la preuve d’une indécision parentale, d’une contrainte, d’une fierté génétique, d’une créativité mal placée, de décisions politiques de toute sorte »), puis Mary-Emma, Emmie enfin, comme une dépossession ou un déracinement progressifs…
Les Brink ont adopté une petite fille magnifique. Et noire. Geste politique, en soi, puisque, d’ordinaire, « les gens préfèrent aller en Chine ! En Chine, plutôt que d’adopter un bébé noir en provenance de leur propre pays ». Puisqu’ils défendront l’enfant face au racisme ordinaire, Sarah allant jusqu’à fonder un groupe de soutien avec des « familles transraciales, biraciales et multiraciales ». Geste d’amour mais aussi geste retors, parce qu’il s’agit de masquer une faute (ce que le lecteur comprendra peu à peu), de faire sien ce qui est autre, de « polir un mensonge aux bords acérés ». De tenter d’aller de l’avant en faisant table rase du passé. Pour les parents comme pour l’enfant, jeu dangereux, s’il en est, dont La Passerelle pousse les conséquences à leur paroxysme :
« Mais la vie de famille, comme la météo, cache parfois un vortex. Une tornade qui zigzague tranquillement : si l’on s’approche suffisamment près, on peut voir dans son œil (…) ».

La Passerelle n’est pas un roman de l’idylle. A travers le regard décapant de Tessie, Lorrie Moore poursuit sa fresque d’une Amérique qui marche, aussi, de travers. Retrouvant des thèmes qui lui sont chers (l’identité, les malaises existentiels et sentimentaux, ces états de « dépression pacifique », la mort, le nom), l’auteur de Déroutes et des Histoires pour rien dépeint « un faux-semblant. Encore une fois ». De manière magistrale.
La Passerelle est un roman de l’exil : à soi, aux autres, à sa famille et ses racines. Mais aussi un roman politique et social, fort, immense, tissé de détails qui font mouche, arrachent sourires et rictus. Tour à tour drôle et poignant. Qui passe à la loupe la vie contemporaine, qu’il s’agisse de la sphère privée (l’amour, l’enfant, les couples – hommes / femmes, parents / enfants –) ou de la sphère publique (la guerre en Irak, l’économie, le bio), deux sphères qui ne cessent de se télescoper, d’interférer, tout est passerelle, et avant tout le roman.
Sarah Brink, maniaque, fantasque, a une drôle d’habitude lorsqu’elle emprunte des livres :
« Je les passe au four pour tuer les germes. Je fais toujours ça avec les livres de bibliothèque. On m’a dit que l’on pouvait aussi tuer les microbes au four à micro-ondes, mais je n’en suis pas certaine ».
La Passerelle n’a pas été aseptisé. Il vous hantera longtemps :
« Mais sans avoir à faire de grands efforts, me reviendrait toujours son étrange histoire – même si je l’avais classée, comme un rêve, sur l’étagère la plus haute de mon cerveau – et j’y repenserais d’une telle manière que sa vie me semblerait la plus triste d’entre toutes. C’était comme Madame Butterfly, sauf que Sarah était à la fois Pinkerton et Kate. Ce qui différenciait l’opéra de la vie, avais-je compris, c’est que dans la vie, une seule personne interprétait tous les rôles ».
CMLorrie Moore, La Passerelle, roman traduit de l’anglais (USA) par Laetitia Devaux, L’Olivier, 361 p., 20 €
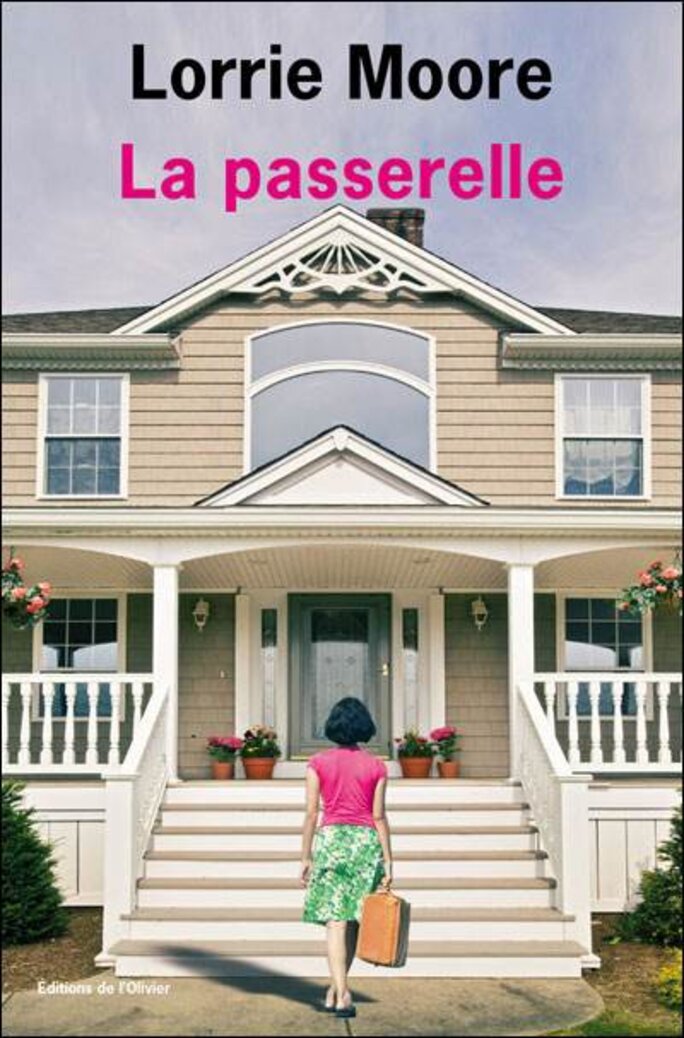
Agrandissement : Illustration 3
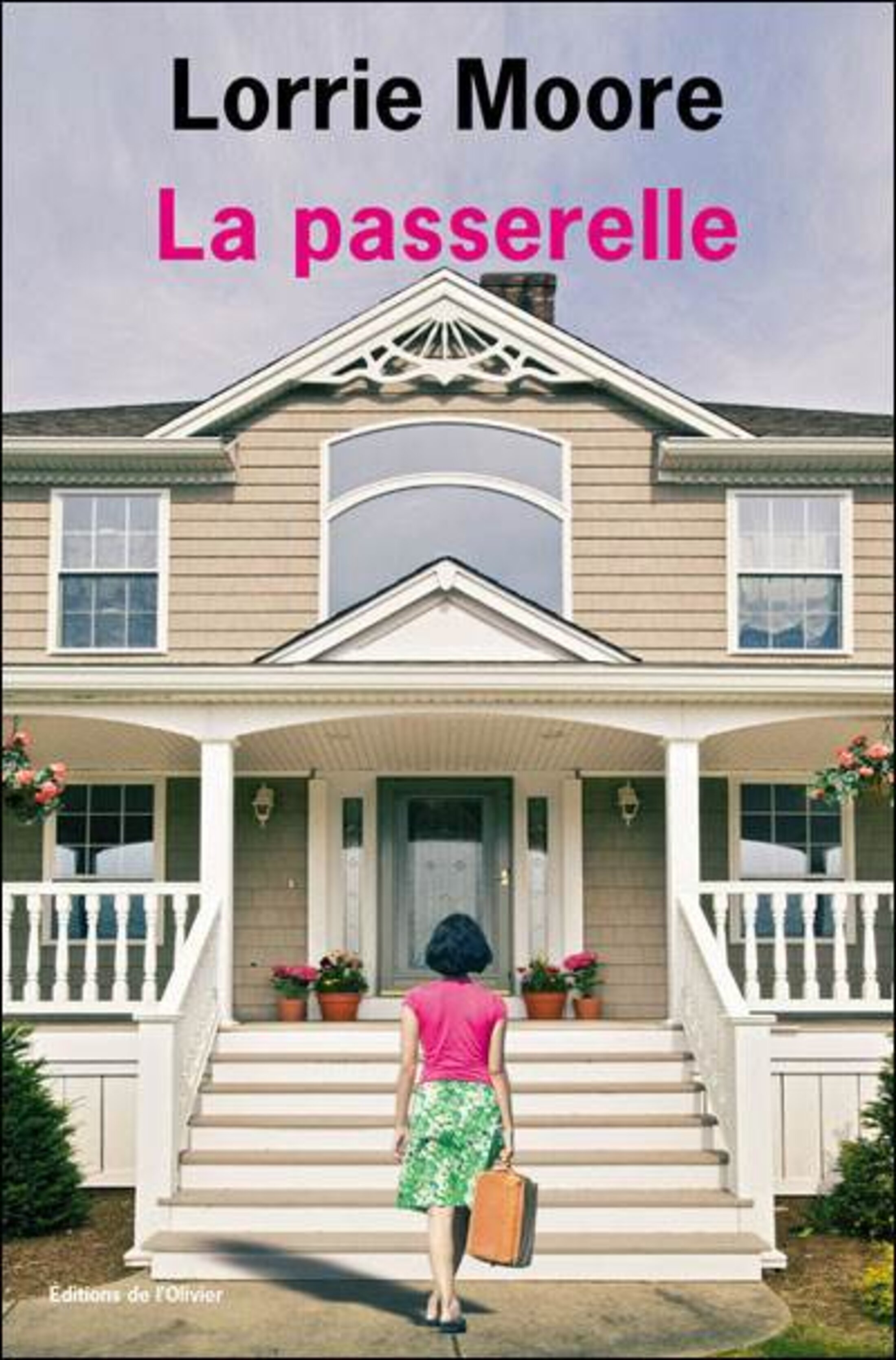
Et toujours :
Déroutes, Nouvelles traduites de l’anglais (USA) par Annick Le Goyat, Points, 357 p., 7 € 50
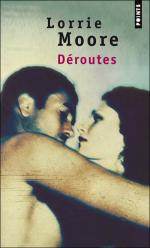
Et :
Des Histoires pour rien, Nouvelles traduites de l’anglais (USA) par Marie-Claire Pasquier, Points, 223 p., 6 €