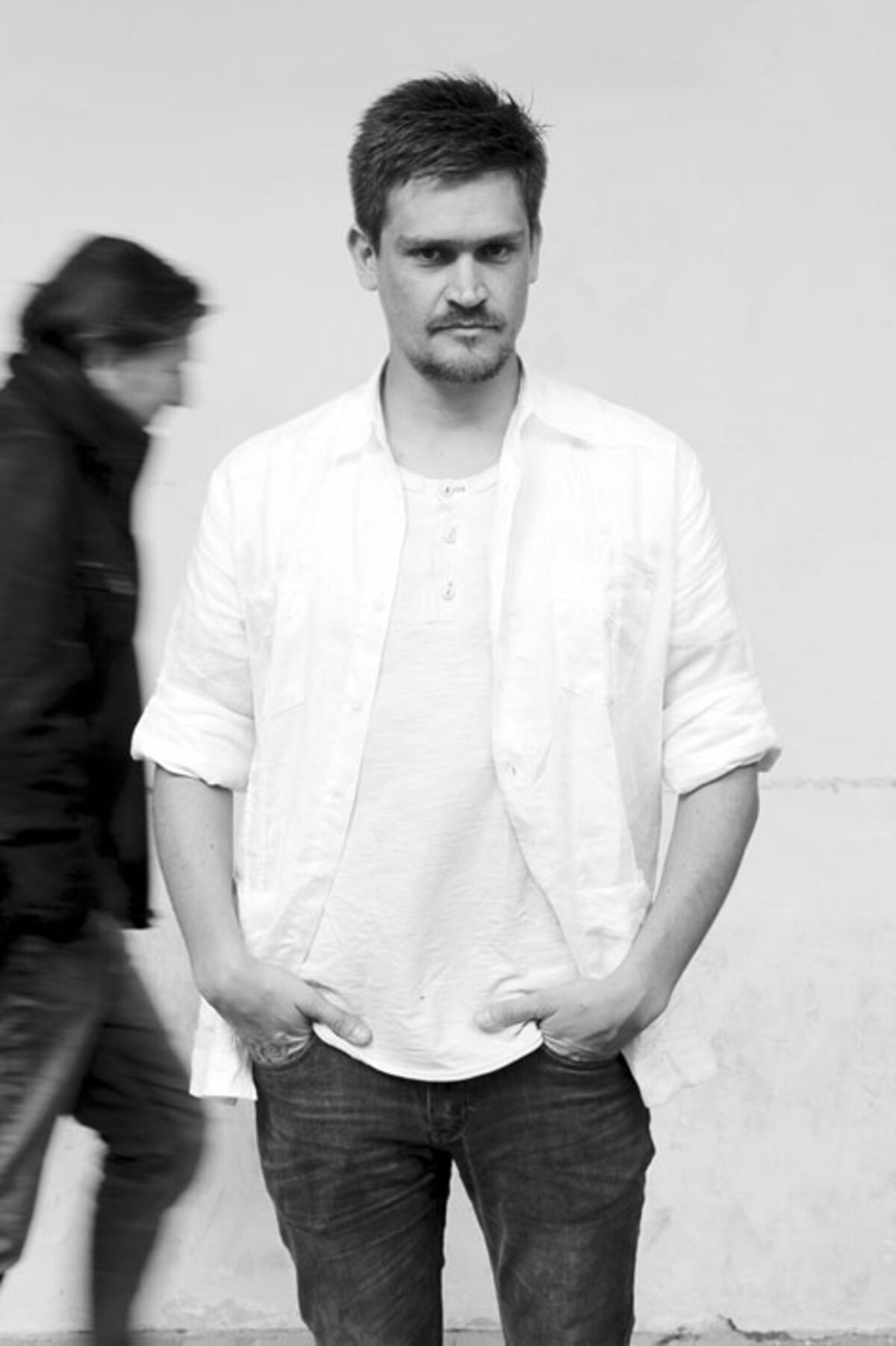
Agrandissement : Illustration 1
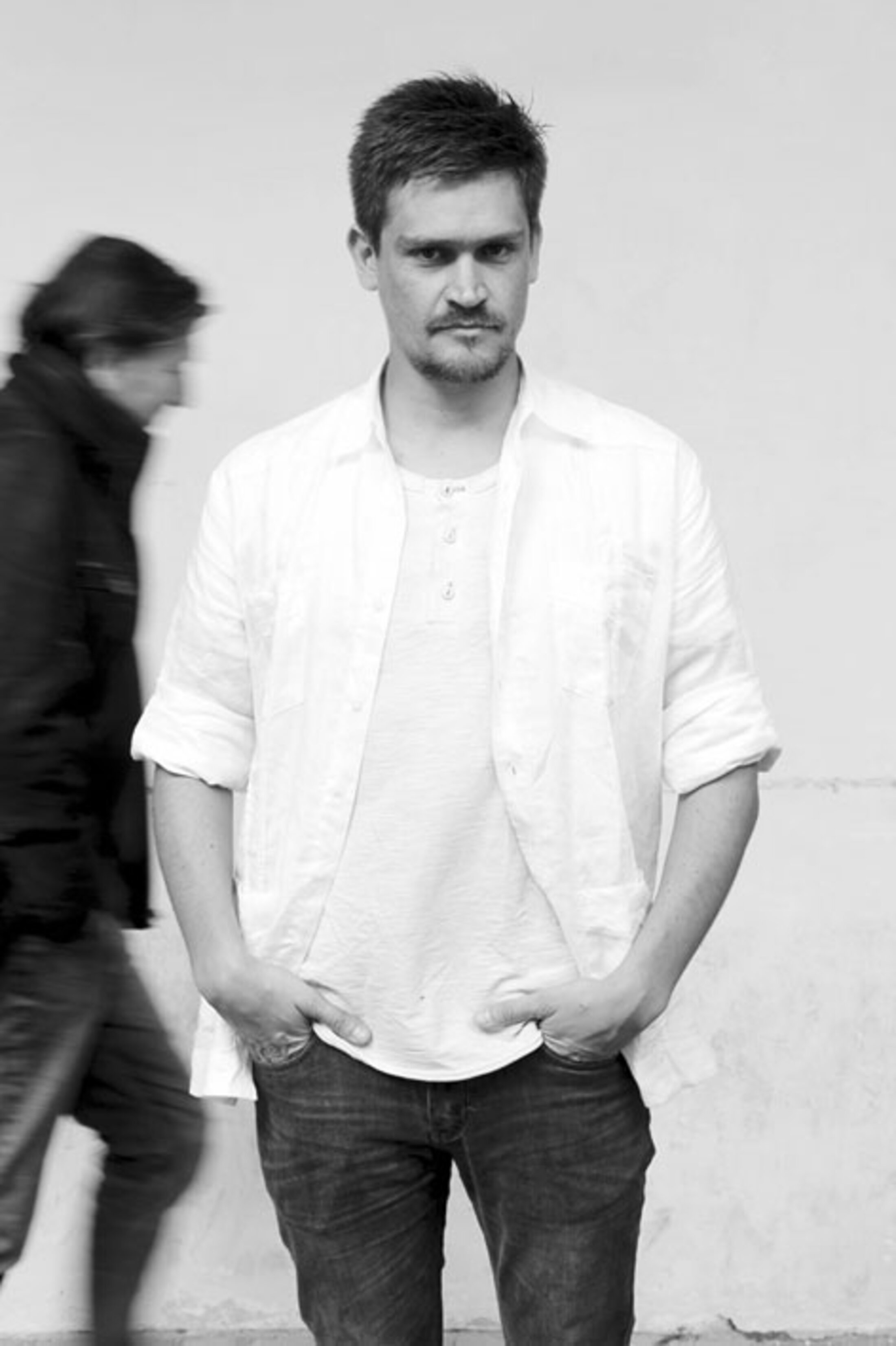
Quelle est l'origine du scénario de ton film, La Mujer de barro ?
Il y a plusieurs choses qui vont ensemble. D'abord, c'est une histoire issue d'un fait réel, qui a à voir avec une femme chilienne du nord du Chili, qui a souffert d'abus, notamment au travail. J'ai utilisé dans mon film une partie de la réalité de cette femme que je connaissais réellement. Le scénario a un peu commencé par là, à partir de mon expérience personnelle du moment où je l'ai connue. Il y a aussi l'inspiration d'une autre femme, qui a participé à mon éducation, depuis tout petit. Une femme qui a aussi souffert d'abus, qui était analphabète. Tous les étés elle partait. Elle travaillait à la maison, s'occupait des tâches domestiques. Et durant l'été elle rentrait chez elle au sud du Chili pour aller travailler là-bas. Elle a été une femme très importante dans mon enfance. Elle avait un fils et moi j'avais trois sœurs: son fils était donc comme mon unique frère. Parfois je préfère commencer à filmer dans des lieux sans savoir vraiment au début quelle histoire je vais raconter et d’autres fois, l'histoire vient ensuite. C'est un peu comme arriver dans un lieu, avoir envie d'y faire quelque chose mais sans savoir quoi au début. Le processus du fonctionnement d'un scénario est à l’inverse : d'abord tu écris, puis ensuite tu poses le décor.
Quel lien Catalina Saavedra (qui joue le personnage de Maria, ndlr) a-t-elle avec le lieu et les femmes qui y travaillent ?
Ça a été une coïncidence : au moment où elles sont arrivées dans le lieu où s'est fait le film, Catalina aussi était là. On participait ensemble à un festival de cinéma qui avait lieu sur place. Ça a retenu mon attention, comme si elle appartenait à ce lieu, et je lui en ai fait part. On était assez proche, et je lui en ai parlé comme ça, naturellement. Puis s'est passé un certain temps jusqu'à ce qu'on commence à tourner.
Comment s'est passé le casting ? Catalina Saavedra, Paola Lattus Ramos et Daniel Antivilo sont déjà présents dans le film Tuer un homme (Matar a un hombre) d’Alejandro Fernández (2014), qui traite d'un pays où la justice n'existe pas, où elle se pratique à titre individuel, comme dans La Mujer de barro.
On a toujours connu Daniel [Antivilo] comme un personnage méchant, mais c'est un homme très bon et très bien ! [rires]. Oui, il y a certains points communs. Le thème de la justice reflète une réalité très importante du Chili, qui est un pays très corrompu, où le système judiciaire ne fonctionne pas, où il faut être riche pour avoir accès à la justice. Donc c'était une manière de montrer que la justice se pratique et se règle à niveau individuel. Dans Tuer un homme, c'est encore plus présent, parce que ça a à voir avec un crime. La Mujer de barro montre plutôt la chute, le fait d’occulter l'injustice. Beaucoup de femmes acceptent ces abus par peur qu'on les renvoie de leur travail. C'est exactement ce qui est montré dans le film, au moment où l'on voit Maria qui serait presque prête à réagir, et puis finalement non, parce que ce sont des actes qui sont peut-être presque totalement acceptés. Il y a beaucoup de mères célibataires. Elles ressemblent beaucoup à ce qui est montré dans le film.
Tu as déjà travaillé sur ce thème de la femme et de ses enfants dans tes films précédents. D'où vient ce choix ?
J'ai une histoire familiale où mon père était toujours parti en voyage, je passais mon temps avec ma mère et mes sœurs. Les thèmes de la famille et du voyage ont toujours été très présents dans mes films. Mon premier film parle d'un voyage familial, de retrouvailles mais aussi d'abandon. Et dans La Mujer de barro on retrouve également ce thème, de Maria qui doit laisser sa fille durant toute une saison pour pouvoir aller travailler. J'ai une famille très heureuse ! [rires] La famille, c'est quelque chose de très intime. Chaque famille est unique, donc c'est vraiment intéressant de l'observer avec un regard unique. Il y a mille manières d'être une famille, c'est sans doute pour cela que j'aime beaucoup ce thème.
Un autre thème présent dans ton film est celui des droits des travailleurs et notamment des femmes . Le spectateur assiste à l'abus et l'exploitation de ces femmes au sein de l'entreprise. Elles n'ont aucun droit, elles vivent toutes formes d'abus, parfois jusqu'au viol.
Oui, le Chili est un pays très machiste. Ça m'intéressait beaucoup de traiter ce thème de l'égalité des sexes, ou plutôt l'inégalité des sexes. Et surtout en dehors de Santiago, la capitale, où l'abus de pouvoir des hommes sur les femmes, ou des patrons sur leurs employés, est pire encore. Pour mon film, je me suis servi de cette réalité. L'homme représentait l'image du pouvoir. Je voulais montrer le monde des hommes et celui des femmes très différemment. Oui, tout cela a à voir avec l'exploitation, le capitalisme aussi, et la mondialisation. Nous buvons ces raisins, nous consommons ce vin, que nous payons très cher. Les entreprises s'enrichissent, avec une main d’œuvre qui ne coûte pas cher et qu'ils peuvent exploiter à leur guise.
Ton film a aussi un aspect très documentaire. Les travailleuses de ton film semblent faire partie de la réalité de cette entreprise.
Oui, c'est quelque chose de très important. Ces femmes effectivement ce ne sont pas des actrices professionnelles, elles étaient réellement en train de travailler pendant le tournage. Par exemple, toutes les séquences qui se passent dans l'eau correspondent à leur jour de congé. C'était très important pour toute l'équipe de réussir à entrer dans leur monde et ses fonctionnements, et il était hors de question qu'on ne respecte pas leurs horaires de travail et leur temps libre. C'est pour cela aussi que le film devait être tourné pendant la période des vendanges, qui dure seulement 2 ou 3 mois dans cette zone géographique. C'est un film que nous n'aurions pas pu tourner en hiver, par exemple.

Agrandissement : Illustration 2

Pourquoi as-tu choisi de faire de cette réalité une fiction plutôt qu'un documentaire ?
Il y a plusieurs raisons. D'un côté le choix de la fiction me laissait plus de libertés. D'un autre côté le lieu m'intéresse énormément, peut-être parce que je sens qu'elles vivent là-bas dans une réalité sinistrée représentative de ce qu'on est tous en train de vivre, surtout en Amérique latine.Il s'agit aussi tout simplement d'une préférence personnelle pour la fiction.
N'est-ce pas aussi une question de pudeur ?
Oui, je pense qu'il s'agit plutôt de traiter le monde de ces femmes le plus respectueusement possible, en le racontant comme une histoire. J'ai déjà travaillé sur des documentaires, mais à un autre endroit. J'ai toujours été très intéressé par le mélange des genres.
Comment as-tu travaillé avec Catalina Saavedra et Sergio Armstrong, deux professionnels émérites du cinéma chilien ?
Je n'aime pas tellement que le jeu d'acteur soit trop marqué. Bien sûr Catalina Saavedra a joué dans énormément de films, mais je pense que pour celui-ci elle a dû se sentir un peu plus libre. Elle a pu s'inspirer de ce qu'elle observait chez les autres femmes, et elle a dû aussi accepter les moments où elle devait vraiment jouer le personnage. Ce qui est parfait, parce que le mélange des deux a fait ressortir certaines similitudes et une impression de réalité. Pour ce qui est du travail sur la photographie de Sergio Armstrong, c'est tout le contraire. Il y a un moment qui a été filmé entièrement caméra à la main. On est allé faire un tour et j’ai demandé à Sergio de faire tout ce qu'il voulait avec les caméras à sa disposition. Parce que je sentais que ce film ne devait exercer aucun préjudice, ce qui aurait ressemblé à ce qui se passait pour ces femmes. De l'intérieur la caméra devait également suivre la même intention. C'est aussi pour cela qu'à certains moments les corps sortent du cadre, comme pour ne montrer qu'une portion de la réalité. De cette manière, le personnage de Maria n'a rien à cacher, comme si elle sentait elle aussi que la caméra pouvait oublier des choses.
Quelle est la réalité de la vallée aujourd'hui ? Que va-t-il se passer pour ces femmes qui travaillent dans cet endroit ?
Actuellement, l'endroit est identifié comme zone dangereuse, à cause de la sécheresse. Il n'y a plus d'eau. Une entreprise minière est sur le point de s'y installer, donc ils sont en train d'extraire toute l'eau qu'il y a dans la zone. Donc ce qui va se passer, apparemment, c'est qu'ils vont raser les vignes et transformer tout ça en village minier. Ce qui va se passer pour ces femmes ? Elles vont se mettre à chercher du travail au même endroit. Si le film s'était fait 10 ans plus tard, il se passerait au même endroit, avec les mêmes femmes, mais dans une entreprise minière. Cet endroit est en train de souffrir énormément du manque d'eau, c'est vraiment triste.
Le titre, La Mujer de barro, parle de la terre. On pourrait presque trouver un lien entre l'exploitation des femmes et l'exploitation de la terre, au sens aussi où cette terre est vendue à une multinationale qui va l'exploiter d'une autre manière. Comme si la terre était pensée comme un lieu sans vie, qui sert uniquement à faire toujours plus d'argent.
Le titre se réfère à beaucoup de choses, mais en effet aussi à l'exploitation de la terre. Nous appartenons à la terre, mais elle ne nous appartient pas. Par exemple, au moment du tournage, ces femmes me disaient qu'elles savaient mieux que quiconque quand le raisin était prêt à être cueilli. Parce que ce sont elles qui le sentent, elles qui le goûtent, elles qui le touchent. Mais dans la chaîne de production, ce savoir n'a aucune valeur, il n'est absolument pas reconnu. L'exploitation touche aussi au nombre d'heures travaillées. Elles appartiennent à la terre parce qu'elles l'aiment, mais les responsables de la production les rejettent. Et bien sûr, ce titre parle de la fin du film, à ce moment le titre devient littéral, se matérialise. Comme un retour à la terre, un retour au réel, avec la terre qui nettoie, qui régénère, qui permet de « changer de peau », pour permettre à Maria d'aller atteindre sa vraie nature.
Et maintenant que va-t-il arriver aux femmes qui travaillent là-bas ?
Personne ne le sait. Parce qu'en plus la mine est un milieu très machiste. En général les femmes ne travaillent pas dans les entreprises minières. Ce qui risque d'arriver, je pense, c'est que ces femmes migrent ailleurs, parce qu'au fond il n'y a sans doute que cela à faire. Elles n'arrêteront pas les travaux saisonniers, elles aiment ça, au point qu'elles sont capables de se déplacer avec leur famille d'un lieu à l'autre. C'est un sujet important, qui a à voir avec le thème de la migration, et des conditions de vie souvent inscrites dans une pauvreté extrême. Mais elles aiment ce qu'elles font. C'est quelque chose qu'on a mis du temps à comprendre, Catalina et moi. Catalina a été très touchée par cette expérience, par tout ce qu'elle a partagé pendant le tournage avec ces femmes. Ça l'a certainement beaucoup aidée dans l’interprétation de son personnage, mais ça a été super dur.

Agrandissement : Illustration 3

Oui, on retrouve très bien ce thème dans le film, avec Maria qui travaille là-bas pour financer son voyage jusqu'à Santiago...
… qu'on ne voit même pas dans le film. Oui, c'est une sorte d'utopie que portent les personnes qui vivent à la campagne, de voyager à la ville, comme un rêve inaccessible. Ils voient la ville comme la Mecque des opportunités, ils pensent qu'il vont pouvoir gagner beaucoup d'argent, ce qui est un leurre. Ça me semblait intéressant que ce rêve ne se réalise pas, qu'on ne voie pas sa réalisation dans le film.
On est en train de parler de cette région, de machisme, de la politique actuelle au Chili... Il y a plusieurs réalisateurs en ce moment qui s'inscrivent dans un cinéma plutôt engagé, qui offrent un regard sur l'état actuel de la société chilienne... As-tu l'impression de faire partie de ce nouveau courant du cinéma chilien, qui est plus représentatif du Chili d'aujourd'hui et de ce qu'il y aurait à dénoncer ?
Je ne sais pas si j'ai l'impression de faire partie d'un mouvement. Mais je pense que le cinéma est un moyen de communication très fort, comme une arme, qui peut servir à dénoncer certaines réalités. Quoi de mieux que le cinéma pour commencer à faire ces dénonciations ? C'est une arme de communication massive ! Dans un sens, et ça m'intéresse beaucoup, le cinéma est un bon moyen d'investigation pour poser des questions, et pas forcément pour donner des réponses. Peut-être que les personnes qui voient mon film en salles se retrouvent dans un certain inconfort face à une fin qui ne donne qu'une moitié de réponse. Mais pourquoi pas ? La vie non plus n'a pas de réponse. C'est très complexe de donner des réponses sur de tels abus. Il y a des réalisateurs qui travaillent là-dessus, mais d'un autre côté j'ai l'impression que le cinéma chilien a déjà laissé de côté les thèmes de la dictature, comme s'ils étaient sur quelque chose qui leur est propre, ou comme s'ils commençaient à toucher à quelque chose qui ressemblerait plus à « l'histoire des histoires », quelque chose de plus profond et de moins littéral. Pendant longtemps le cinéma chilien a été révolutionnaire, a contesté la dictature. Maintenant on est à un tournant générationnel. Aujourd'hui on trouve des comédies, des films à dimension sociale, plutôt des films de genre. C'est très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup plus de diversité aujourd'hui qu'auparavant.
On peut aussi constater ce changement dans le cinéma de Patricio Guzmán. Dans les années 1970, il se mettait en relation directe avec ce qui se passait dans la société, caméra à la main. Et peu à peu, notamment depuis Nostalgie de la lumière, il a commencé à présenter la situation en utilisant les ressorts de la poésie.
Oui, complètement. C'est comme regarder les choses d'un autre point de vue. Finalement c'est très politique, mais ça dépend de comment et d'où l’on regarde, et quelle forme se lit. Pour moi le cinéma est quelque chose de très formel. Je crois qu'il a beaucoup plus à voir avec « comment on raconte une histoire », qu'avec « quelle est l'histoire qu'on raconte ». Je m'intéresse beaucoup à tout ça, au « comment » : comment se produisent les faits, et de quelle manière on les met en avant.
C'est aussi toi qui a réalisé le montage du film. Peut-être que ce moment du montage est celui où l'on commence à « faire fiction », à raconter plutôt que de montrer la réalité de manière plus réaliste ou documentaire ? Comment as-tu travaillé cela ? Est-ce pour toi un endroit important pour développer l'histoire racontée ?
J'aime beaucoup le montage. C'est le moment où je me sens le plus à l'aise. Pour ce film on a aussi travaillé avec une très bonne monteuse : Andrea Chignoli. Et on s'est livré à une petite expérimentation : elle a monté sa propre version du film, et moi de mon côté la mienne. On ne s'est pas vus pendant deux mois. Puis nous nous sommes retrouvés et nous avons comparé. C'était super intéressant parce que dans le scénario il y avait un troisième acteur, et elle l'a complètement retiré au montage. Elle voulait quelque chose de concluant. Depuis le début du scénario, ce point n'était pas très clair, et ça se sentait dans les plans tournés, donc elle l'a complètement occulté, mais sans s'en apercevoir vraiment. On a donc commencé à travailler sur sa version du montage. C'est moi qui ai terminé de monter le film, mais finalement c'est comme un montage commun. Ça a été vraiment intéressant de travailler comme ça. Aussi parce que, monter un film, c'est une manière de réécrire, on revient à l'écriture. D'une certaine forme, le film qu'on voit, le film terminé, c'est le scénario. Et le scénario qu'on écrit au départ, représente le premier montage du film. Oui, je mets beaucoup dans le montage, ça m'intéresse énormément, et ça m'intéresse aussi qu'on puisse le visualiser dans le scénario, qu'on puisse quasiment déjà le lire. C'est tout un monde, tout ça !
Entretien réalisé à Toulouse en mars 2015 pendant le festival Cinelatino, par Adeline Bourdillat et Cédric Lépine. Traduit de l'espagnol par Adeline Bourdillat.



