Cédric Lépine : Est-ce que parler de l'histoire méconnue en France d'une Église catholique de gauche participant active dans les mouvements révolutionnaires en Amérique latine était votre intention initiale en réalisant ce film ?
François-Xavier Drouet : C'est sûr qu'en France, où la gauche s’est en partie structurée sur le combat contre l'Église et l'anticléricalisme, je pense qu'on n'a pas su voir la participation des chrétiens aux luttes sociales du XXe siècle, et pas seulement en Amérique latine. Il suffit pour cela de voir comment on parle de façon un peu condescendante des « cathos de gauche ».
On oublie que jusqu’aux années 1970, le clergé votait majoritairement à gauche, que de nombreux prêtres se sont engagés dans la Résistance, il y a même eu des curés porteurs de valises pendant la guerre d’Algérie… Cette histoire est méconnue et mal comprise. Il y avait donc un enjeu à montrer que la religion ne rime pas toujours avec aliénation et que la foi peut aussi être un facteur d'émancipation. Qu’on peut être engagé à gauche non pas en dépit mais à partir de sa foi.
La théologie de la libération reste donc logiquement très méconnue en France. J'ai aussi fait ce film au moment où les générations qui s’inscrivaient dans ce mouvement disparaissaient et il y avait une urgence à recueillir cette mémoire.
C. L. : Vous sous-entendez aussi que pour comprendre l'histoire de l'Amérique latine au XXe siècle, cela passe par la mise en valeur des enjeux religieux de gauche.
F-X. D. : J'ai voulu porter un nouveau regard sur l'histoire révolutionnaire de l'Amérique Latine, sur laquelle on a beaucoup projeté nos désirs depuis l'Europe. C'était la région où la révolution était l'horizon, qui a suscité énormément d'espoir, de Cuba jusqu'aux Zapatistes. Raconter cette histoire à travers la participation des chrétiens permet vraiment de comprendre que la foi a été un moteur d’engagement puissant pour de nombreux militants, mais aussi que l’Église a parfois accompagné cet élan révolutionnaire.
Bien sûr l'Église a été complice de la colonisation, de l’esclavage, du génocide indien et aujourd'hui encore, la religion est utilisée par les élites d'extrême-droite pour asseoir leur emprise. Mais le christianisme est aussi traversé par des contradictions et l'Église n'a pas toujours été du côté du pouvoir. Pendant la guerre froide, il y a eu un affrontement entre la hiérarchie ecclésiale, plutôt conservatrice et proche des régimes militaires, et une Église de base, une Église des pauvres, qui a porté un message de libération et résisté aux dictatures. Cette Église a profondément influencé le paysage politique à gauche, avec par exemple une organisation comme le Mouvement des Sans Terre au Brésil, qui en est directement issu. De nombreux leaders politiques ou syndicaux ont fait leurs armes au sein des organisations chrétiennes, et Lula s’est souvent défini comme « enfant de la théologie de la libération ».
J'avais aussi à cœur de faire une histoire par le bas, de ne pas m'intéresser qu'aux théologiens ou aux grandes figures. Au fond la théologie de la libération n’a fait que formuler en termes savants des pratiques qui existaient dès les années 1950-60 dans les communautés chrétiennes. Je voulais parler de ces anonymes qui ont lutté au nom de leur propre lecture de l'Évangile, où Jésus était vu comme une figure révolutionnaire. Dans ces groupes, les femmes avaient une place très importante qui a souvent été invisibilisée.
C. L. : Comment avez-vous procédé pour écrire le scénario de cette fresque historique ?
F-X. D. : Il y a finalement peu d'ouvrages qui apportaient un regard global et rétrospectif sur cette histoire, à l’exception notable de ceux du sociologue franco-brésilien de Michael Löwy. Il a donc bien sûr fallu faire par un gros travail de recherches, mais je ne suis ni historien, ni journaliste. Je suis cinéaste, j'essaie donc de construire un film à partir d'histoires et de personnages. J'ai d’abord fait des voyages de repérages pour retrouver les survivants de ce mouvement. Je voulais que chaque personnage convoqué dans le film parle à partir de sa propre expérience. Ils ne parlent pas sur le sujet : ils font eux-mêmes partie de l'histoire et c’est ce qui fabrique l’émotion. J'ai essayé de tisser un récit choral, en collectant ces histoires, qui à la fin forment une sorte de fresque.
J’ai trouvé pour cela une source d’inspiration dans les livres de l’écrivain uruguayen Eduardo Galeano. Ses ouvrages ont été très importants pour la conscientisation politique de plusieurs générations de militants en Amérique latine, depuis les années 1960. Il avait cette capacité dans ses livres à être un passeur de mémoire, à raconter une grande histoire à partir d’une multitude d’événements à différentes échelles. Il a donné aux latino-américains la conscience de participer d’une histoire commune.
Encore une fois, je ne fais pas œuvre d'historien, au sens où, en tant que cinéaste, j'assume une subjectivité et le film n’est en rien exhaustif. Le matériau que j’ai recueilli peut néanmoins servir à titre d’archives et j’espère trouver une manière de mettre à disposition des historiens une partie de mes rushes. C’est déjà le cas des images filmées au Salvador, que j’ai léguées au Musée de l'image et de la parole (Museo de la Palabra y la Imagen), un centre d'archives autour de la mémoire de la guerre civile.
C. L. : Comment s'est passée la recherche des images d'archives ?
F-X. D. : Le fond était plutôt vaste. Il faut se rappeler que dans les années 1970-80, l'actualité de l'Église était davantage couverte par les médias. La fracture entre l'Église des pauvres et cette Église hiérarchique institutionnelle, c'est quelque chose qui avait aussi beaucoup titillé les rédactions à l'époque. On retrouve souvent cet angle dans les reportages des télévisions européennes et nord-américaines. Le frein était néanmoins le coût. Une minute d’archives de la RAI pour le cinéma c’est 5000 euros !
J’ai donc surtout utilisé des images de cinéastes militants des années 1970-80. En revoyant leurs films, que je connaissais pour la plupart, j’ai réalisé que la plupart font référence au rôle des chrétiens dans ces luttes, mais ça m’avait jusqu’ici échappé ! Par exemple ABC da Greve de Leon Hirszman, auquel j’emprunte une séquence donnée à São Paulo pour les ouvriers en grève. Il y a aussi beaucoup de films de propagande de la guérilla au Nicaragua et au Salvador, auxquels j’ai eu librement accès.

Agrandissement : Illustration 1
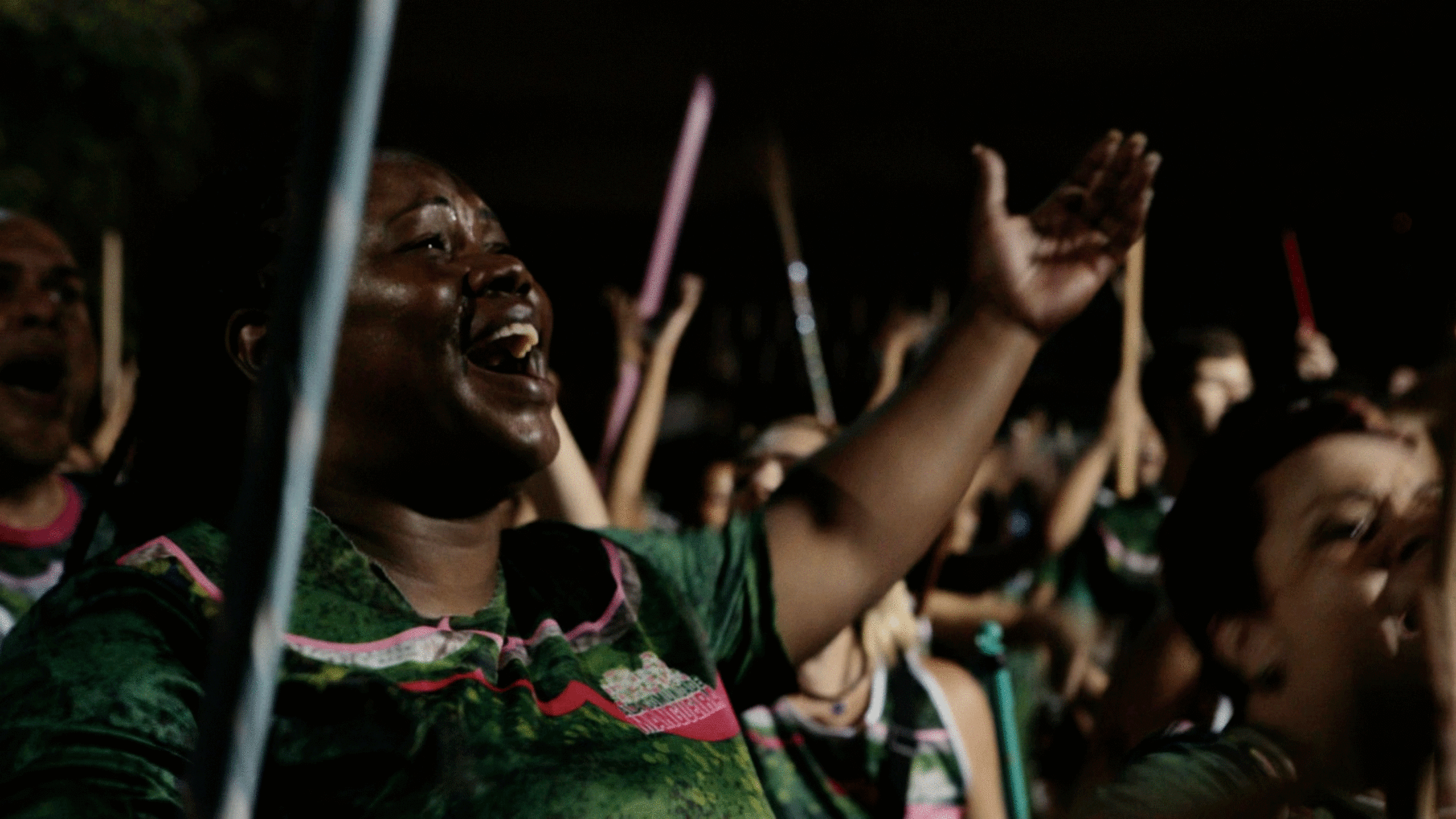
C. L. : Avez-vous pu dialoguer avec les cinéastes militants des pays que vous avez traversés ?
F-X. D. : Beaucoup sont malheureusement décédés. Je les ai surtout contactés pour négocier l'achat des archives et cela se passait plus ou moins bien. Quand on se présente comme cinéaste européen on est tout de suite soupçonné d’avoir beaucoup d’argent !
Le seul réalisateur avec qui j'ai vraiment dialogué pour faire ce film est Patricio Guzmán, qui a tourné deux documentaires autour de la théologie de la libération, plutôt méconnus dans sa filmographie : En nombre de Dios et La Cruz del Sur. Il avait prédit qu’il me faudrait dix ans pour faire ce film, ça ne m’en a finalement pris que cinq. Je lui ai emprunté une séquence à l’école des Amériques, où les tortionnaires des régimes militaires étaient formés par les USA. Il m’a aussi mis en contact avec un prêtre chilien extraordinaire, Mariano Puga, mais il est malheureusement décédé pendant mes repérages.
C. L. : En quoi le film représente les espoirs politiques de votre génération ?
F-X. D. : Ma place, je la pose dès le début, celle d’un athée pour qui l’Amérique latine a énormément compté dans son éducation politique. Je fais partie de cette génération un peu orpheline des utopies et qui a dû se construire, comme elle a pu, en bricolant, avec comme boussole la mémoire des luttes.
La figure du sous-commandant Marcos a été importante pour moi, mais j’'aurais pu aussi parler de l'alter mondialisme et du Forum social de Porto Alegre. J'ai découvert en faisant le film que son fondateur, Chico Whitaker, était très proche de la Théologie de la Libération et de l’évêque brésilien d'Hélder Câmara. J’étais été attiré dans les années 1990 par les organisations qui expérimentaient des formes de démocratie directe, qui remettaient en question les formes classiques de leadership. De ce point de vue l’expérience Zapatiste est irremplaçable. Le sous-commandant Marcos a toujours essayé de déjouer le culte du chef en brouillant les pistes à plusieurs niveaux.
Au final je me sens très proche de la vision du monde portée par la Théologie de la Libération. C'est une pratique qui exige de penser le monde par le bas, en se mettant à la place des plus marginaux, de regarder la réalité à partir d'eux. Et c'est aussi, je pense, un mouvement qui porte en lui quelque chose de fondamentalement anti-autoritaire, ce qui l’a rendu assez difficilement récupérable. D'ailleurs, chaque fois que des figures de ce mouvement ont été appelées à exercer des fonctions politiques, elles ont fait l'expérience des contradictions du pouvoir et sont arrivées à la conclusion que leur place n'était pas là. Il y a d’ailleurs toujours eu une tradition libertaire dans le christianisme, certains voient même Jésus comme une figure anarchiste.
C. L. : Qu'attendez-vous de la sortie du film en salles dans un contexte politique en France en septembre 2025 particulièrement chargé ?
F-X. D. : Si j'ai tenté de raconter cette histoire, c'était parce que je pensais que ces femmes et ces hommes avaient quelque chose à nous apprendre de leur expérience, que l’on soit croyant ou pas. Mélancolie de gauche (2016) d'Enzo Traverso est un ouvrage qui a beaucoup orienté mon regard. Certes, le rêve révolutionnaire en Amérique latine a été fracassé par la violence des dictatures militaires, mais il est porteur de graines pour les combats à venir. Cette mémoire des luttes perdues, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans l'imaginaire de la gauche depuis deux siècles.
Cette histoire de lutte est un peu comme une flamme qu'il faut protéger, une mémoire à transmettre, en attente d'être réactivée. Je crois que c'est ce qui m'a animé dans l'écriture alors que cette histoire n'est plus forcément très connue d’une partie du public. Qui aujourd'hui se souvient de la révolution au Nicaragua, de la guerre civile au Salvador ? J'aimerais que le film puisse avoir cet écho auprès des spectateurs et des spectatrices.

Agrandissement : Illustration 2
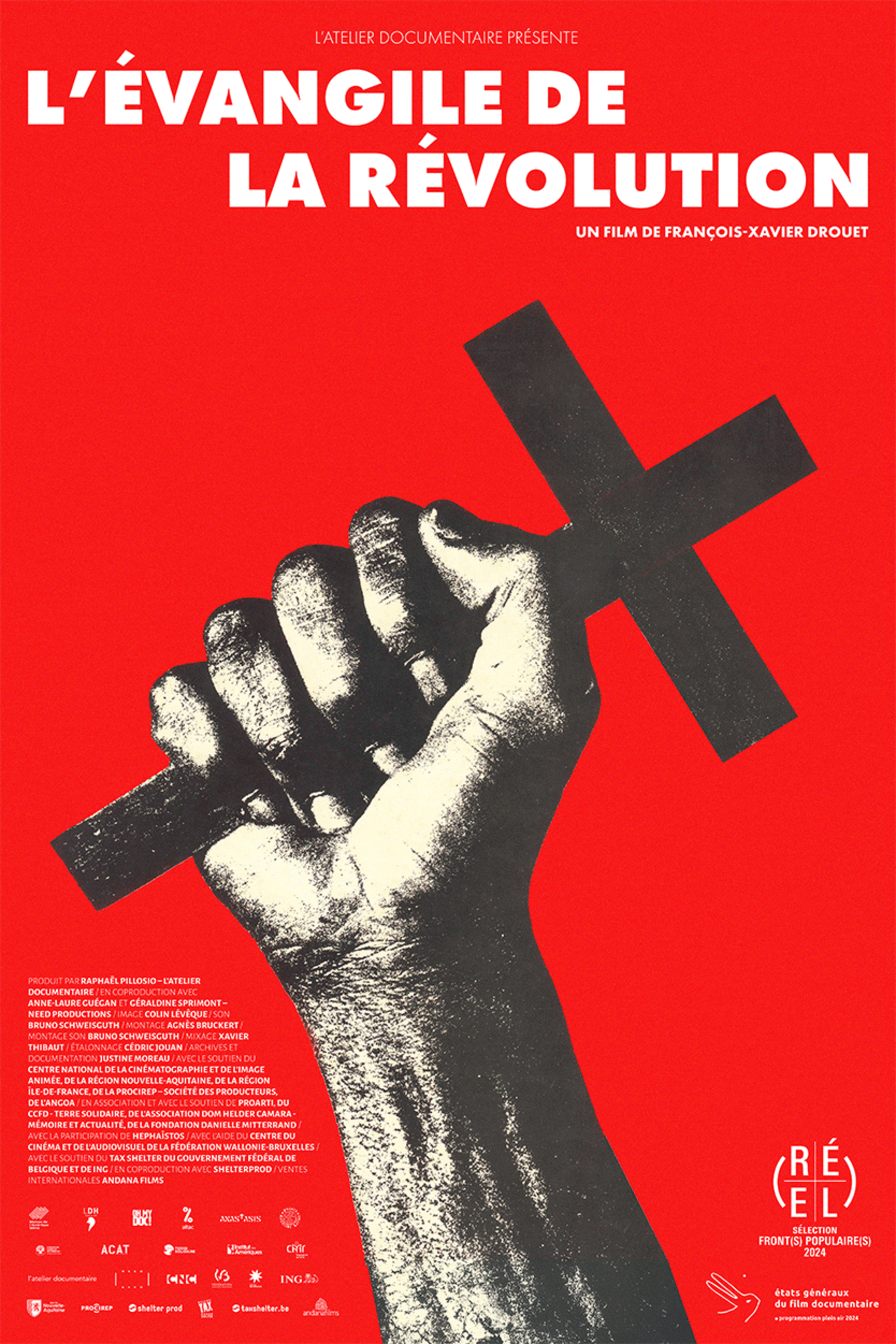
L'Évangile de la Révolution
de François-Xavier Drouet
Documentaire
115 minutes. France, Belgique, 2024.
Couleur
Langue originale : français
Auteur : François-Xavier Drouet
Images : Colin Lévêque
Montage : Bruno Schweisguth
Son : Bruno Schweisguth
Mixage : Xavier Thibaut
Étalonnage : Cédric Jouan
Production : Raphaël Pillosio France (L’Atelier documentaire)
Coproduction : Anne-Laure Guégan, Géraldine Sprimont (Need Productions)
Partenaires : Fédération Wallonie-Bruxelles, Shelter prod, CNC, Région Île de France, Région Nouvelle Aquitaine
Distribution (France) en salles : L’Atelier documentaire
Ventes Internationales : Andana Films



