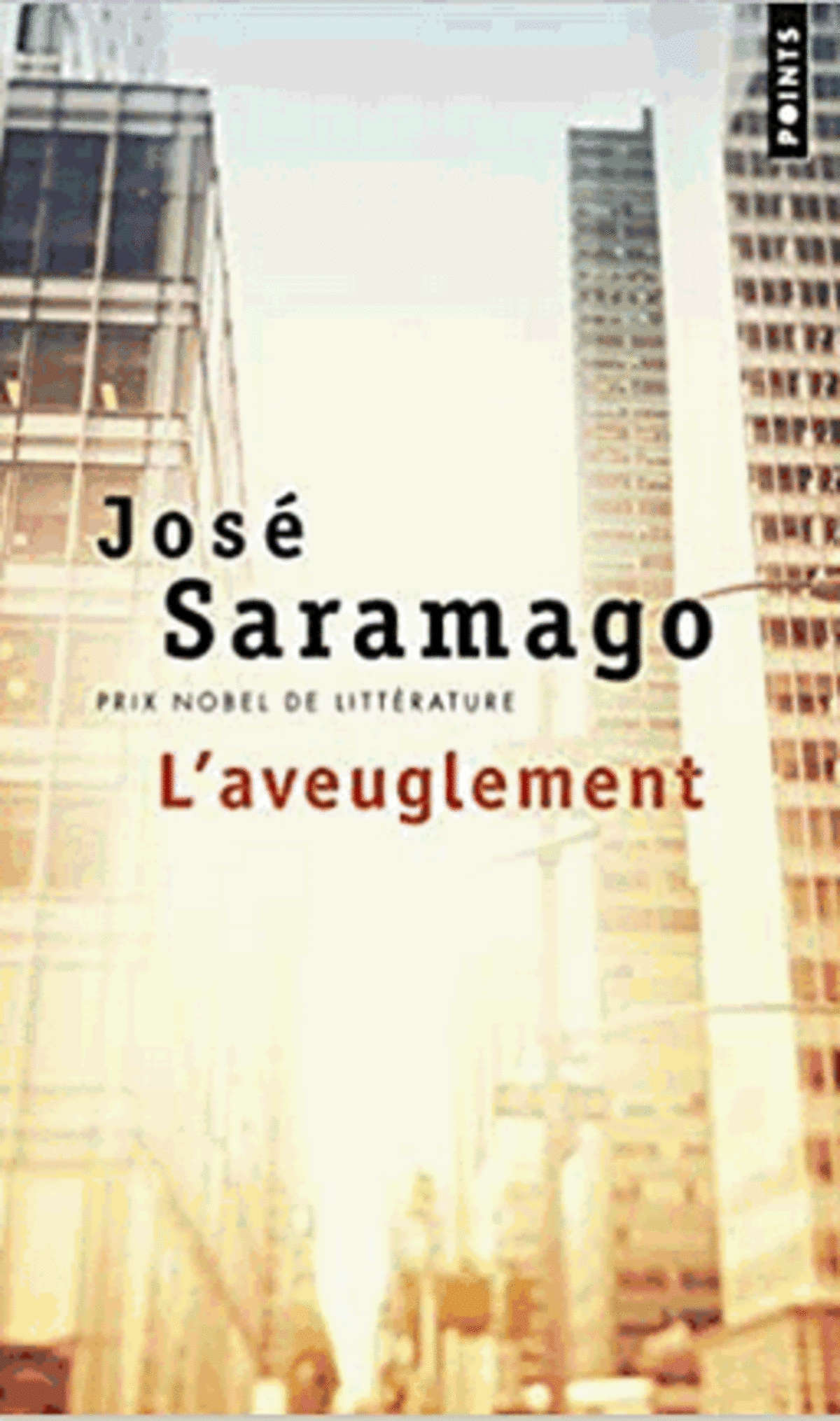
Les premiers aveugles sont internés puis livrés à eux-mêmes dans une ville à l’abandon. Des hommes vont être les victimes de la force brutale d’autres hommes. C’est évidemment la litanie de l’histoire sans cesse recommencée, la possible anomie qui refait surface et contre laquelle il faut toujours lutter. Seule une femme remarquable n’est pas touchée. Il est en effet question dans ce roman d’aveuglement et non de cécité. L’intelligence de la sensibilité, la générosité, l’humanisme d’un personnage vont permettre à certains d’être sauvés. « L'humanisme, ce n'est pas dire : "Ce que j'ai fait, aucun animal ne l'aurait fait", c'est dire : "Nous avons refusé ce que voulait en nousla bête." » (André Malraux).
Le prix Nobel 1998 n’indique dans ce livre ni le temps, ni le lieu. Il ne donne pas non plus de nom à ses personnages – le médecin, la femme du médecin, le premier aveugle, la femme du premier aveugle, le garçon louchon, la jeune fille aux verres teintés ou le vieil homme au bandeau. Les dialogues eux-mêmes ne sont pas introduits classiquement par des guillemets ou des tirets, mais sont traités d’un seul jet. L'écriture de José Saramago est faite de longues phrases, rythmées par de nombreuses virgules. Elles comprennent aussi de nombreuses incises, qui sont autant de digressions à l'adresse du lecteur. Au gré de métaphores et d'anachronismes, l’auteur veut sans doute nous pousser à réfléchir par nous-mêmes. « L’aveuglement » – notamment en raison de la forme choisie – est un livre dur, étouffant, qui n’épargne rien au lecteur. Et malgré tout, le style de Saramago reste d'une remarquable fluidité.
« A la fin de ce siècle, il est devenu possible pour la première fois de voir à quoi peut ressembler un monde dans lequel le passé, y compris « le passé dans le présent », a perdu son rôle, où les cartes et les repères de jadis qui guidaient les êtres humains, seuls ou collectivement, tout au long de leur vie, ne présentent plus le paysage dans lequel nous évoluons, ni les mers sur lesquelles nous faisons voile : nous ne savons pas où notre voyage nous conduit ni même où il devrait nous conduire. » Il semble que José Saramago ait entendu Eric J. Hobsbawm et que métaphoriquement il nous rappelle « le passé dans le présent » ?



