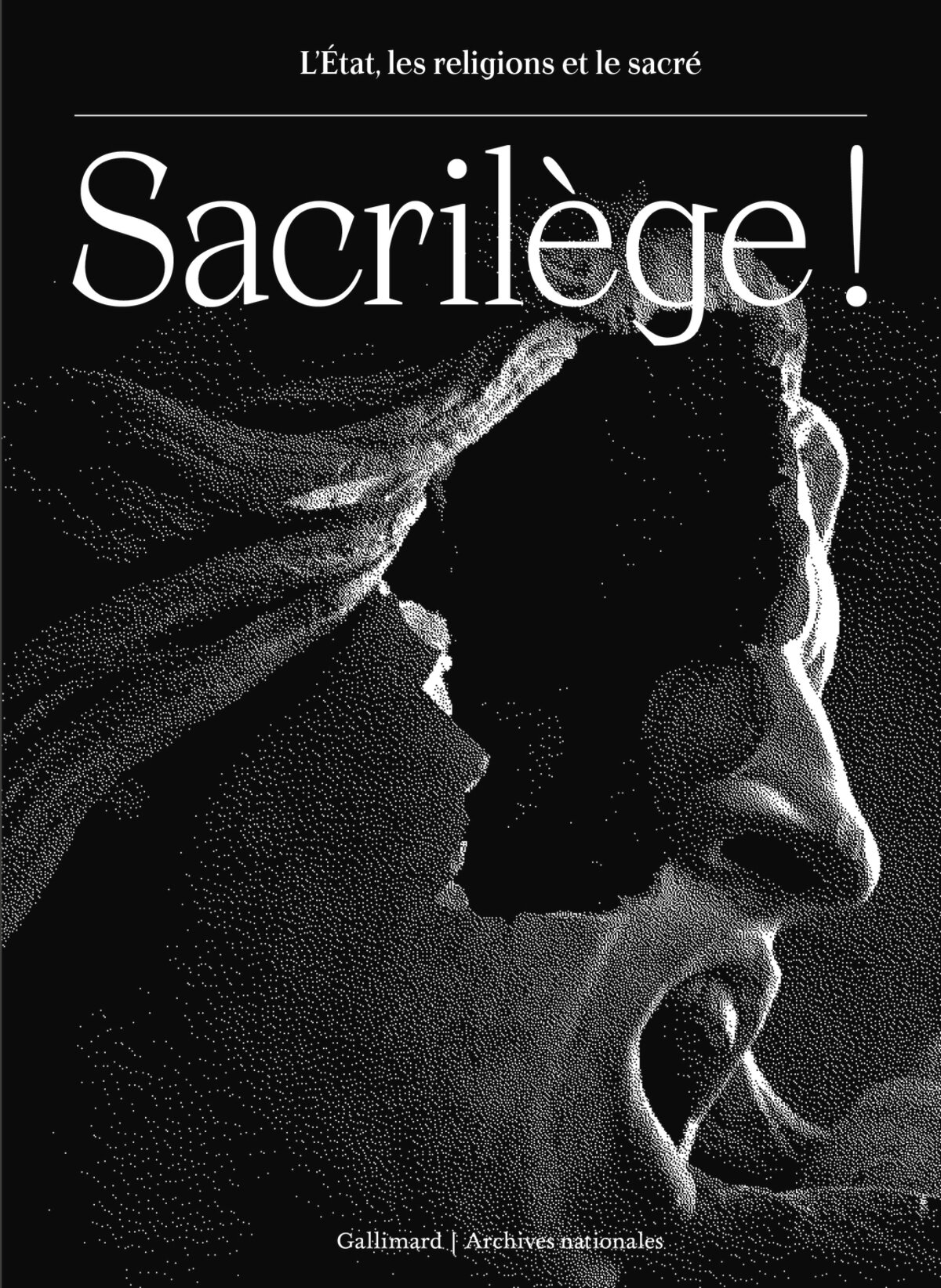
Agrandissement : Illustration 1
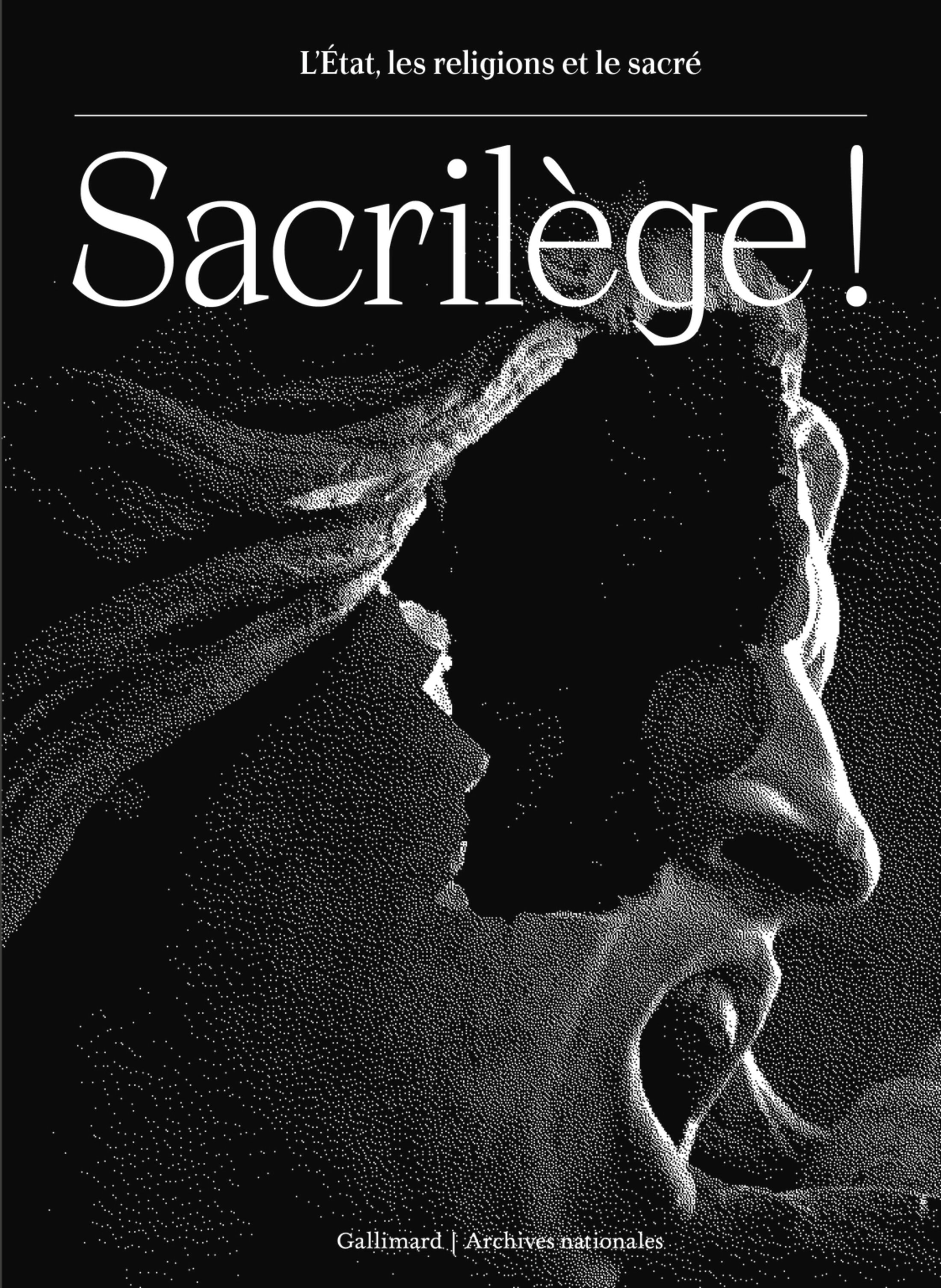
"Sacrilège ! L'État, les religions et le sacré, de l'Antiquité à nos jours": cette exposition des Archives nationales est à voir ! Un catalogue coédité avec Gallimard reproduit l’ensemble accompagné de sept textes denses, quatre étant due à Jacques de Saint Victor, d’une chronologie succincte et d’une bibliographie plus étoffée. Qu’on ne s’imagine pas découvrir dans ce lieu ou dans le catalogue une collection de caricatures, peintures, illustrations ou photos des sacrilèges les plus provocateurs. Tout cela est en vrac sur internet, où le mauvais goût graveleux, voire l’insulte, côtoie des œuvres de qualité dues à des anonymes ou à des auteurs majeurs. Nous y reviendrons…

Agrandissement : Illustration 2

Les documents ainsi rassemblés sont souvent inédits. Réunis, ils proposent une réflexion sur une notion, le sacrilège, qui a une histoire : celle d’une idée religieuse source de pouvoir. En France, dans une République laïque, cette notion n’a pas sa place dans le droit positif. Elle n’a de sens que pour celles et ceux qui y croient. Mais elle a aussi une histoire. La première gravure est explicite. Tirée d’un ouvrage de Boccace, elle représente le supplice des Templiers, victimes du roi Philippe le Bel. L’accusation de sacrilège justifiant le jugement politico-religieux. La dernière illustration représente la couverture de l’hebdomadaire « Marianne » sur l’assassinat de Samuel Paty. Nous sommes au cœur des débats les plus actuels.

Agrandissement : Illustration 3

Parmi les documents les plus instructifs figurent un tableau du XVI° siècle représentant Jésus de Nazareth devant le grand prêtre Caïphe ; un reliquaire représentant le martyre de Saint Etienne, juif converti au christianisme condamné à mort par le sanhédrin ; une miniature ottomane représentant Muhammad et son épouse Aïcha (théoriquement prohibée), la première caricature d’un roi de France, Henri III ; un vase décoré de dessins représentant la destruction des « idoles » païennes sous le règne de l’empereur romain converti au christianisme Constantin ; le procès-verbal du tribunal d’Abbeville et l’arrêt du Parlement de Paris condamnant à mort le chevalier de La Barre ; la tête du roi David, sculpture décapitée sur Notre Dame de Paris en 1793 et retrouvée avec d’autres têtes en 1977 ; ainsi que des photos montrant des dénonciations diverses de la « cathophobie », de la « lesbophobie » et de la désormais célèbre « islamophobie »… S’agirait-il de modernes blasphèmes ?

On distingue généralement le « blasphème », péché de bouche, du sacrilège, qui serait un acte. Les deux sont souvent confondus depuis le Lévitique décrétant : « Qui blasphème le nom du Seigneur devra mourir, toute la communauté le lapidera ». Ce passage de l’Ancien Testament aura une belle postérité au sein des deux autres religions monothéistes, le christianisme et l’islam. C’est toutefois le lien, et la concurrence, entre les pouvoirs dits « temporels » et « spirituel » qu’est consacrée une large partie de l’exposition et du catalogue. L'affaire du chevalier de La Barre reste un exemple emblématique.
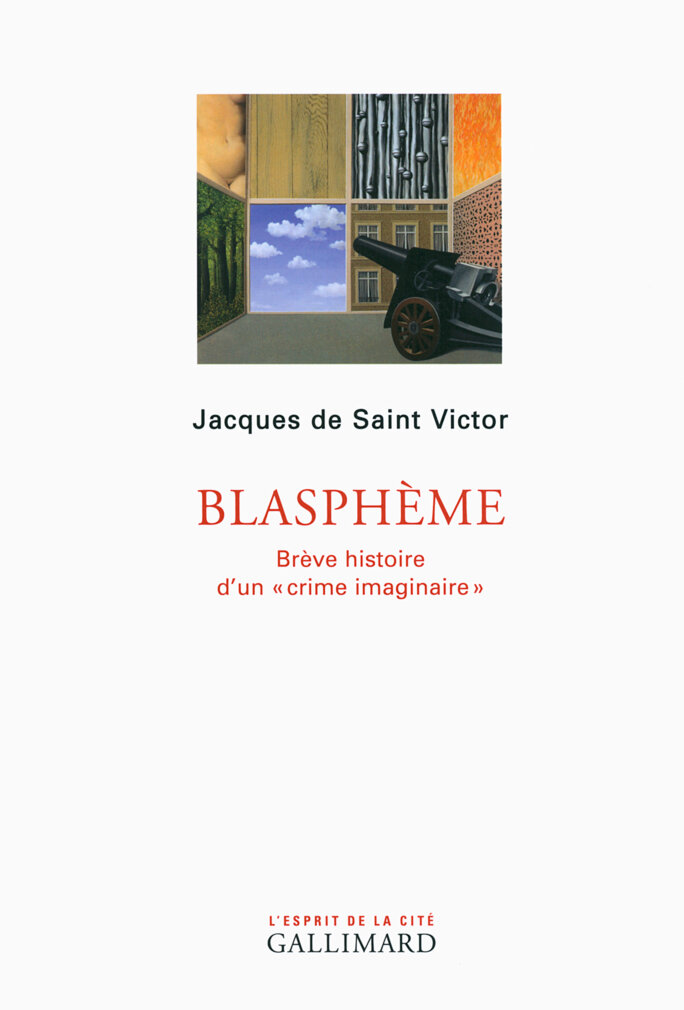
Agrandissement : Illustration 5
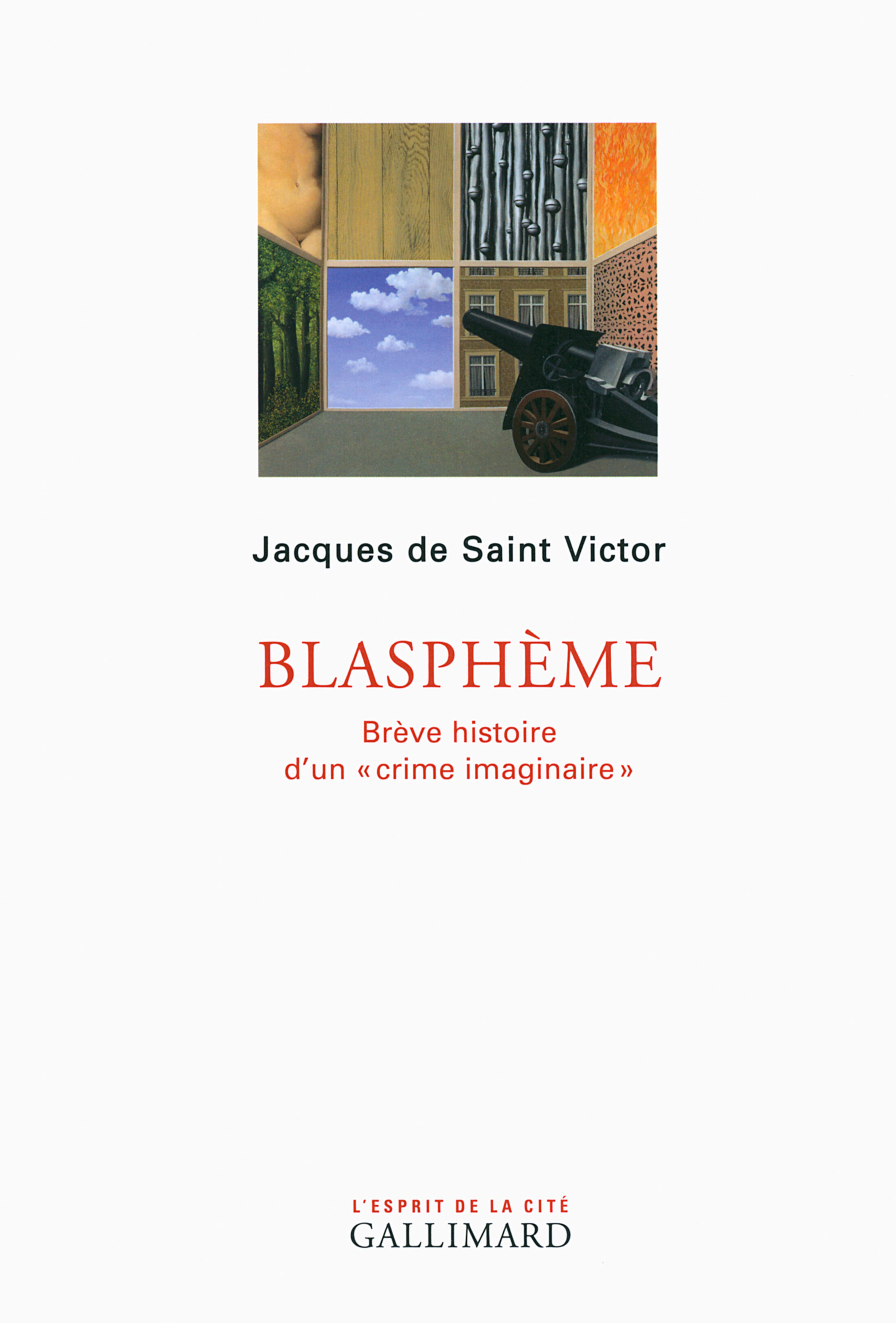
Le retour d’un « délit de blasphème » sous couvert de respect des croyants est bien traité. Nathalie Droin, juriste, décrit la valse-hésitation des tribunaux qui semblent s’être calé en tentant de poser un distinguo entre les attaques contre une personne ou un groupe de personnes à raison de leur religion, sanctionnées, et la libre critique des religions garantie par le principe de liberté d’expression, voire de création. Une interprétation libérale de, notamment, la loi Pleven de 1972 qui place sue le même plan la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en fonction d’une ethnie, d’une nation, d’une race ou d’une religion. Jacques de Saint Victor détaille ce processus sur la longue durée dans ses quatre contributions : sur la période des Lumières, la Révolution française et ses suites, l’ « outrage à la religion » de 1789 à 1972 et s’interroge sur la remise en cause de la liberté d’expression. Ces études renvoient à son indispensable ouvrage « Blasphème. Brève histoire d’un crime imaginaire » (Gallimard).
La Ligue de l'enseignement a organisé des Rencontres laïques sur la liberté d'expression. Elles ont rassemblé une centaine de personnes représentant 54 organisations du mouvement laïque le 5 juin 2019. Les vidéos sont en accès libre dans la présente édition "LAICITE".



