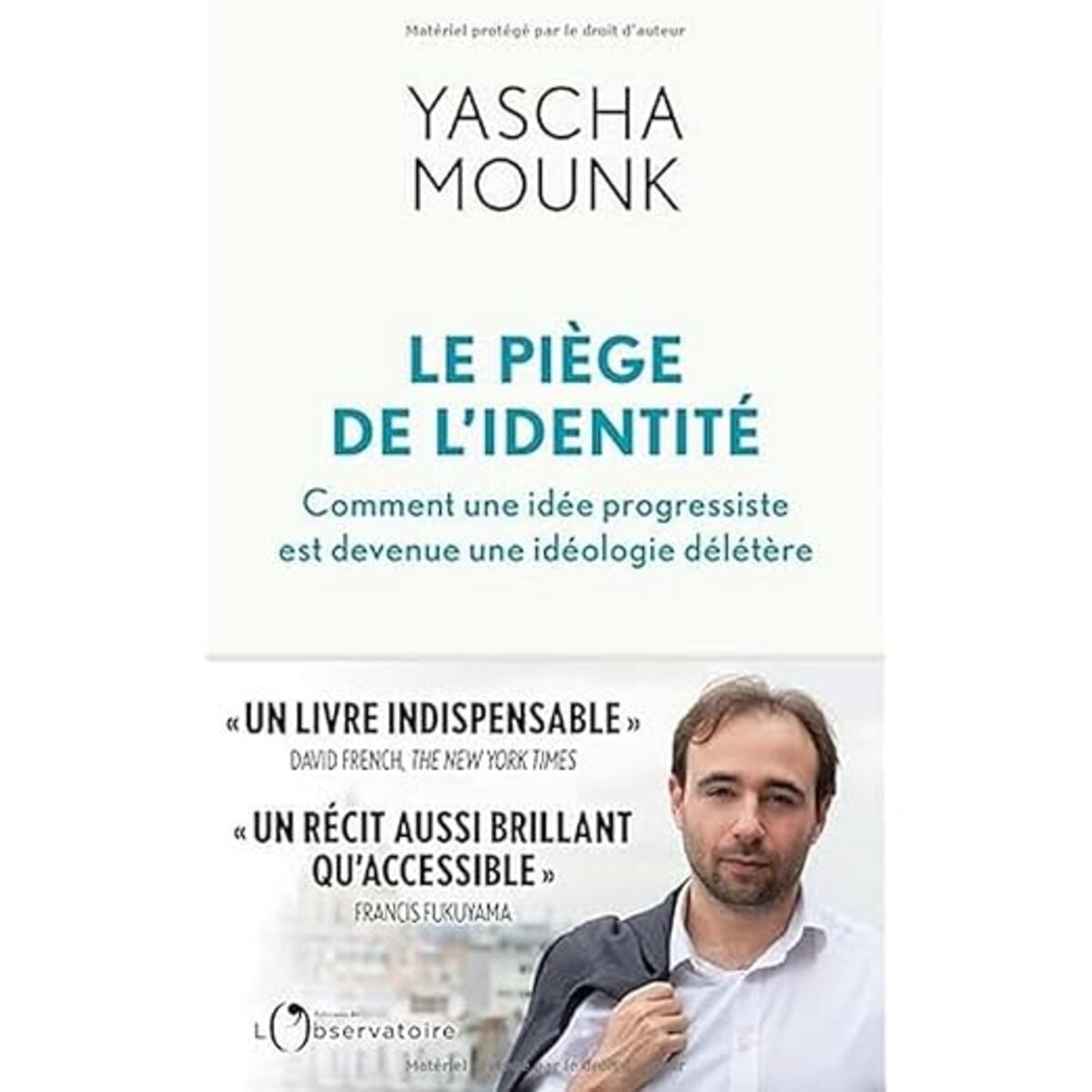
Le sous titre du dernier livre de Yasha Mounk « Le piège de l’identité. Comment une idée progressiste est devenue une idéologie délétère » publié par les Editions de l'Observatoire résume bien son propos. Par l’ampleur et la clarté de son propos, le nombre et le caractère parfois inédit de ses informations, ainsi que par la précision de ses thèses, cet ouvrage offre une opportunité pour tenter de créer un débat rationnel sur un sujet à la fois important et mal traité. Ecrivons le d’emblée : le point de vue adopté dans la présente recension se veut progressiste. Comment construire une société plus humaine, démocratique et pacifique, dans laquelle chacune et chacun a sa place ? Le discours appelant à devenir plus éveillé (woke) en matière de race et de sexe connaît un grand succès aux USA. Sa diffusion en France, souvent sous forme édulcorée, a suscité nombre de critiques. Mais elles sont énoncées la plupart du temps d’un point de vue conservateur (revendiqué ou non).
Wokisme ou synthèse identitaire ?
Yasha Mounk traite de ce qu’il nomme la synthèse identitaire. Il la définit ainsi : « Un corpus d’idées issu d’une large gamme de traditions intellectuelles et qui s’intéresse, au premier chef, au rôle que jouent dans le monde les catégories identitaires, telles que l’origine ethnique, le genre et l’orientation sexuelle ». Cela correspond à ce que les médias et le grand public désignent sous le nom de wokisme. Cette dénomination est de plus en plus contestée par ses tenants qui voient dans ce mouvement une nouvelle et radicale avancée des luttes en matière de race, de genre, de combinaison des deux élargie à toutes les causes minoritaires. Le terme synthèse identitaire est-il bien choisi ? D’une part, tout mouvement d’idée se voit attribuer un nom, choisi ou non par ses partisans. Quoiqu’ils en aient, le terme « wokisme » fait florès. Le relèveront-ils en mettant en œuvre un retournement du stigmate ? L’avenir nous le dira. D’autre part, la notion de « synthèse identitaire » est trop générale. Les personnes tout comme les groupes humains sont porteurs d’identités. La question est celle de la définition de ces identités : autodéfinitions, définition par les autres, conceptions essentialistes contre conceptions libérales…

Yasha Mounk s’est livré à un titanesque travail de documentation. Ses sources, accompagnées de commentaires, occupent 150 pages ! La quasi-totalité est en anglais. Mais le lecteur francophone pourra se plonger avec profit dans le corps du livre, 400 pages divisées en quinze chapitres. A la fin de chaque chapitre, le contenu est résumé en quelques points clés synthétiques. Ce que nous appelons ses thèses. Donnons-en quelques unes. Elles portent sur l’origine française de certaines idées, le rôle de Michel Foucault, l’impact remarquable de penseurs comme Edward Saïd, Gayatri Spivak, le moins connu Derrick Bell, l’abandon du combat antidiscriminatoire du mouvement pour les droits civiques au profit de réaffirmations identitaires génératrices de ségrégations « protectrices », la justification théorique d’un essentialisme stratégique, l’apparition du concept d’intersectionnalité dû à Kimberlé Crenshaw, la diffusion de ce discours sur les réseaux sociaux, sa reprise (et sa reformulation) par des Blancs CSP+ et donc par des médias dominants, tels que le New York Times, et des entreprises mondialisées comme Coca Cola, Netflix…, le succès des thèses de Ibram X. Kendi et Robin DiAngelo selon lesquelles les Blancs sont intrinsèquement tous racistes, la contestation de la liberté d’expression suivie de nombreuses sanctions notamment d’enseignants… Parmi les faits rapportés, les plus choquants pour des Européens sont les discriminations raciales faites (envers les personnes cataloguées comme blanches) lors des vaccinations contre le Covid et pour les aides aux agriculteurs les plus pauvres.
Comme sur tous les sujets à caractère sociologique, l’équation personnelle de l’auteur est à prendre en compte. D’origine allemande, Yasha Mounk évoque la judéité de sa famille en grande partie assassinée par les nazis. Ses quatre grands parents connurent la prison en raison de leurs convictions communistes dans les années 20 et 30. Il ne se sent pas reconnu comme un « vrai Allemand » et adopte la nationalité américaine. Pourtant, il est peu disert sur les positions portées par le mouvement qu’il étudie, allant de la légitime critique des politiques pro-israéliennes à l’expression brutale d’un antisémitisme avéré. Par ailleurs, universitaire d’envergure internationale, il semble peu sensible à l’absence des classes sociales dans les discours et les pratiques qu’il analyse. Comme le démontre Gérard Noiriel dans son œuvre, la meilleure façon de lutter contre les discriminations raciales c’est de lutter contre les injustices sociales. De plus, l’auteur est muet sur l’instrumentalisation du discours « woke » par les pouvoirs culturels et politiques américains, pourtant pointée de longue date par Pierre Bourdieu et Loïc Wacquant dans leur fameux article « Sur les ruses de la raison impérialiste ».
Un des problèmes que pose le livre de Mounk - mais pas seulement le sien - est que, depuis l’effondrement du communisme sous sa forme soviétique en 1989, le marxisme, la question sociale, la lutte des classes, déjà en perte de vitesse dans le monde intellectuel, ont cessé d’être le générateur d’identité collective qu’ils avaient été pendant un siècle. Il ne s’agit pas de « revenir à Marx », mais de concevoir des voies d’émancipation qui ne reposent pas sur des « identités à fragmentation », si l’on peut dire - comme il y a des bombes à fragmentation.
L’heure du choix
Yasha Mounk fait suivre sa série de thèses en forme de recension et d’analyse de faits par une série de thèses se voulant positives, constructives d’une société ouverte. En défense d’un universalisme repensé, il tente de répondre « en incorporant les intuitions les plus justes de la synthèse identitaire ». Il utilise la notion d’intégration, discutée en France, pour désigner l’effort collectif pour créer davantage d’interaction et de coopération entre les groupes humains. L’idée centrale est de répondre efficacement aux revendications des uns sans culpabiliser les autres. Il s’agit de prendre en compte les indéniables progrès humains déjà réalisés en continuant à appliquer concrètement les principes universalistes dans le cadre d’un débat permanent. Il constate que si « l’histoire de l’humanité est celle de la cruauté et de l’injustice… Certaines sociétés ont fait d’énormes progrès vers l’égalité de tous leurs citoyens. Ces sociétés ont adopté des institutions politiques inspirées des principes de base du libéralisme politique ». Une vieille chanson diront certains. Mais ce chemin long et ingrat, la voie vers l’égalité et la reconnaissance mutuelle, n’est-il pas le seul viable ? Le chemin suivi par certains progressistes américains comporte un grand danger, déjà palpable.
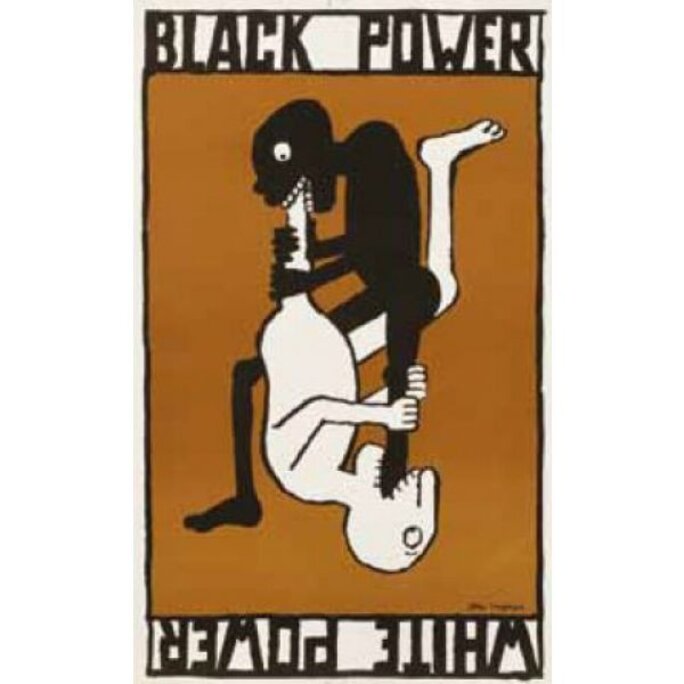
Agrandissement : Illustration 3
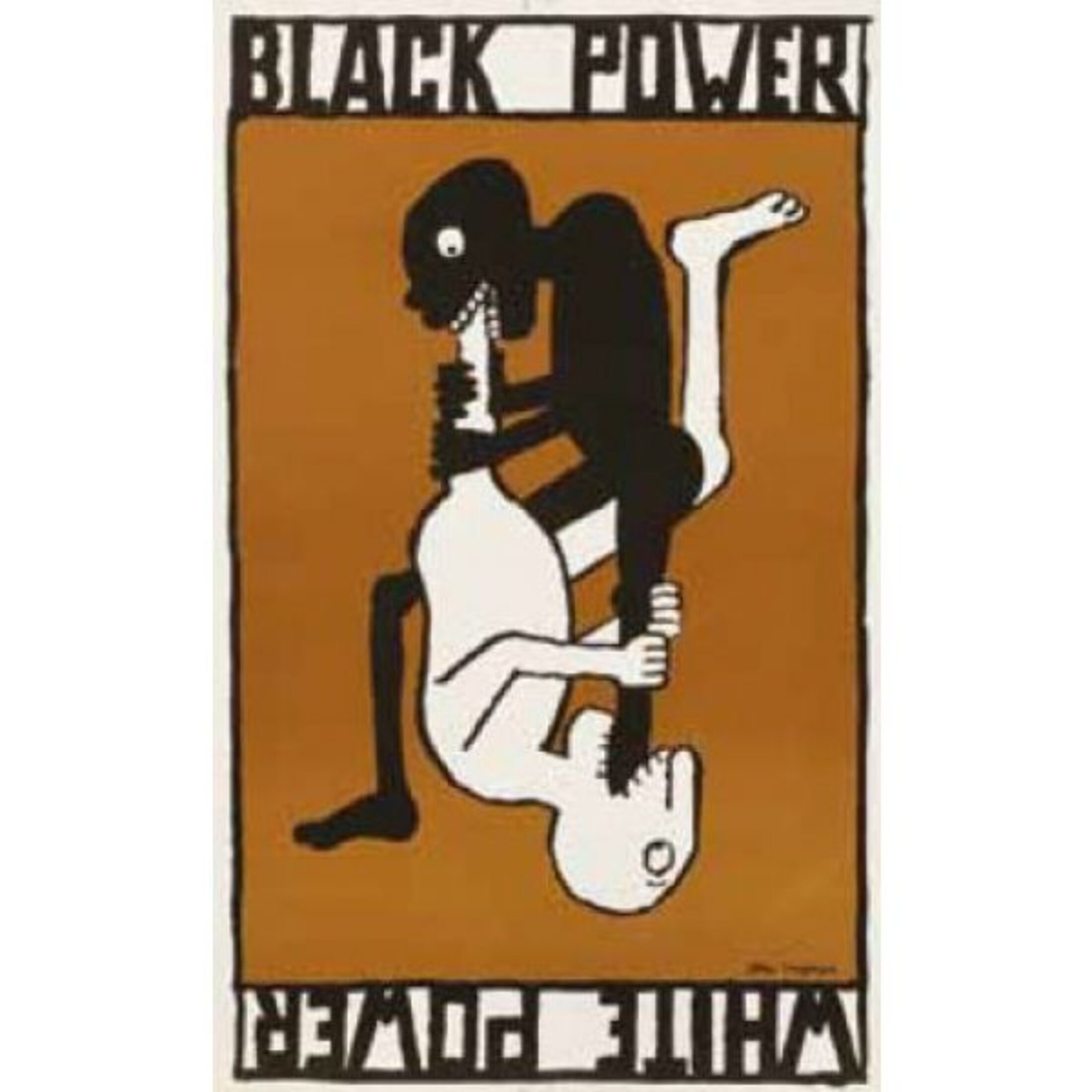
Une mise en garde est formulée par Yasha Mounk : encourager les Blancs à se définir en tant que tels risque de mal tourner. Il cite un militant des droits civiques célèbre aux USA, Bayard Rustin : « Je ne suis pas certain que l’autoflagellation puisse avoir un effet bénéfique pour le pécheur… Cela n’améliorera pas le sort des chômeurs et des mal-logés. D’un autre côté, il se pourrait bien que le parti coupable se mette finalement à rationaliser ses péchés pour en faire des vertus ». Une certaine droite radicale française n’a pas manqué de se féliciter que les wokes aient réussi là où elle a échoué : casser le logiciel républicain. Yasha Mounk souligne : « Un monde dans lequel les Blancs en viendraient à se définir avant tout par leur identité ethnique risquerait de faire advenir le pire avenir possible ».
Nous sommes à l’heure du choix.



