
Agrandissement : Illustration 1
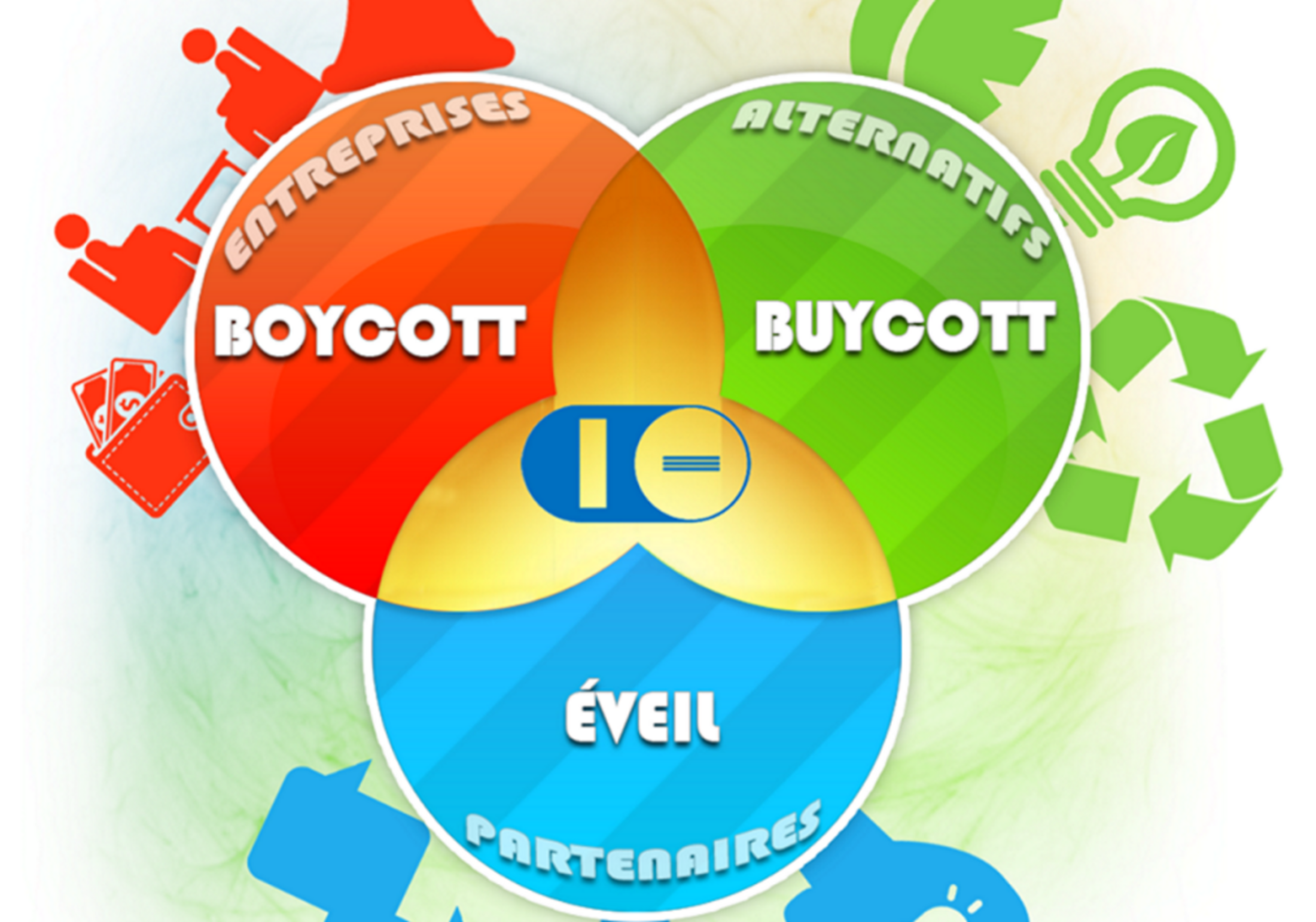
Les luttes nombreuses menées dans cette optique ont en effet souvent réussi à infléchir les politiques industrielles: sans prétendre à l'exhaustivité mentionnons Nestlé en 1977; Shell en 1995 et 2015; Nike en 1996; Danone en 2001; Nokia en 2008; Monsanto ainsi que Coca-Cola en 2014.Mais après le drame du Rana Plaza en 2014, force est de constater que la réaction des consom'acteurs comme on appelle les boycottants est des plus faibles au regard de l'étendue des souffrances des travailleurs du textile au Bangladesh: mis à part un timide appel contre la marque Primark non suivi d'effets, rien n'a changé dans l'attitude des clients à l’affût du plus bas prix dans les magasins de grande distribution. Une campagne antiboycott avait d'ailleurs été lancée au motif qu'une telle action détruirait les emplois des sous-traitants. Puis une gréve des ouvriers bangladais du textile l'année dernière a été ignorée par la presse mainstream qui ne souhaite pas porter atteinte aux intérêts des grandes marques du prêt à porter, actionnaires ou annonceurs de médias. Cinq marques ont cependant réagi en suivant l'appel au boycott d'une réunion du MEDEF local émise par les associations de commerce éthique (ici), ce qui plaiderait donc en faveur des plateformes de pétitions qui sont la version douce des actions contre les multinationales.
L'argument de la défense des emplois serait-il responsable du manque d'adhésion à ces campagnes ou serait-ce une indifférence face aux questions sociales ou environnementales ? Il faut reconnaître qu'il est difficile par exemple de boycotter tous les produits dérivés de Monsanto, Unilever ou Nestlé, certains étant difficilement remplaçables comme les soupes en sachet ou la moutarde de grande distribution: l'effort à consentir est important dans la vie moderne de course contre la montre. De même renoncer à remplir le réservoir au risque de tomber en panne sèche pousserait la consom'action à ses limites. Il n'en reste pas moins qu'une majorité de Français se déclarent prêts à boycotter comme dans le cas du plan de restructuration Lu qui a mis le propriétaire Danone dans le collimateur (70% selon l'IFOP) et cette pratique gagne de plus en plus d'adeptes des générations mondialisées Y et Z, aptes à affronter les multinationales. Greenpeace l'a bien compris qui utilise le boycott comme dernière arme (contre Shell par exemple).
Aussi les cadres redoutent-ils ces campagnes et s'efforcent-ils de ne pas prêter flanc aux critiques: bien qu'individualiste dans l'air du temps, l'action de boycott des cybercitoyens consom'acteurs responsabilise les entreprises conscientes qu'une dénonciation de lanceur d'alerte ou qu'un plan de redressement trop brutal peut les faire sombrer. En 2015 a été crée en France la plateforme participative https://www.i-boycott.org/ qui n´hésite pas à cibler entre autres Coca-Cola assoiffant les peuples. Que Trump se soit emparé de ce même moyen de pression contre Apple lors de sa campagne démagogique (ici en anglais) ne devrait cependant pas le disqualifier en raison du profil atypique de ce lanceur d'alerte en herbe: son appel aurait été effectué à partir de son I-phone.



