Plus qu’un roman, Les Arpenteurs du monde est un phénomène. Paru en 2005 en Allemagne, il devient rapidement un best-seller mondial, plus lu encore que Le Parfum de Süskind, traduit en France en 2007 (Actes Sud), aujourd’hui en format de poche (Babel). Les Arpenteurs du monde croise les biographies en partie fictionnelles de deux immenses esprits, Gauss, le Prince des Mathématiques, et le naturaliste Humboldt. Le roman commence en septembre 1828 : Gauss, réfractaire aux déplacements, accepte pourtant de se rendre à un congrès de naturalistes à Berlin, à l’invitation de Humboldt.


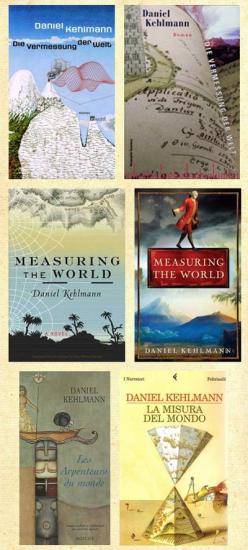
Daniel Kehlmann retrace la trajectoire de deux scientifiques qui ont consacré leur existence à la mesure de l’univers, à son entendement, à deux « arpenteurs du monde », il retrace les moments-clés de leur vie, leurs grandes découvertes, explicite leur rapport à la science, à l’avenir, à l’intelligence :
« C’était étrange et injuste, dit Gauss, et une illustration parfaite du caractère lamentablement aléatoire de l’existence, que d’être né à une période donnée et d’y être rattaché, qu’on le veuille ou non. Cela donnait à l’homme un avantage incongru sur le passé et faisait de lui la risée de l’avenir ».
Les Arpenteurs du monde se donne comme un roman de formation dans la grande tradition allemande dont Kehlman épouse d’ailleurs le style et la manière. Mais aussi comme un roman d’aventures quand les chapitres suivent le grand voyage de Humboldt et Bonpland en Amérique du Sud. Comme un roman philosophique également, dans la tradition des contes voltairiens, dans ce double portrait de deux hommes luttant contre l’obscurantisme de leur époque, les préjugés, les croyances non scientifiques, l’esclavage. Humboldt est un Candide de la science, un Ingénu de la connaissance, maniaque, précis, curieux, voyageur. Les Arpenteurs du monde est enfin un roman dont la science est le personnage central, incarné par deux êtres qui ont en commun la renommée, l’ambition et l’obsession de connaissances, le siècle où s’inscrivent leurs travaux, une correspondance, des échanges, des rencontres.
Mais Humboldt et Gauss ont deux manières totalement divergentes de vivre la science : Humboldt, noble et riche, aime les voyages, l’exhaustivité, les collections, les sciences naturelles. Il dévoue son existence à la connaissance, sans vie familiale ou même sexuelle, sublimant son rapport au corps ou aux sens, se forçant à un ascétisme purement intellectualisé. Gauss, lui, est né pauvre. Son génie des chiffres le sauve. Il étudie, publie, marque durablement l’histoire des mathématiques et de l’astronomie, aime les femmes et le sexe, déteste les voyages. Les Arpenteurs du monde, malgré le pluriel unifiant de son titre, décrit donc deux manières de prendre la mesure du monde, l’une sur le terrain, en pratique (Humboldt), l’autre sur le papier, en théorie. Gauss, lisant un compte-rendu du voyage d’Humboldt en Nouvelle-Andalousie, reconnaît que l’homme est « impressionnant » mais « absurde aussi » : « comme si la vérité se trouvait ailleurs et non pas ici ». Pourtant si les deux voies ne sont pas si éloignées, comme le comprend Humboldt à la fin de sa vie :
« Il fut soudain incapable de dire lequel des deux était allé très loin et lequel était toujours resté chez lui ».
Mathématiques, astrologie, sciences de la terre. Le programme a de quoi intimider les littéraires. Pour autant Les Arpenteurs du monde n’est pas un roman pesant, ni même sérieux. Certes, il est informé, puissant. Ses personnages sont attestés et renommés : Gauss, Humboldt, Goethe, Kant, Pilâtre de Rozier, Lichtenberg, Daguerre, Napoléon, Thomas Jefferson… la masse des connaissances scientifiques convoquées est imposante. Mais tout demeure drôle, piquant, spirituel. La science est une aventure, un roman, et Kehlman, qui s’en amuse dans de nombreux commentaires d’auteur, prouve que l’humour peut être allemand :
« Ce triste sire n’avait rien exploré du tout, répliqua Humboldt. Pas plus qu’un oiseau explorait l’air ou un poisson, l’eau.
Ou un Allemand, l’humour, dit Bonpland.
Humboldt le regarda en fronçant les sourcils.
C’est juste une plaisanterie, dit Bonpland.
Mais une plaisanterie injuste. Un Prussien pouvait bien rire aussi. On riait beaucoup en Prusse. Il suffisait de penser aux romans de Wieland ou aux excellentes comédies de Gryphius. Herder aussi savait bien placer un mot d’esprit.
Je n’en doute pas, dit Bonpland par lassitude ».
L’humour allemand : le witz, la cocasserie, l’ironie surtout, parfois désespérée, grotesque. Lorsque Gauss veut expliquer le résultat de ses derniers travaux à Kant, « l’homme qui, sur l’espace et le temps, en avait plus appris à l’humanité que quiconque », le philosophe, déjà sénile, sinon, gâteux, bavant en tout cas, lui répond « saucisse ». « Le domestique doit acheter de la saucisse, dit Kant. De la saucisse et des étoiles. Qu’il en achète aussi ».
Ces biographies croisées sont proprement « cocasses » – « L’Allemagne était quand même un endroit assez cocasse, répondit Gauss » –, elles s’offrent comme le portrait de scientifiques décalés, dans la lune, sacrifiant tout à la science, aveugles à tout ce qui fait le bonheur du commun des mortels : Gauss interrompt sa nuit de noces pour noter une formule astronomique en urgence. Humboldt compte les poux sur la tête des femmes au lieu de jouir de leurs formes, avale des poisons pour tester leur toxicité, passe de si nombreuses années loin de son pays natal qu’il finit par ne presque plus en parler la langue, « il parlait un allemand rouillé et hésitant, il cherchait ses mots sans arrêt ».
Le roman s’ouvre sur la rencontre à venir des deux scientifiques les plus brillants de leur temps puis opère une analepse pour revenir sur le cours de deux vies, leurs aventures scientifiques et tend vers cette rencontre à Berlin, narrée dans les derniers chapitres : qu’advient-il lorsque les orbites de deux esprits aussi forts se rencontrent enfin ? Une trajectoire que Kehlmann jubile de mettre en abyme en évoquant le théorème de Gauss selon lequel deux lignes parallèles finissent toujours par se croiser.
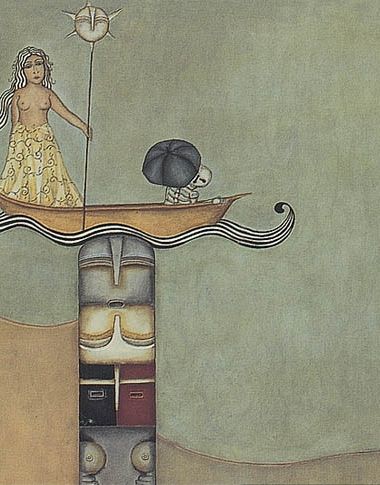
Le talent de Daniel Kehlmann est de faire de ces vies connues une aventure au sens romanesque comme scientifique du terme, de rendre passionnante et épique une réflexion sur la science, sa puissance comme ses dangers, ses progrès comme ses désillusions, de mener, comme dans nombre de ses romans, une réflexion sur la modernité.
Les Arpenteurs du monde est un roman jubilatoire. Italo Calvino avait comparé le Candide de Voltaire à un personnage de bande dessinée qui semble immortel malgré les péripéties les plus graves qui émaillent sa trajectoire, malgré les dangers, les accidents. Humboldt est dans cette lignée : congelé sur la Cordillère des Andes, presque noyé dans l’Amazone, vert après une descente dans un cratère, empoisonné pour avoir testé sur son propre corps les effets du curare, il poursuit ses aventures, de chutes en renaissances.
Gauss pourrait sembler plus sérieux mais lui aussi conçoit la science comme une avancée concrète dans le rêve, comme un recul de l’utopie, en une définition qui sera celle d’Apollinaire un siècle plus tard :
« Quand l’homme a voulu imiter la marche, il a créé la roue qui ne ressemble pas à une jambe. Il a fait du surréalisme sans le savoir » (Les Mamelles de Tirésias, 1917).
Le même Apollinaire a montré que l’Esprit Nouveau anime autant le scientifique que le poète : lorsque les « fables » des hommes se sont « réalisées et au-delà », « c’est au poète d’en imaginer des nouvelles que les inventeurs puissent à leur tour réaliser » (L’Esprit nouveau et les poètes, 1918). Humboldt et Gauss, tels que Kehlmann les décrit, sont des pierrots lunaires de cette espèce – « le neptunisme est enterré ! C’est bien dommage, à vrai dire, répliqua Bonpland. La théorie ne manquait pas de poésie » – et l’on conçoit la richesse de telles aventures scientifiques pour le roman.
Kehlmann apparie le sérieux sublime de la science à l’épopée comique de deux savants qui tous deux méprisent la poésie, s’ennuient au théâtre. « Les livres sans chiffres [les] inquiétaient ». Leurs deux vies ont pourtant été gouvernées par leurs rêves d’enfants, comme lorsqu’Alexander von Humboldt traverse l’équateur magnétique. Il « regarda les instruments avec recueillement. Enfant, il avait rêvé de cet endroit », adulte, il fera de cette « légende » une avancée scientifique. Mais pas un roman. Le récit du voyage pourtant « légendaire » d’Humboldt ennuie et déçoit le public :
« Des centaines de pages remplies de résultats de mesure, rien ou presque de personnel, pratiquement pas d’aventures. Circonstance qui allait nuire à sa gloire posthume. On ne devenait un voyageur célèbre que lorsqu’on léguait de bonnes histoires. Le pauvre homme ignorait tout bonnement comment on écrivait un livre ! »
Ce roman de la vie d’Humboldt, Kehlman l’a écrit, répondant ainsi à la question que posait l’explorateur au tout début de son voyage en Amérique du Sud : « Quel était l’intérêt de débiter continuellement des biographies inventées dont on ne pouvait même pas tirer de leçon ? ». Quel intérêt ? Dire le combat de la science, dresser le panorama, la saga même, d’un siècle, dans son combat pour la clarté et la connaissance, « le long chemin [qui] restait à parcourir pour accéder à la liberté et à la raison », vulgariser le savoir, le rendre quotidien.
Les Arpenteurs du monde est le récit de ces deux personnages dans leur corps à corps avec le réel, qu’ils veulent mesurer, chiffrer, tous deux en lutte contre l’ignorance de leur époque et les obstacles que le réel leur impose, jusque sous la forme d’insectes (les moustiques pour Humboldt, les guêpes pour Gauss).
L’excentricité, le surréalisme, l’Esprit nouveau servent la progression romanesque. Kehlmann est ici un « dériseur sensé », dans la lignée d’un Nodier, un romancier qui, comme souvent, s’amuse de sa manière et de ces « romans qui se perdaient en fabulations mensongères parce que leur auteur associait ses idées saugrenues sur l’art et le roman aux noms de personnages historiques ».
Saugrenu, ce roman l’est pour le moins, fulgurant, magistral aussi, sans ostentation. Un vrai bonheur de lecture. « Mesurer » la planète, comme le comprend Humboldt à la fin de sa vie, c’est aussi « l’inventer », « comme si elle n’était devenue réalité que grâce à lui ».
Daniel Kehlmann, Les Arpenteurs du monde [Die Vermessung der Welt], roman traduit de l’allemand par Juliette Aubert, Actes Sud, Babel, 299 p., 8 € 50
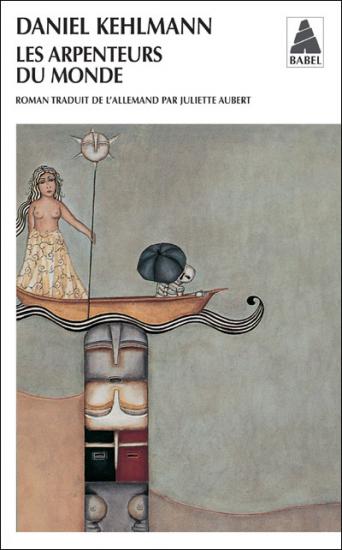
Actes Sud publie parallèlement le dernier roman de Daniel Kehlmann, Gloire. cf. critique dans le Bookclub
Iconographie :
Humboldt par Friedrich Georg Weitsch, 1806
Gauss par Christian Albrecht Jensen



