Le texte qui suit est issu de L'Educ Freinet, la revue du mouvement Freinet et signé par son Secteur Étude du milieu. Son prochain numéro s’intitule "Explorer notre environnement" (commandable en ligne) car en effet "Freinet le disait déjà au début du XXe siècle : pour enseigner la géographie, l'histoire ou les sciences, les livres ne suffisent pas. Rien ne vaut la classe-promenade pour se plonger dans la réalité et d'abord voir, entendre, sentir. Puis s'étonner, s'enthousiasmer, réfléchir... [...]".
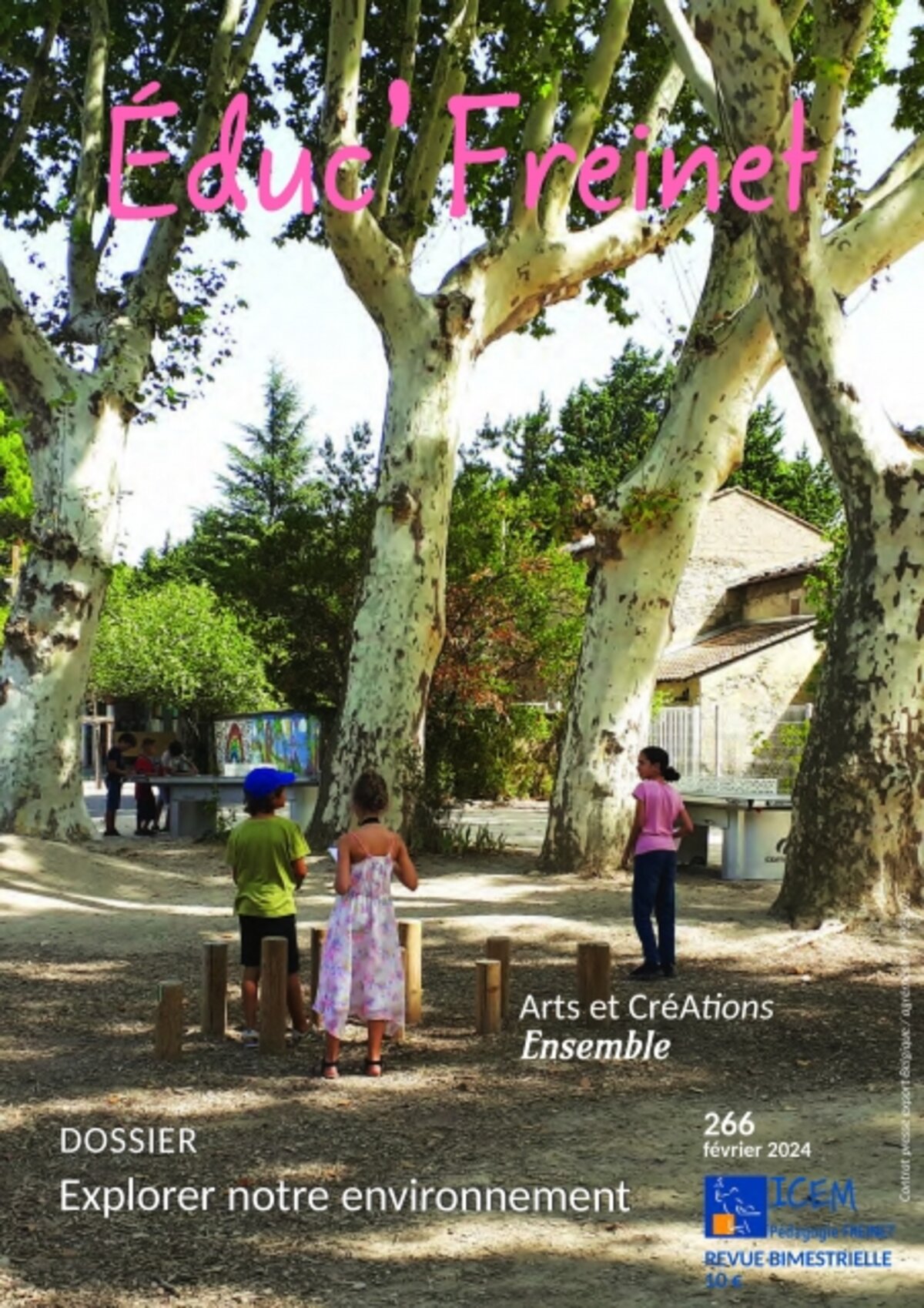
Agrandissement : Illustration 1
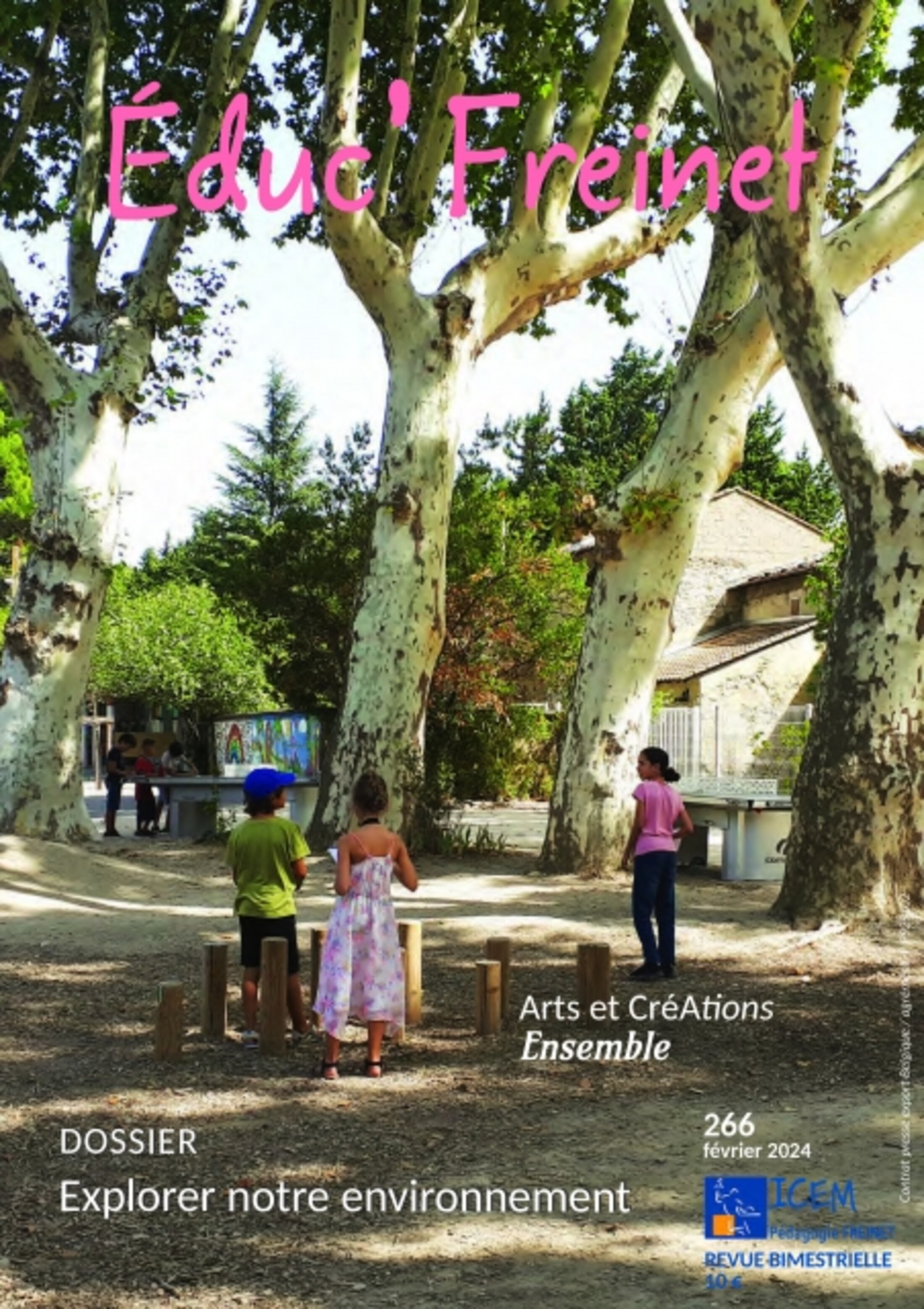
La nécessité d’explorer son milieu.
Explorer D’abord qu’est-ce qu’explorer ? L’idée d’exploration fait inévitablement penser aux explorateurs — plus rarement des exploratrices —, dont les archétypes seraient Indiana Jones, Paul-Emile Victor, ou encore Alexandra David Neel. Ils ou elles ont pour point commun d’avoir parcouru le monde de manière novatrice — et souvent au péril de leur vie. De ce point de vue, on s’imagine qu’il reste à découvrir peu de territoires ou de manières d’y accéder. Donc, explorer son milieu, ça pourrait sonner faux : jouer aux apprentis explorateurs dans son milieu habituel aurait ainsi un côté démagogique. De fait, on aura rarement l’occasion de rencontrer l’extraordinaire, le rare, l’inattendu. De faire de grandes découvertes. Et il faudrait se dépayser pour y parvenir vraiment. Il ne s’agit pas de cela, mais bien, au sein de son propre milieu, quel qu’il soit : — de l’observer — sans ajouter « différemment », sans doute un mot de trop. Juste l’observer, les espaces familiers — comme des parcs, des jardins — étant utilisés et traversés, souvent rapidement. — de le vivre avec les enfants de la classe (les copains, les copines) autrement, à la fois collectivement mais aussi individuellement : ce vécu commun n’est pas un vécu unique, chacun en aura eu une vision à la fois partielle et singulière.
L’exploration par la classe-promenade
Au départ, une technique Freinet fondatrice : la classe-promenade, renommée à une période, au sein du mouvement, « classe exploration » — en en poussant l’exploration le plus loin possible. Ce choix pour nous d’en rester de façon presque obsessionnelle à ce mode de sortie — alors que d’autres propositions fourmillent — n’est pas gratuit. Il met au travail, questionne encore et encore une intuition : que cette pratique-là, celle de la sortie « libre », « récurrente », permet d’ouvrir des possibles, des pensées de traverse. Il suppose que d’autres formes de sorties, avec des « objectifs définis », ou avec un cadre disciplinaire plus restreint créeraient des empêchements, en posant d’emblée des cloisons, en limitant de fait le champ des possibles.
En pédagogie Freinet, l’exploration n’a pas forcément d’aprioris. En promenade, la classe peut avoir un but de sortie, mais il n’y a pas de focalisation systématique sur la nature, sur le vivant, ou sur les phénomènes naturels. Les réalisations humaines (habitats, commerces, voies, réseaux), ou encore les humains (passants, travailleurs, voire les participants de la classe) font partie intégrante du milieu, et peuvent aussi être explorés. L’exploration ne s’inscrit dans les apprentissages que si elle est régulière. Sa fréquence est variable, mais c’est bien par la répétition que des habitudes de travail se prennent, que des concepts s’acquièrent peu à peu, que des postures s’installent, que la curiosité se développe, que le savoir en jeu se répète et donc qu’il s’inscrit dans les esprits, qu’il se mémorise. Que des changements se remarquent, que des questions sont formulées. L’exploration du milieu est un point d’étape dans la conquête des savoirs et de l’autonomie. L’exploration est nécessaire, fondamentale, mais n’est pas suffisante en soi. À tout le moins, elle peut être prolongée par d’autres dispositifs pour amorcer des prises de conscience, forger des concepts, acquérir de nouvelles connaissances. C’est bien une étape dans la chaine des procédures qui amène aux apprentissages. À l’exception de la première, chaque sortie est précédée des autres sorties, des observations faites, des concepts acquis, des questions qui se sont posées en matière d’organisation ou de savoirs. Elle sera prolongée par des restitutions graphiques (dessins, croquis, récits, fresques, itinéraires1), des discussions, des recherches, des questionnements, des confrontations des points de vue, et par la perspective de nouvelles explorations.
La quête existentielle de l’exploration
La question essentielle, existentielle, est induite par la catastrophe écologique : que cherche-t-on à faire, dans un tel contexte, en explorant son milieu ? Pas à le décrire comme une somme d’éléments inertes extérieurs à notre existence, simples objets de curiosité. La classe-promenade, espace-temps de l’exploration, met en jeu non seulement des objets, des composantes du monde, mais également une manière d’être au monde, d’entrer en interaction avec celui-ci, et d’agir en son sein. Cette liberté totale donnée au groupe et pas seulement à l’individu nous mobilise entièrement, par la sollicitation des différents sens, des représentations confrontées au réel, face à de nouveaux évènements. Qu’en feront les enfants ? Nul ne le sait, et c’est tant mieux !
Face à la double catastrophe en cours, écologique et anthropologique, la pédagogie Freinet dispose d’un outil puissant, la classe-promenade. Celle-ci a l’ambition de permettre d’appréhender le monde, de se connaitre soi et de pouvoir aller à la rencontre d’autres humains. Ses praticiens s’opposent à tout dogmatisme qui en figerait la technique. Enfin, l’urgence écologique est bien une préoccupation majeure pour le Secteur Étude du milieu, mais il s’oppose au discours bienpensant habituel à ce sujet.
La méthode du Secteur Étude du milieu :
Le fait de travailler lors de rencontres à partir de nos expériences (tout à la fois sensibles et réfléchies) partant du vécu de nos classes avec les enfants, nous semble un garde-fou contre l’énoncé de vérités si générales qu’elles en deviendraient creuses. Concrètement, un groupe à la composition en constante évolution — il intègre constamment de nouveaux membres — se retrouve régulièrement, pour explorer des milieux qui encadrent les lieux de rencontres, se livre à l’analyse de pratiques concrètes de classe nourrie par les expériences, les lectures, les questionnements de tous, toutes.
secteur.etude-du-milieu@icem-freinet.org
1Voir le schéma p. XXX



