Le pouvoir est une question de langue, de discours et de vocabulaire. Il se conquiert et s’exerce en diffusant et imposant subrepticement des sens implicites, des présupposés, des préjugés, qui sont cachés sous les usages de certains mots, dans les détours de certains discours. On les fait avaler comme un comprimé caché dans une mie de pain. Nommer quelque chose d’une certaine façon, avec un certain mot, c’est exprimer implicitement l’idée que l’on s’en fait. Nommer, c’est aussi présupposer l’existence de ce qu’on nomme et, si besoin, le faire exister. La nomination engage donc la responsabilité de celles et ceux qui nomment, qui emploient un nom, qui l’associent à certains autres mots. L’observation de ces usages permet de comprendre l’installation de ce nom et, avec lui, de ce qu’il présuppose et impose comme autant d’évidences partagées exclues de toute discussion.
Il ne s’agit pas de dire qu’il y a des textes neutres et d’autres qui ne le sont pas. Quand Camus dit « mal nommer les choses, c’est ajouter du malheur au monde », il a un point de vue à partir duquel il considère qu’une chose est mal nommée et sur ce qu’est le malheur en question. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de nommer dans l’absolu. Mais tous les discours sont tenus à partir d’un point de vue. Tous révèlent, explicitement ou implicitement, un parti pris, des orientations, des convictions. Tous contiennent, nécessairement, des implicites et des présupposés. Mais il y en a qui sont plus lourds de croyances, de fausses évidences, de contenus sous-entendus, de véritables pièges tendus consciemment, à la portée plus grave. Il y en a de plus malhonnêtes et de plus manipulateurs, parce que davantage abusifs, généralisants ou mensongers. Il y en a, en contre point, de plus explicites, de plus honnêtes, de plus réfléchis, de mieux fondés.
Comme l’a très bien écrit, récemment, O. Besancenot :
« On imagine mal à quel point les mots, verbes, expressions toutes faites, sont autant de messages subliminaux qui finissent par endoctriner notre vision des choses »[1].
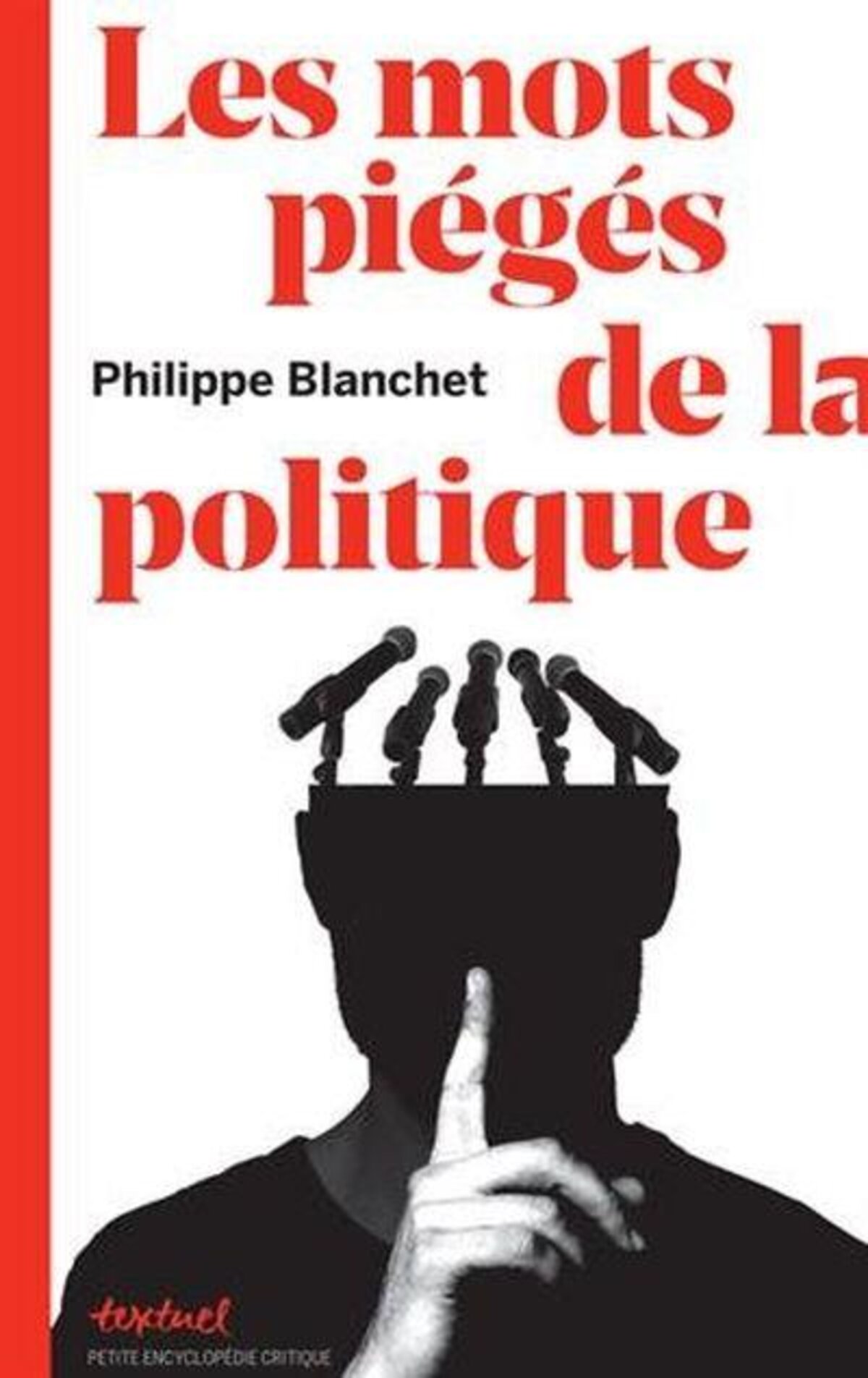
Agrandissement : Illustration 1
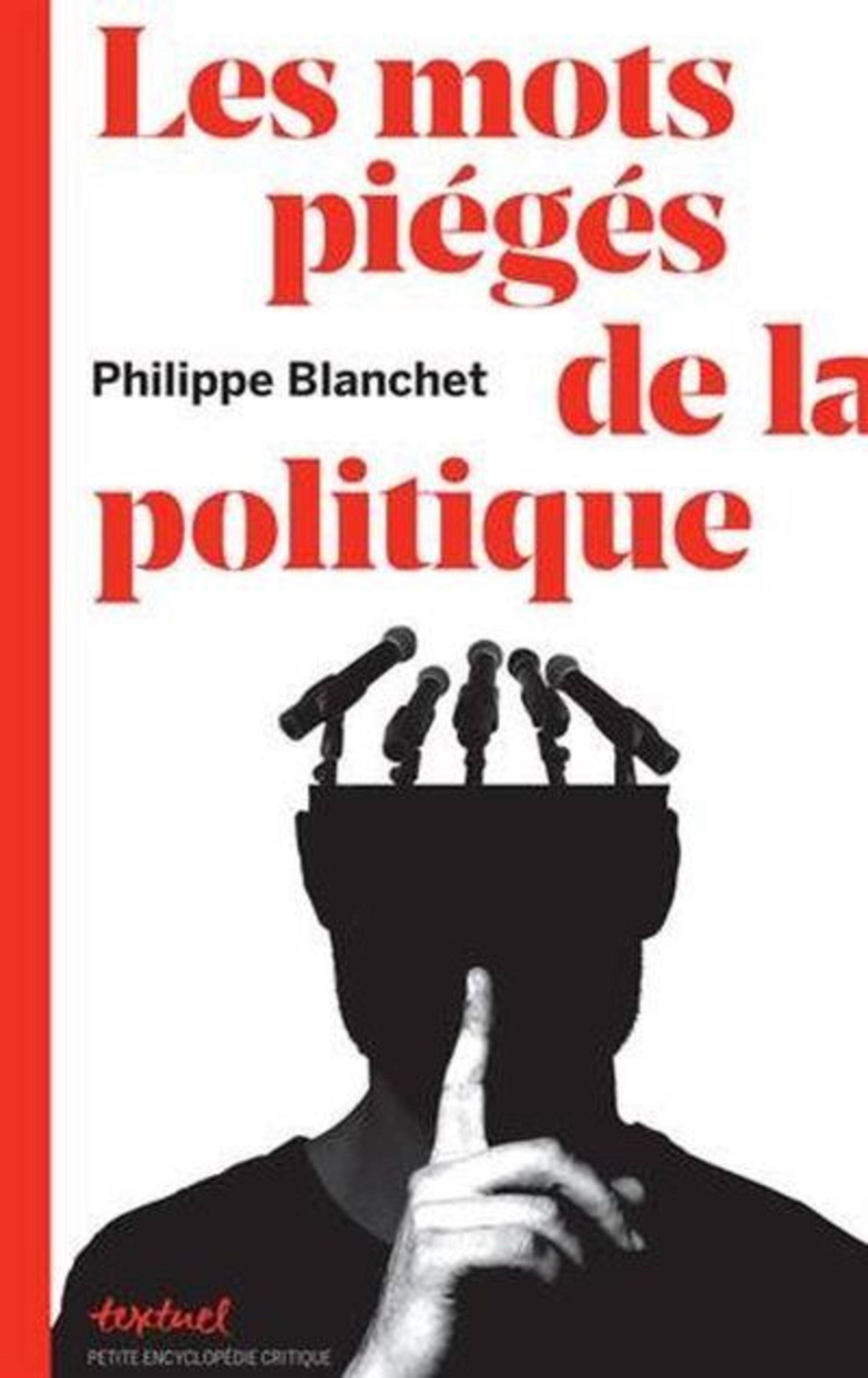
Ce livre a pour objectif de mettre à jour les contenus de propagande implicite de certaines de ces nominations mis en circulation. Il analyse cet « endoctrinement » par lequel une idéologie est discrètement imposée au plus grand nombre. Cette idéologie, c’est celle d’une certaine identité politique et nationale française, une certaine vision exclusive de ce que serait « la République ». L’analyse s’attache à quelques uns des mots ou expressions les plus fréquents, les plus saillants, parmi les plus significatifs de ce discours piégé, et qui font système : « Je suis Charlie, laïcité, radicalisation, communautarisme, incivilités... ». Et en bonus un détour par « équité ». Tout un programme...
L’étude de ces quelques mots clés qui occupent une place centrale dans les discours politiques et dans leurs reprises médiatiques permet de confirmer un glissement général de la société française, en tout cas d’une conception dominante de cette société, vers un modèle nationaliste, autoritaire, uniformisant et xénophobe. Ce glissement se manifeste ici par des changements dans les effets de sens produits par les usages de ces mots, autant pour celles et ceux qui les diffusent que pour celles et ceux qui les reçoivent. cette « langue de bois » va bien plus loin qu’une euphémisation du discours. Elle ne fait pas que « dire la même chose » avec des mots adoucis, polis, diplomatiques, voire hypocrites. Elle dit autre chose en plus, de façon implicite, et on peut s’en rendre compte en replaçant ces mots et ces discours en contextes. Dire par exemple d’une personne qu’elle est « issue de la diversité » parce que sa peau est foncée, c’est imposer sans la dire l’idée qu’il n’y a pas de diversité « à l’intérieur » du reste de la population, qu’on affiche comme homogène ; c’est pointer que les seuls qui ne sont pas comme les autres, c’est ceux qui viennent d’ailleurs et surtout de familles et de populations qui ont des noms arabes ou africains et un type physique « reconnaissable » comme étranger. Réutiliser cette formulation, c’est contribuer à diffuser cet implicite comme une évidence partagée et indiscutable : c’est là qu’est le piège.
Discuter une façon de nommer des choses est un acte radical en ce sens qu’il va à la racine des points de vue, au lieu d’accepter cette façon de nommer ces choses comme base et cadre de discussion imposés / partagés pour s’en tenir à un débat moins fondamental et, souvent, en quelque sorte, secondaire.
Déjouer les pièges sémantiques et idéologiques, c’est retrouver la liberté d’expression, la confiance en sa propre parole. Pour changer de société, il faut contester le cadre qui nous est imposé dans lequel on pense, on débat, on agit. Il faut contester les cadres et donc contester les mots.
Les Mots piégés de la politique, Paris, Textuel, 2017, 108 p.
http://www.editionstextuel.com/index.php?cat=020377&id=681
[1] Besancenot, O., Petit dictionnaire de la fausse monnaie politique, Paris, éditions du Cherche-Midi, 2016, p. 7.



