Au moment où nous écrivons ces lignes, le gouvernement expulse violemment les habitants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (NDDL) après avoir décidé d’abandonner le projet d’aéroport le 19 janvier dernier. Si renoncer au projet d’aéroport semblait constituer une victoire importante, il faut néanmoins rappeler que le mouvement se battait contre l’aéroport et « son monde ». Dès lors, on peut imaginer que l’abandon de ce dernier ne suffira pas à faire disparaître le monde qui va avec. Surtout, l’abandon de ce projet particulier ne doit pas devenir « l’arbre qui cache la forêt », car il existe en France et en Europe de nombreuses luttes contre des projets tout aussi inutiles et imposés. A commencer par la lutte contre le projet CIGEO à Bure où l’Etat a ordonné l’expulsion manu militari, du Bois Lejuc le 22 février dernier.
Un mouvement européen contre les grands projets inutiles et imposés
Depuis quelques années, on voit naître ou renaître dans plusieurs pays d’Europe un mouvement social de grande ampleur qui lutte contre les atteintes portées à la biodiversité, au climat et pour la justice socio-écologique, à partir de conflits localisés. Un mouvement dont la partie la plus visible a été la lutte contre l’aéroport à NDDL ou contre le barrage de Sivens, mais qui est en réalité irrigué par des centaines de mobilisations territorialisées, opposées à des projets de grandes surfaces, de routes et de golfs, de lignes de trains à grande vitesse, de carrières et de mines, de complexes touristiques, de méga-prisons pour humains et animaux, de décharges, etc. Un mouvement dans lequel s’engagent tout autant des militants aguerris que des citoyens ordinaires. Ces luttes multi-situées, décentralisées, s’élèvent contre « l’aménagement du territoire », souvent interprété sur le terrain comme un « déménagement des territoires ». Ce mouvement interroge notre modèle écologique et social, fondé sur la concurrence territoriale, la bétonisation des sols, la métropolisation des territoires et plus largement la poursuite de la croissance à tout prix.
Un mouvement ancré dans les territoires porteur d’un changement social
Habituellement affublés du qualificatif de NIMBY (Not in My Backyard-pas dans mon jardin) par les acteurs dominants, les mouvements d’opposition sont au contraire porteurs d’une force transformatrice. En effet, ces luttes territoriales induisent le développement de nouveaux liens sociaux, une acquisition et un échange de savoirs très divers (techniques, institutionnels, juridiques, etc.), de nouveaux attachements au lieu menacé, et finalement, des propositions politiques. La lutte contestataire devient alors un mode potentiel de politisation des problèmes publics en proposant des visions alternatives de l’intérêt général. Nous voyons apparaître en effet quatre lignes de fracture dans la définition de l’intérêt général entre le discours des militants et celui des porteurs de projets : croissance vs satiété ; mondialisation vs relocalisation ; compensation vs conservation ; technophilie vs techno-critique. Les différents modes de gouvernance mis en place, en visant la neutralisation des débats, ont eu l’effet inverse, à savoir attiser les conflits et creuser les lignes de fractures entre acteurs. Le territoire occupé ou le lieu symbolique de la lutte, à la fois espace de rencontre physique et de débat, est la source principale de la repolitisation ; il devient alors un véritable « espace public oppositionnel », au sens du philosophe et sociologue allemand Oskar Negt, soit un espace pour l’action du peuple, laissant éventuellement la place à la désobéissance civile.
Le territoire vecteur de repolitisation des enjeux écologiques
Ces luttes permettent de révéler un clivage fondateur sur la mesure des enjeux socio-écologiques et des réponses à apporter. En effet, elles font exister un contre-discours, une voix dissonante au sujet des valeurs (croissance, progrès technique, etc.) sur lesquelles reposent ces projets. Ces mouvements les identifient pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire le symbole de la destruction des territoires, de l’accaparement des ressources et de l’accentuation des clivages rural-urbain, riches-pauvres et centre-périphérie. Ils mettent également en exergue la violence et l’illégalité dont l’Etat et ses alliés font montre. Violence structurelle et symbolique avec l’imposition du projet, le verrouillage du dialogue lors des « espace de concertation » ; violence physique lors des manifestations, des expulsions ou des expropriations. Enfin, ancrés dans un territoire, les mouvements d’opposition possèdent un caractère global induit par les arguments et les imaginaires qu’ils convoquent. On assiste en parallèle à la naissance d’un « habiter politique » qui dans ce contexte permet de faire exister des choix de société alternatifs qui s’incarnent dans les territoires en lutte.
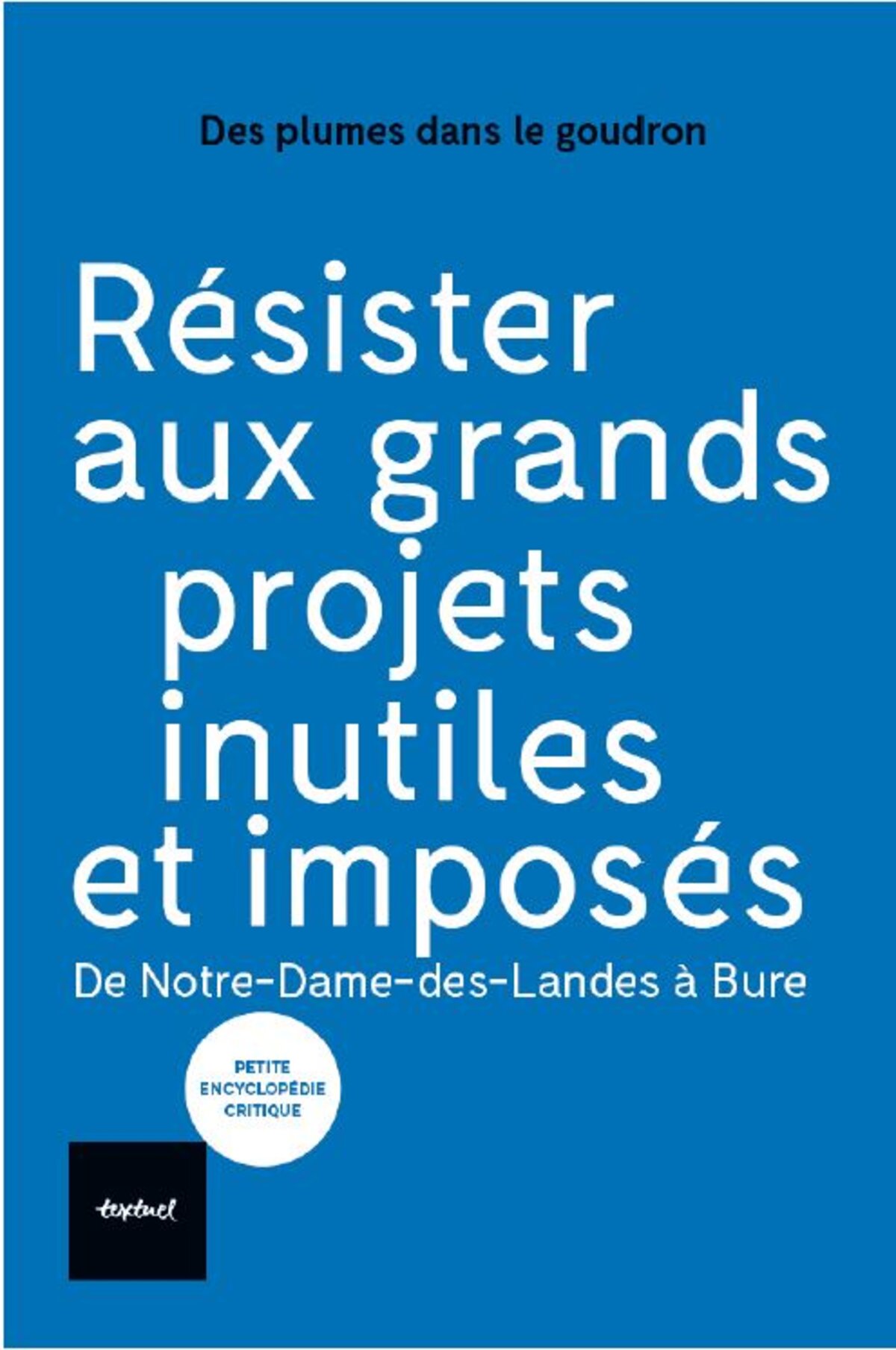
Agrandissement : Illustration 1
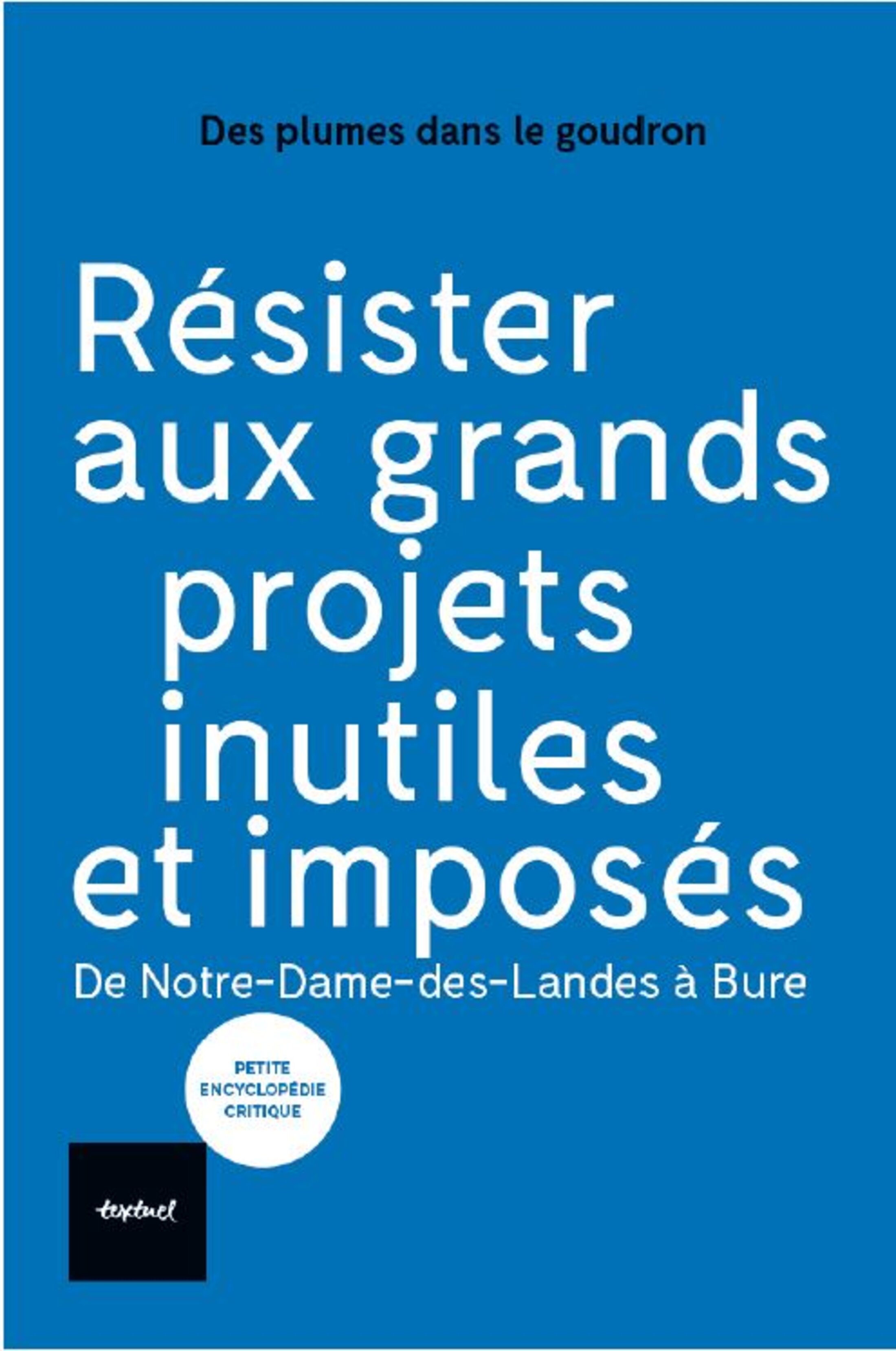
Le collectif Des plumes dans le goudron apporte un éclairage à la fois scientifique et militant sur le mouvement contre les GPII dans leur ouvrage « Résister aux grands projets inutiles et imposés : De Notre-Dames-des-Landes à Bure » qui sort le 19 avril en librairie. L’ouvrage ambitionne de donner des pistes pour comprendre ce mouvement, sa nature, ses revendications, et de montrer pourquoi il constitue, du fait de son ancrage dans les territoires, une source importante de (re)politisation des enjeux écologiques.
Résister aux grands projets inutiles et imposés : De Notre-Dames-des-Landes à Bure , par Anahita Grisoni, Julien Milanesi, Jérôme Pelenc et Léa Sébastien, Textuel, Petite encyclopédie critique, 155p. Sortie le 19 avril 2018.



