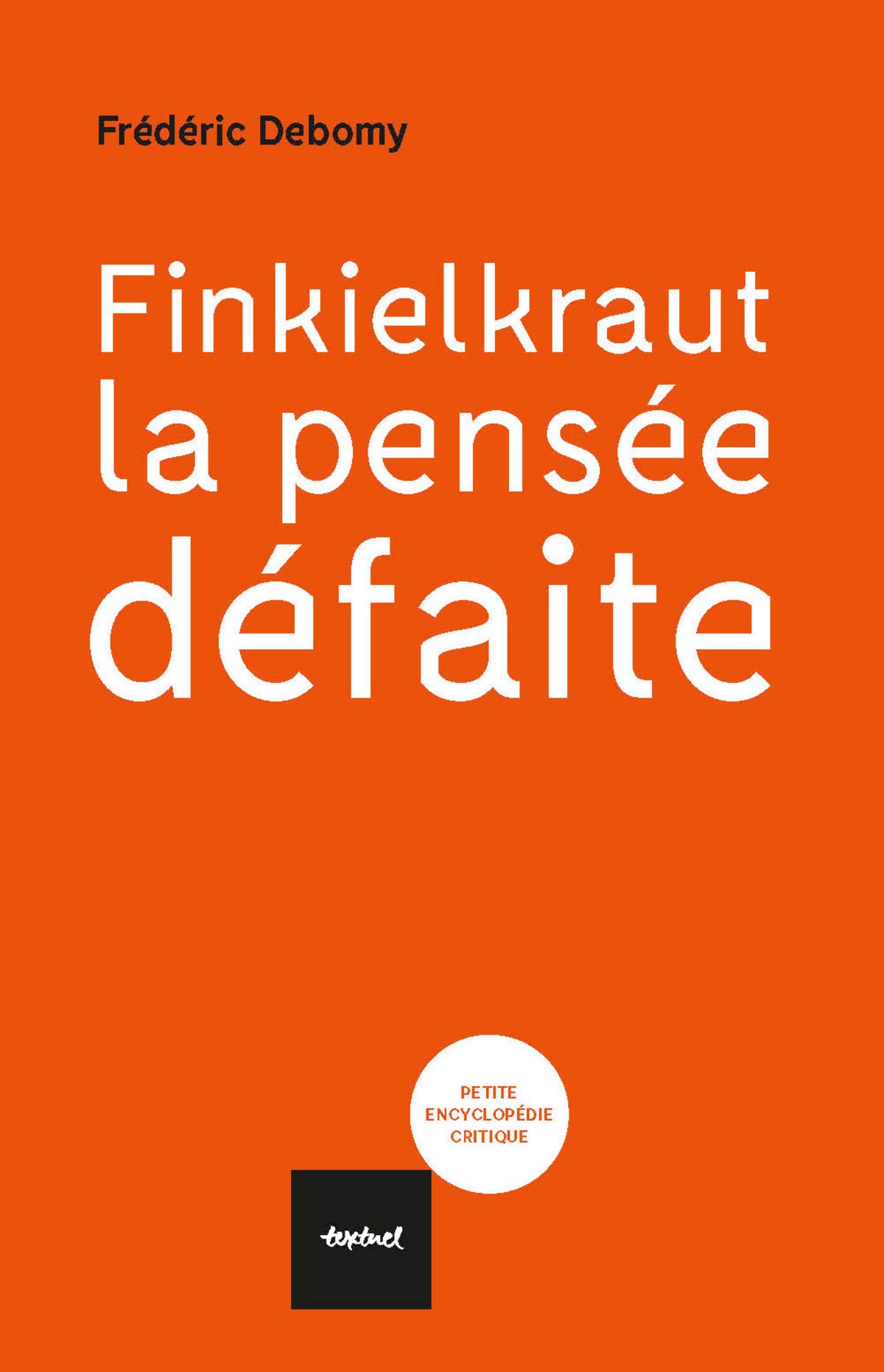
Agrandissement : Illustration 1

En guise de présentation de mon livre Finkielkraut, la pensée défaite, Paris, Textuel, "Petite encyclopédie critique", 2017
Finkielkraut homme de radio...
Le 24 juin 2017, Alain Finkiekraut invite l'écrivain Renaud Camus dans son émission de France Culture, Répliques, pour une édition consacrée au « grand déménagement du monde ». « Certains auditeurs doivent être stupéfaits, choqués et même indignés que, pour parler de la question migratoire, j'invite Renaud Camus », précise l'essayiste. Comme si l'on pouvait encore être étonné de voir l'auteur de La Défaite de la pensée et de L'Identité malheureuse ouvrir le micro de France Culture à un écrivain obsédé par la question migratoire définie comme une « invasion »[i].
L'Europe serait, selon Camus, « colonisée » et « occupée ». Mais peut-on utiliser de la sorte – demande Finkielkraut – ce terme d' « occupation », qui rappelle une expérience singulière mettant les occupés en prise avec des occupants en uniforme ? Pour Renaud Camus, nul doute que oui, car les nouveaux occupants ont leur propre uniforme : le voile. À ceux qui ne verraient pas très bien comment l'on peut comparer un uniforme de l'armée allemande au temps du nazisme avec une pièce de tissu permettant à certaines musulmanes de masquer leurs cheveux – à l'instar de nombre d'Occidentales il n'y a pas si longtemps – Camus oppose non pas des faits précis mais... ses simples convictions. Et pour les exprimer, il recourt encore à un vocabulaire évoquant la Seconde Guerre mondiale : il serait un « résistant » face à cette « occupation » bénéficiant d'une nouvelle « collaboration » – ceux qui collaborent étant des « remplacistes ».
Fort bien, mais encore ? Les « occupants » seraient – comme le lui fait dire Finkielkraut –les immigrés venus majoritairement « d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne »[ii]. Bref, « les Noirs et les Arabes », pour utiliser un vocabulaire courant. La preuve de cette occupation ? Le démographe Hervé Le Bras, autre invité de Finkielkraut, cite Camus : « Dans le métro à six heures du soir, je suis le seul Blanc au Châtelet. » Avant de le commenter, rappelant qu'au Châtelet à six heures du soir, « il y a beaucoup de Blancs. C'est donc n'importe quoi. » Mais il en faut plus pour faire douter le théoricien du « grand remplacement » : « Vous dites que je dis n'importe quoi parce qu'il n'est pas exact qu'il y ait seulement un Français à six heures du soir au Châtelet. […] Peut-être qu'il y en a trente, peut-être qu'il y en a cinquante : je crois que c'est très inférieur à la moitié. » On comprend au passage que pour Renaud Camus être « Blanc » et être « Français » c'est une seule et même chose puisqu'il est question, dans le premier cas, de l'absence supposée de Blancs à la station du Châtelet à six heures du soir et dans le second cas de l'absence supposée non plus de Blancs mais de Français. On ne s'étonnera donc pas que Renaud Camus ne soit nullement troublé par le rectificatif apporté par Le Bras à ses inexactitudes : lorsque Camus affirme qu'en France, en une génération, un peuple en a remplacé un autre, les vieillards étant « Français de souche » mais les nourrissons « arabes et noirs et volontiers musulmans », Le Bras lui répond – à l'appui de la statistique – que le phénomène réel auquel nous assistons est « la mixité des unions donc la mixité des origines. » En bref, précise encore Le Bras, « le grand remplacement qui est en train de se produire », ce n'est pas du tout, comme Camus le dit, celui « d'un peuple par d'autres peuples, c'est le grand remplacement d'une population relativement sédentaire […] par une population d'origine mixte. » Mais quelle différence cela fait-il pour un écrivain parlant indifféremment des Français et des Blancs ? N'étant pas suffisamment Blancs, les nouveau-nés ne sauraient être suffisamment Français : la mixité, dans cette perspective, c'est déjà le changement de peuple. Qu'on me détrompe, mais comment ne pas y voir le présupposé que ce qui fait un peuple, c'est sa race (ce qui signifie adhérer encore à ces fadaises de races biologiques, dont l'hôte de Renaud Camus – Finkielkraut – a pourtant écrit qu'elles ne méritaient « aucune indulgence »[iii]) ?
On pourrait poursuivre sur cette émission « édifiante » qui vit Camus préciser qu'il refusait « le changement de peuple » sans être capable de donner sa définition du peuple (« C'est quelque chose qui ne se définit pas » ou bien c'est « un profond murmure ») ou revendiquer d'appréhender le réel avec son « œil » plutôt qu'au travers d'une démarche scientifique au prétexte qu'il y a « incapacité du chiffre à rendre compte du monde » – ce à quoi Hervé Le Bras lui répondit « c'est pas en vous promenant dans la rue que vous pouvez avoir l'idée de ce qui se passe dans 550 000 kilomètres carrés et pour 65 millions d'habitants, vous n’avez aucun moyen de le savoir, tous les biais sont là, c'est l'histoire de l'homme qui arrive en Angleterre, qui voit une Anglaise rousse et qui dit à sa femme au téléphone ʺtoutes les Anglaises sont roussesʺ. »
Camus est, à l'évidence, un convaincu. Il croit – comme d'autres avant lui – vibrer à l'unisson de son « peuple », un peuple en souffrance depuis que les « remplacistes » sont à l'œuvre. Car ceux-ci « ont demandé [aux migrants] de s'embarquer », c'est « organisé » : « il n'y a pas de migrants secourus, il y a des envahisseurs réceptionnés par des traîtres. » À la clownerie intellectuelle s'ajoute le tempérament conspirationniste.
Mais l'auteur du Grand remplacement est, comme le précise Finkielkraut, un personnage que l'on a tendance à laisser dans son coin.[iv] Or tel n'est pas le cas de celui qui, en l'invitant, a contribué une fois de plus brillamment à l'élévation du débat public. Finkielkraut, s'il pose volontiers en martyr du politiquement correct, est en effet partout. Et il partage avec Renaud Camus non seulement des convictions – Camus est l'un des penseurs qu'il lit avec le plus d'attention – mais aussi une absolue légèreté quant à sa façon d'appréhender le réel.
… et Finkielkraut écrivain
Finkielkraut revendique pourtant dans La Seule exactitude[v] [sic] de marcher dans les pas d'un Charles Péguy attentif à subordonner sa pensée « au visage que présentent les choses et les événements. »[vi] Mais il ne le fait nullement. Écartant, parmi les travaux qui rendent compte du réel, ceux dont les conclusions ne lui plaisent pas – au prétexte, si facile, qu'ils exprimeraient le « politiquement correct » – il n'hésite en revanche nullement à aller chercher les « preuves » de ce qu'il avance dans des faits divers érigés en faits de société. En somme, il ne retient du réel que ce qui confirme ses présupposés : c'est l'histoire, racontée par Hervé Le Bras, « de l'homme qui arrive en Angleterre, qui voit une Anglaise rousse et qui dit à sa femme au téléphone ʺtoutes les Anglaises sont roussesʺ. » S'emparer d'un épisode de l'histoire des idées pour en proposer une version « arrangée » ou tordre la pensée d'un adversaire intellectuel à dessein ne le gêne pas davantage. Il y a donc une « méthode Finkielkraut », dont une autre caractéristique est le fait de dire une chose et son contraire afin de se soustraire à la critique (ainsi l'on pourra toujours, si l'on est critiqué sur un point polémique, prétendre avoir été mal compris : « Voyez ce que j'écris en page tant »). Pour s'y retrouver entre deux propos contraires, c'est du reste assez simple : ce qui relève de la précaution rhétorique n'a aucune incidence sur le reste du raisonnement.
C'est armé de telles méthodes – comme du recours au préjugé anti-intellectuel s'il le faut[vii] – que Finkielkraut nous entretient, comme Renaud Camus mais en usant d'un vocabulaire différent, des périls auxquels nous confronterait la présence de « nouveaux arrivants »[viii] venus « d'Afrique ou du monde arabo-musulman ». L'identité française serait, à l'en croire, en danger. Or, à l'instar d'un Camus incapable de préciser ce qu'il entend par « peuple », Finkielkraut peine à définir cette identité menacée : il existerait « quelque chose comme la civilisation française »[ix] et ce « quelque chose » nous distinguerait – pour le mieux – des « nouveaux arrivants. » « Nous » serions un nous, avec ses particularismes tendant à l'universel – ceux des autres favorisant toujours leur repli sur eux-mêmes.
Mais il ne s'agit pas seulement d'œuvrer à réaffirmer la suprématie de l'Occident (et particulièrement de l'Europe, et encore plus particulièrement de la France). Il faut encore expliquer que ceux qui sont rejetés sont en fait ceux qui rejettent. Avec Finkielkraut la philosophie de la décolonisation se résume ainsi à Frantz Fanon[x], Fanon à un seul de ses livres, ce livre à quelques phrases sorties de leur contexte... et voilà l'auteur des Damnés de la terre, penseur du refus de l'assignation identitaire, définitivement barrésien ! Tandis que ne saurait l'être, sans doute, un Renaud Camus expliquant, lui, que l'homme, « n'est pas une matière humaine interchangeable » et « est quelque chose qui appartient à un espace, à un ciel, à une culture, à une langue. »[xi]
Tel est Finkielkraut, qui peut voir la réaction à l'œuvre là où elle ne se trouve pas mais aussi ne pas la voir là où elle se trouve… Les décolonisés et leurs descendants ne retiennent son attention que pour être décriés tandis que les progressistes, forcément manichéens – contrairement à lui, bien sûr – seraient tout aussi haineux que ces derniers. Il nous explique ainsi que « l'avenir de la haine [des juifs] » est dans le camp de ceux qui manifestèrent en 2002 contre le Front national, et non « dans celui des fidèles de Vichy »[xii] – tandis que les travaux de la Commission nationale consultative des droits de l'homme indiquent eux que « quel que soit son diplôme, les chances qu'une personne soit antisémite augmentent d'autant plus qu'elle se situe à droite. »[xiii]
De Finkielkraut, il est beaucoup à dire et l'on est souvent saisi devant l'absurdité de certaines de ses assertions (j'en donne ici un exemple, issu de Comment peut-on être croate ? : « Vive le rap ! À bas la Slovénie ! Les deux choses vont de pair »[xiv]). Dans mon livre, je m'emploie, de manière moins hâtive que dans le présent texte, à donner un aperçu du manque de sérieux intellectuel du personnage. Car enfin, ce que dit l'essayiste se résume bien souvent, sous l'habit de la citation et de la référence historique, à une bien pauvre pensée, une pensée de comptoir : on n'est plus chez nous, c'était mieux avant, ces gens-là ne sont pas comme nous. Une guerre contre l'intelligence qui se revêt des atours de l'intelligence. Finkielkraut, pourtant, aurait pu utiliser ses capacités à meilleur escient : on peut trouver de l'intérêt, par exemple, à la lecture du Juif imaginaire. Sa production intellectuelle est hélas trop dominée par ses affects – et cela ne va qu'en s'aggravant – pour que l'on puisse encore la prendre au sérieux. Le souci affiché de l'exactitude et de la nuance n'est pas suivi des faits : l'arbitraire prime.[xv] Le débat public – et c'est le pourquoi de la rédaction de mon ouvrage – mérite définitivement mieux que cette permanente défaite de la pensée.
Frédéric Debomy
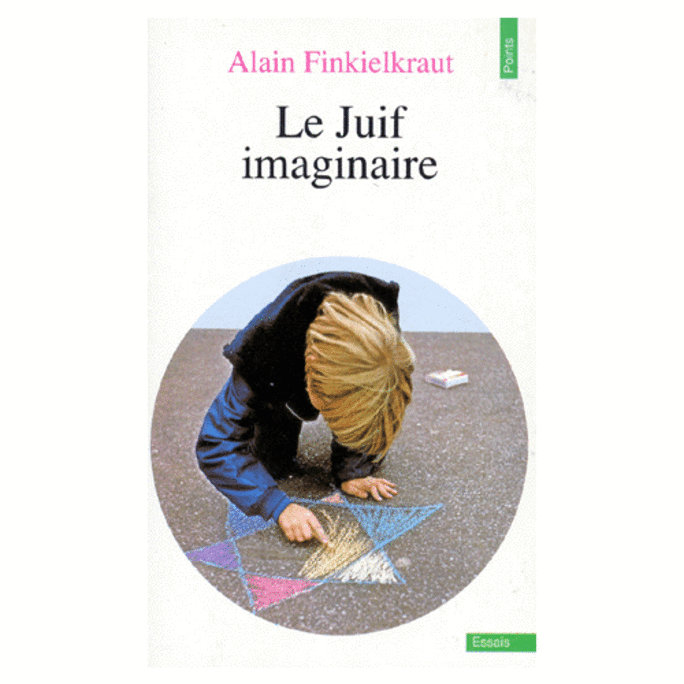
[i]
Selon les propos de Renaud Camus sur l'antenne de France Culture. Camus précise que l'on peut parler indifféremment de « grand remplacement », de « submersion migratoire », de « substitution ethnique », d' « invasion » ou de « changement de peuple et de civilisation » - le phénomène ainsi désigné étant considéré par lui « comme étant, de très loin, le plus important de notre époque ».
[ii]
C'est ici Finkielkraut qui résume les propos de Renaud Camus.
[iii] L'Identité malheureuse, Stock, Paris, 2013, p. 189.
[iv] Et tant mieux. Parmi les moments édifiants de cette émission, on retiendra encore le moment où Renaud Camus, parce qu'Hervé Le Bras évoque le bon Français de nombre des étrangers qui s'installent aujourd'hui en France, glousse.
[v] La Seule exactitude, Stock, Paris, 2015.
[vi] Le Mécontemporain. Péguy, lecteur du monde moderne, rééd. Paris, Gallimard, « Folio », 2007, p. 87-88 (première édition : Gallimard, 1991).
[vii] Il faudrait, pour juger des effets de l'immigration « d'Afrique ou du monde arabo-musulman », non pas se fier à la « science » des « historiens et […] protohistoriens » mais à « nos sens » (L'Identité malheureuse, p. 110). On retrouve là le primat donné par Renaud Camus à l'observation personnelle directe. Si les travaux scientifiques mènent à des conclusions qui ne nous plaisent pas, on leur opposera donc un « oui mais moi je trouve que » et un « moi je dis que ». La connaissance, pour sûr, fait des bonds.
[viii] Finkielkrault dans Anne Christine Fournier, Regards sur notre temps, Mame, Paris, 2013, p. 72.
[ix] Ibid. , p. 74.
[x] Fanon est l'une des cibles favorites de Finkielkraut, qui dans l'émission de radio que nous avons évoquée résume ainsi Les Damnés de la terre : « une apologie de la violence ». Emballé, c'est pesé !
[xi] Fanon a contrario écrivait dans Peau noire, masques blancs : « Il ne faut pas essayer de fixer l'homme, puisque son destin est d'être lâché. » Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, rééd. Paris, Seuil, « Points », 1975, p. 187 (première édition : Seuil, 1952).
[xii] Dans Au nom de l'Autre. Réflexions sur l'antisémitisme qui vient, Gallimard, Paris, 2003, p. 20.
[xiii] Voir le rapport de la CNCDH de 2015.
[xiv] Comment peut-on être croate ?, Gallimard, Paris, 1992, p. 103.
[xv] La Seule exactitude, de façon ironique, en offre une bonne illustration, par exemple lorsque Finkielkraut affirme, p. 144, que ceux qui interrogent la politique de la France au Rwanda sont hantés par le « rôle de Vichy dans la solution finale ». Étant du nombre – j'ai contribué à un colloque de l'École des hautes études en sciences sociales et à un numéro des Temps Modernes consacrés au génocide et interrogeant la responsabilité de la France dans cet événement – je ne peux que m'interroger : où Finkielkraut a-t-il été chercher ça ? À l'évidence, dans ses fantasmes.



