
*************************************************
En introduction apéritive à cette sélection de courts textes de Marx commentés : quelques extraits du livre [les textes de Marx sont en italiques, à la différence des commentaires de Philippe Corcuff]…
* Actualité d’un Marx hérétique dans la tourmente capitaliste [extrait de l’introduction générale]
Cette sélection n’a aucune visée d’exhaustivité, c’est avant tout une invitation à lire directement des textes de Marx. Une incitation à des explorations partielles dans la boîte à outils marxienne, à partir des questions de notre présent. La quête d’une actualité de Marx pour le XXIe siècle qui ne soit ni une apologie « marxiste », ni un dénigrement « anti-marxiste ». Une lecture de Marx orientée par une sympathie critique, valorisant les instruments les plus solides, repérant les tensions et les contradictions éclairantes, faisant son miel des écueils, des problèmes mal résolus, des arrogances ridicules et des limites inéluctables. Bref réfléchir à partir de Marx, avec Marx, à côté de Marx, au-delà de Marx et contre Marx !
Ce choix de textes et leurs commentaires ne sont pas « neutres », ils sont nourris de coordonnées intellectuelles et politiques particulières. Je suis sociologue, marqué notamment par l’œuvre « post-marxiste » de Pierre Bourdieu (1930-2002), et enseignant-chercheur en philosophie politique. Je suis, par ailleurs, militant anticapitaliste, altermondialiste et libertaire. Je me suis défini comme « marxiste » dans ma jeunesse lycéenne et étudiante, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, mais depuis longtemps maintenant j’ai suivi le judicieux et prémonitoire conseil de relocalisation des ressources marxiennes et « marxistes » formulé en 1960 par le philosophe Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) :
« Nous disons qu’avec les événements des dernières années le marxisme est décidément entré dans une nouvelle phase de son histoire, où il peut inspirer, orienter des analyses, garder une sérieuse valeur heuristique, mais où il n’est certainement plus vrai dans le sens où il se croyait vrai, et que l’expérience récente, l’installant dans un ordre de la vérité seconde, donne aux marxistes une assiette et presque une méthode nouvelles qui rendent vaines les mises en demeure. » [préface de Signes, 1960]
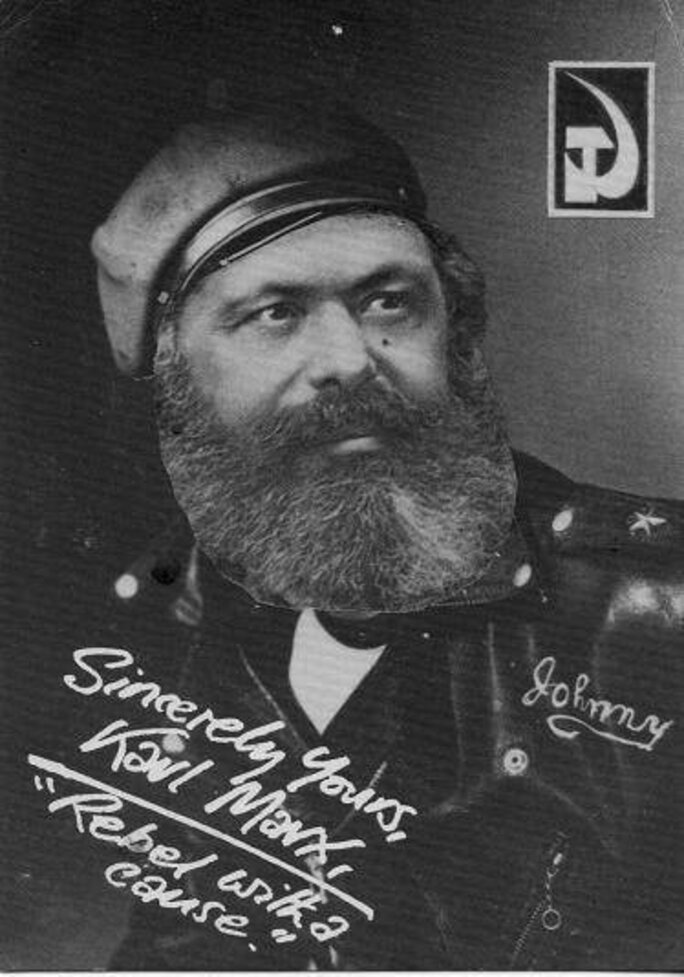
* Un capitalisme impersonnel [extrait de la partie I]
Pour éviter des malentendus possibles, encore un mot. Je n'ai pas peint en rose le capitaliste et le propriétaire foncier. Mais il ne s’agit ici des personnes, qu'autant qu'elles sont la personnification de catégories économiques, les supports d'intérêts et de rapports de classes déterminés. Mon point de vue, d'après lequel le développement de la formation économique de la société est assimilable à la marche de la nature et à son histoire, peut moins que tout autre rendre l'individu responsable de rapports dont il reste socialement la créature, quoi qu'il puisse faire pour s'en dégager.
Karl Marx, préface à la 1e édition du livre I du Capital. Critique de l’économie politique, 1867
Dans cet extrait, le capitalisme ressemble davantage à une machinerie impersonnelle, qui n’est contrôlée par personne, du type des ordinateurs qui au cinéma échappent à la maîtrise humaine, comme les figures de la Matrice (dans la série des Matrix) et de Skynet (dans la série des Terminator). Le capitalisme, contrairement à ce que l’on lit trop souvent dans des tracts politiques dits « marxistes » ou sur l’internet critique, ce n’est pas avant tout un « complot » mené par des « forces obscures ». Avec Marx, on n’est pas du tout dans le registre de James Bond. C’est pourquoi il avance ici que même l’individu capitaliste n’est pas « responsable de rapports dont il reste socialement la créature ». Les riches, et pas seulement les prolétaires, sont bien aussi dominés par la logique capitaliste. Et ils ne maîtrisent pas cette logique, ils en sont aussi les « créatures ». La différence avec les prolétaires est que, le plus souvent (il y a des petits capitalistes et parfois même des gros qui peuvent être éliminés à tel ou tel moment par la dynamique de la machine), les premiers en profitent et les seconds trinquent. Il n’y a pas réellement de pilotes dans l’avion capitaliste, et changer telle ou telle tête ne change pas grand-chose à sa logique. C’est ce qui contribue aussi à sa dangerosité sociale et écologique.
* L'individualité au coeur de la critique sociale et de l'émancipation [extraits de la partie II]
Déjà d'après cette définition, l’argent est donc la perversion générale des individualités, qui les change en leur contraire et leur donne des qualités qui contredisent leurs qualités propres. […]
Il transforme la fidélité en infidélité, l'amour en haine, la haine en amour, la vertu en vice, le vice en vertu, le valet en maître, le maître en valet, le crétinisme en intelligence, l'intelligence en crétinisme. Comme l'argent, qui est le concept existant et se manifestant de la valeur, confond et échange toutes choses, il est la confusion et la permutation universelles de toutes choses, donc le monde à l'envers, la confusion et la permutation de toutes les qualités naturelles et humaines. […]
Á la place de tous les sens physiques et intellectuels est donc apparue la simple aliénation de tous ces sens, le sens de l'avoir.
Karl Marx, Manuscrits de 1844, Cahier III, publication posthume
L’argent-roi et la marchandisation généralisée des relations humaines, propres aux sociétés capitalistes, tendent à écraser la singularité incommensurable de chaque individu au profit d’une mesure unique : ce que cela coûte et ce que cela rapporte en espèces sonnantes et trébuchantes. L’être humain est appauvri au profit de l’avoir. Ses sens et ses capacités sont amenuisées par rapport aux potentialités de l’« homme total » (ou « individu complet »).
[…]
Á la place de l'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de classes, surgit une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous.
Karl Marx et Friedrich Engels, Le Manifeste communiste, 1848
Cette phrase célèbre d’un des livres les plus diffusés dans le monde a souvent été lue à l’envers par des générations de militants « marxistes », sans que la place des mots aient été d’ailleurs changée de place : d’abord le collectif (« le libre développement de tous ») et ensuite, éventuellement dans des temps reculés, une place pour l’individuel (« le libre développement de chacun »). Or, pour Marx et Engels, c’est clairement « le libre développement de chacun » qui est « la condition du libre développement de tous ». Cette lecture massivement déformée illustre de manière éclairante le poids du logiciel « collectiviste ».
[…]
[Conclusion de la partie II] Enfin, la place prise chez Marx par les singularités individuelles nous conduit à nous interroger sur l’adéquation même du mot « communisme » pour le dire. Ce mot privilégie étymologiquement le « commun », et la prégnance historique du logiciel « collectiviste » appuie cette inertie lexicale. C’est pourquoi il m’apparaît que, contrairement à ce qu’écrivent Pierre Dardot et Christian Laval, encore prisonniers de ce logiciel « collectiviste », l’émancipation sociale ne doit pas continuer à être d’abord associée à « l’affirmation d’un monde commun » et à l’« institution du commun » [dans Marx, prénom : Karl, Gallimard, 2012, p.691]. La mise en tension suggérée par Emanuel Levinas, « comparer l’incomparable » [dans Éthique et infini, 1e éd. : 1982, Paris, Le Livre de Poche, coll. « biblio essais », 1990, p.84], me semble plus ajustée et moins déséquilibrée. Reste à trouver un nouveau mot ou à réactiver un mot ancien pour mieux dire cette tension émancipatrice…

* Entre question écologiste et tentations productivistes [extraits de la partie III]
Dans l'agriculture moderne, de même que dans l'industrie des villes, l'accroissement de productivité et le rendement supérieur du travail s'achètent au prix de la destruction et du tarissement de la force de travail. En outre, chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol ; chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays, les États-Unis du nord de l'Amérique, par exemple, se développe sur la base de la grande industrie, plus ce procès de destruction s'accomplit rapidement. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse : La terre et le travailleur.
Karl Marx, Le Capital. Critique de l’économie politique, livre I, section 4, chapitre 15, 1867
Il n’y a pas que le travail qui constitue une source de richesse pour Marx dans ce passage, mais aussi la terre. Et il n’y a pas alors que le travail qui est exploité par le capitalisme, mais aussi les sols. Et cette exploitation met en danger la durabilité du sol (« un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité »). Marx ancêtre des pensées écologiques de la durabilité ? En tout cas, on a là les prémisses d’une formulation de la contradiction capital/nature qui intéresse les écosocialistes contemporains.
[…]
Ainsi le capital crée la société bourgeoise et l'appropriation universelle de la nature et du lien social lui-même par les membres de la société. D’où la grande influence civilisatrice de capital : sa production d'une étape de la société en comparaison de laquelle les stades antérieurs n’apparaissent que comme de simples développements locaux de l’humanité et comme une idolâtrie de la nature. Pour la première fois, la nature devient un pur objet pour l'humanité, une pure affaire d'utilité ; elle cesse d'être reconnue comme une puissance en soi ; et la découverte théorique de ses lois autonomes apparaît simplement comme une ruse afin de la subordonner aux besoins humains, soit comme objet de consommation, soit comme moyen de production. […]
Mais, en fait, quand la forme bourgeoise limitée est supprimée, qu’est-ce que la richesse sinon l'universalité des besoins, des capacités, des plaisirs, des forces productives, etc., des individus, universalité créée par l'échange universel ? Sinon le plein développement de la domination humaine sur les forces de la nature, tant sur celles de ce qu’on appelle la nature que sur celles de sa propre nature humaine ?
Karl Marx, Grundrisse (ou Principes d’une critique de l’économie politique), manuscrits de 1857-1858, publication posthume
La nature voit parfois son statut se dégrader chez Marx, qui semble se réjouir ici de l’émergence d’un rapport pauvrement instrumental (« une pure affaire d’utilité » plutôt que « puissance en soi »), voire même dominateur. Ce thème marxien et « marxiste » de « la domination de la nature » participe du « mythe prométhéen » décortiqué récemment par le philosophe et anthropologue François Flahaut [dans Le crépuscule de Prométhée. Contribution à une histoire de la démesure humaine, Mille et une nuits/Fayard, 2008].
* Radicalité et complications [extrait de la partie VI]
Être radical, c'est prendre les choses par la racine. Or, pour l'homme, la racine, c'est l'homme lui-même.
Karl Marx, Pour un critique de la philosophie du droit de Hegel. Introduction, 1844
Sur le plan de la connaissance comme de celui de l’action, la radicalité pour Marx dans ce court extrait fort célèbre, ce n’est pas d’abord, comme on l’entend aujourd’hui dans les médias ou dans la rue, l’extrémisme, l’excès ou la violence physique. Ce n’est pas non plus être le « Monsieur Plus » de la politique (plus d’augmentations de salaires, plus d’imposition pour les riches, plus de droits, plus de nationalisations, etc.). C’est avant tout se préoccuper de la racine des problèmes. Et pour un humanisme révolutionnaire et émancipateur, « la racine c’est homme lui-même ». Ainsi que ses rapports avec la nature, pourrait-on ajouter à la lumière de la partie III. Mais, depuis Marx, avec les apports des sciences humaines et sociales, avec ceux des sciences naturelles, avec les déconvenues et les tragédies du XXe siècle (nazisme, stalinisme, colonialisme, génocides…), avec les menaces écologiques et les dérèglements climatiques… l’humain (que certaines entreprises politiques présentent hâtivement comme une solution : « l’humain d’abord ! ») se révèle de plus en plus comme un nœud de problèmes. Les racines de nos difficultés et de nos espérances apparaissent emmêlées. La radicalité a de plus en plus à voir avec les complications, comme ce livre consacré à l’actualité d’un grand penseur du XIXe siècle le montre déjà amplement. Contre les simplistes et les manichéens de tous poils, osons l’affirmer avec Marx, à partir de Marx, à côté de Marx, au-delà de Marx et contre Marx !
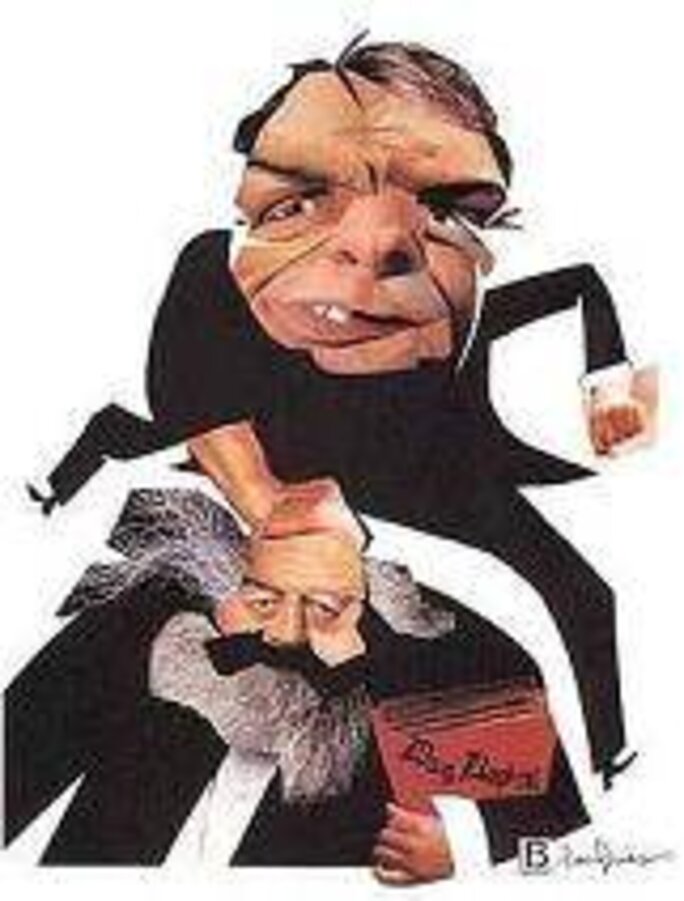
**************************************************
*Sommaire de Marx XXIe siècle. Textes commentés par Philippe Corcuff
(Textuel, collection « Petite Encyclopédie Critique », 22 août 2012, 192 pages, 12 euros)*
Introduction : Actualité d’un Marx hérétique dans la tourmente capitaliste
Un monde en crises…et Marx
Quel « retour à Marx » ?
Méthodologie : un autre rapport aux textes de Marx grâce à Michel Foucault
Une édition populaire à visée de recherche
Partie I : Capitalisme, question sociale et luttes des classes
1 - Le capitalisme comme machinerie impersonnelle
La Machinerie capitaliste : plutôt Matrix ou Skynet que James Bond !
Le mécanisme de l’exploitation capitaliste : les mystères de la plus-value
Le capital comme rapport social
2 - Contradiction capital/travail et question sociale
Le lien contradictoire et historique entre le travail salarié et le capital
Quand la bourgeoisie produit « ses propres fossoyeurs » : la classe des salariés
3 - Une pente économiste : une composante « marxiste » chez Marx
Une formulation synthétique à tendance économiste en 1859 : « base économique » et « superstructure »
Tentations économistes dans Le Manifeste communiste
Limites de l’économisme : le capital comme rapport social
4 - Des sentiers adjacents, à l’écart des autoroutes déterministes
Relativité historique des besoins sociaux et frustrations relatives
Complication des rapports entre l’art grec, Shakespeare, leurs sociétés et nous
Tendances, contre-tendances et circonstances particulières dans la dynamique capitaliste
5 - Luttes des classes et classes
Les classes définies comme constructions historiques à travers leurs luttes dans Le Manifeste communiste
De la classe en soi à la classe pour soi
Être ou ne pas être une classe ? Le cas des « paysans parcellaires » français sous le second Bonaparte
Conclusion de la Partie I
Partie II : De l’individu blessé à « l’homme total »
1 - Une approche relationnaliste et historique de l’individu
Se déplacer par rapport à l’opposition individus/société
Un processus sociohistorique d’individualisation
2 - Individus et critique du capitalisme
L’argent-roi contre l’individualité dans les Manuscrits de 1844
Entre fascination progressiste pour le capitalisme et critique romantique des « eaux glacées du calcul égoïste »
La libre concurrence comme libre individualité tronquée
L’individu « morcelé » par la division du travail propre à l’usine capitaliste
3 - Émancipation sociale et individualités
Émancipation d’un individu sensible dans les Manuscrits de 1844
Le « communisme grossier » comme « nivellement » des individualités
Un communisme de la co-production des individualités
Individus, communauté et association
L’individu multi-activités de la société communiste dans L’idéologie allemande
L’individualité concrète de Marx et Engels contre l’individualité abstraite de Max Stirner
Transformation de soi et transformation collective
Le libre développement de chacun comme condition du libre développement de tous
Capacités créatrices en devenir et dynamique du temps libéré dans les Grundrisse
Des « hommes librement associés »
De « Á chacun selon son travail » à « De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins ! »
Conclusion de la partie II
Partie 3 : La vie, les tentations productivistes et la question écologiste
1 - Des flottements entre la globalité de « la vie » et des tendances productivistes
« Vie », « activité matérielle », « production » et « détermination » : des notions qui ne vont pas de soi chez Marx et Engels
La tentation d’un déterminisme technologique : moulin à bras et moulin à vapeur
Admiration pour la révolution productive continue propre au capitalisme
Figure du productivisme marxien et « marxiste » : le thème du « développement des forces productives »
2 - Marx et la question écologiste
Un humanisme naturaliste dans les Manuscrits de 1844
La nature comme « condition première »
Une épine dans l’écologisme de Marx : le schéma de « la domination de la nature » dans les Grundrisse
Le capitalisme comme productivisme et l’économie politique comme idéologie du productivisme : l’accumulation du capital comme horizon infini
Le capitalisme contre la durabilité des sols
La destruction capitaliste des forêts
Le capitalisme, l’agriculture et « la chaîne des générations »
Conclusion de la partie III
Partie IV : État, question démocratique et politique d’émancipation
1 - Des critiques de l’État à son abolition
Critique de la bureaucratie
De l’État instrument de classe à l’abolition de ses instruments répressifs au moment de la Commune de Paris de 1871
L’État comme cristallisation des rapports de classes sous domination bourgeoise : le cas du gouvernement provisoire issu de la Révolution de 1848 en France
Le débat Marx/anarchistes autour de « la conquête du pouvoir d’État » [extraits de texte de Marx, Bakounine et de Rosa Luxemburg]
2 - Des limites de l’émancipation politique à une politique de l’émancipation : la question démocratique
Le libéralisme politique en héritage
La démocratie comme autodétermination du peuple et disparition de l’État comme « tout »
Des limites de l’émancipation politique à l’émancipation humaine globale
Les individus-prolétaires contre l’État
Un mouvement mondial d’émancipation sociale des individus
Entre poids de l’État-nation et révolution mondiale : ambiguïtés du Manifeste communiste
Minorités, majorité et auto-émancipation des opprimés : un problème encore actuel ?
Le modèle démocratique de la Commune de Paris de 1871
Ambivalences et dynamique démocratique du suffrage universel
Conclusion de la partie IV
Partie V : Défrichages : l’idéologie, l’histoire et la pratique
1 - La question de l’idéologie
Les idées comme « langage de la vie réelle »
Les idées dominantes en tant qu’idées de la classe dominante
Division du travail idéologique et illusions collectives
Auto-illusionnement idéologique : le cas de la petite bourgeoisie démocrate en 1848-1851 en France
Idées révolutionnaires
2 - L’histoire en questions
Les économistes bourgeois contre l’histoire
Une tentation évolutionniste
Une critique de l’évolutionnisme
Hommes, circonstances et jeu des temporalités
3 - La pratique comme étalon
De l’arme de la critique à la critique des armes
Figures de la praxis dans les Thèses sur Feuerbach (1845)
Le communisme comme « mouvement réel qui abolit l’état actuel »
Conclusion de la partie V
Partie VI : Questions méthodologiques
Une analyse et une politique radicales
Entre objectivisme et subjectivisme : l’activité objectivante
Partir des individus réels
Le concret-pensé comme chemin théorique-empirique face aux écueils empiristes et théoricistes
Dé-naturaliser les processus historiques : en partant de l’exemple du fétichisme de la marchandise
Les outils de la dialectique : convergences et différences entre Marx et Proudhon [extraits de textes de Marx et de Proudhon]
Conclusion de la partie VI
Conclusion générale : D’une totalisation marxienne fissurée à un global redéfini ?
**********************************
Philippe Corcuff est notamment l‘auteur de La société de verre. Pour une éthique de la fragilité (Armand Colin, 2002), Bourdieu autrement. Fragilités d’un sociologue de combat (Textuel, 2003), de Où est passée la critique sociale ? Penser le global au croisement des savoirs (La Découverte, collection « Bibliothèque du MAUSS », 2012 ; voir l’entretien avec Joseph Confavreux sur Mediapart : « Où est passée la critique sociale ? », 30 juin 2012, accès abonnés en cliquant ici) et donc du nouveau Marx XXIe siècle. Textes commentés (Textuel, collection « Petite Encyclopédie critique », août 2012). Il est maître de conférences en science politique à l’Institut d’Études Politiques de Lyon. Co-fondateur de l’Université Populaire de Lyon et de l’Université Critique et Citoyenne de Nîmes, il est aussi membre du conseil scientifique de l’association altermondialiste ATTAC, du Nouveau Parti Anticapitaliste et du syndicat SUD Education. Voir aussi son blog sur Mediapart : Quand l’hippopotame s’emmêle...



