Voici donc un aperçu de ce livre – son avant-propos et le début de sa première partie, intitulée « La victoire des vaincus » – avant le débat qui lui sera consacré lors de notre prochain « En direct de Mediapart », le jour de sa sortie, de 18 h à 19 h, avec les historiens Claude Pennetier et Paul Boulland. Tout acheteur de Voyage en terres d’espoir (Éditions de l’Atelier, 500 pages, 25 euros) se verra offrir trois mois d’accès au Maitron en ligne, où il pourra découvrir par lui-même les dizaines de milliers de notices biographiques qui en sont la matière.
––––––––––––––––––––––––––––––
Avant-propos
En hommage au Maitron
Ce livre honore une dette ancienne. Il y a quinze ans, dans Secrets de jeunesse, j’avais écrit ceci, qui a fini par m’engager :
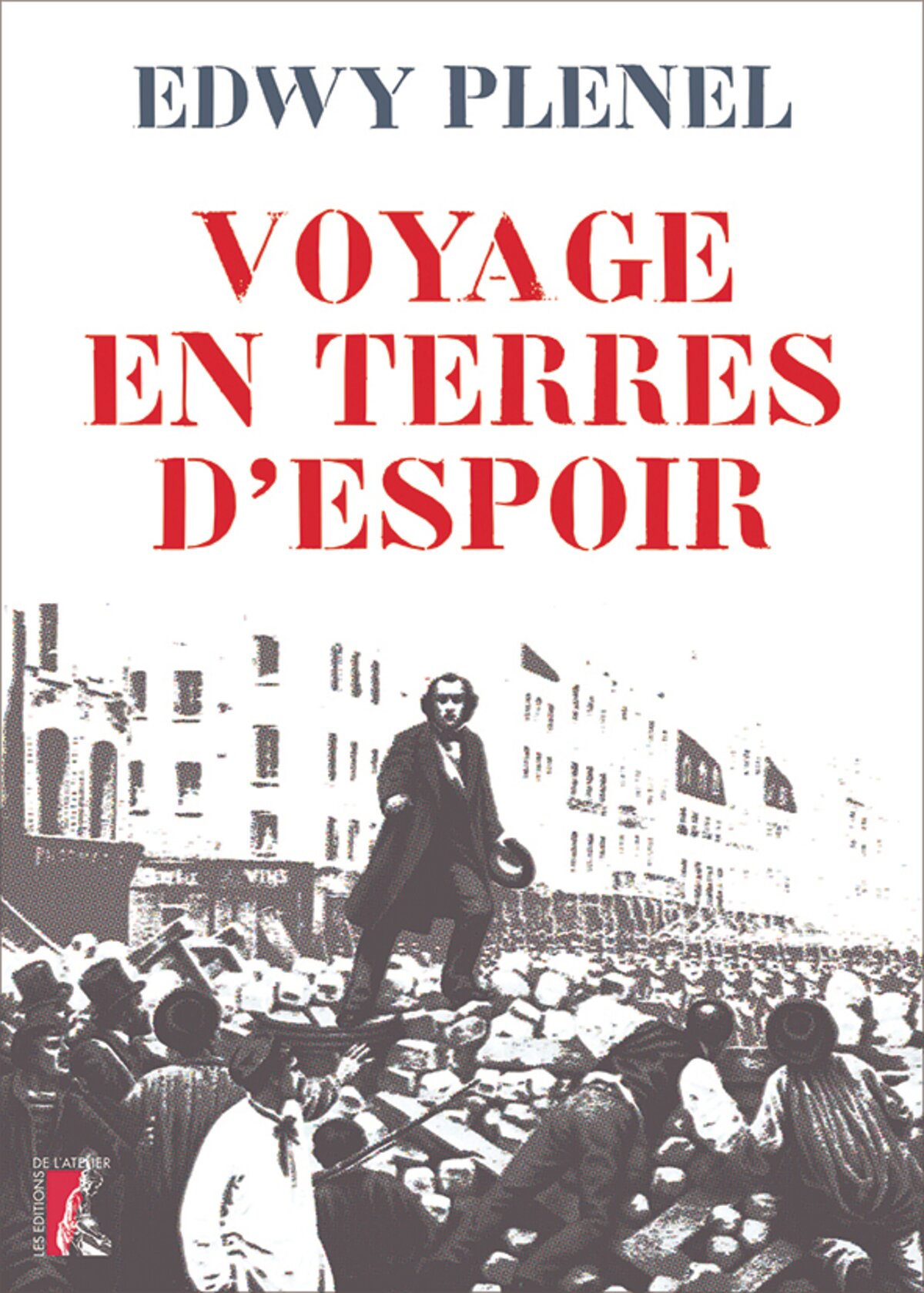
Agrandissement : Illustration 1
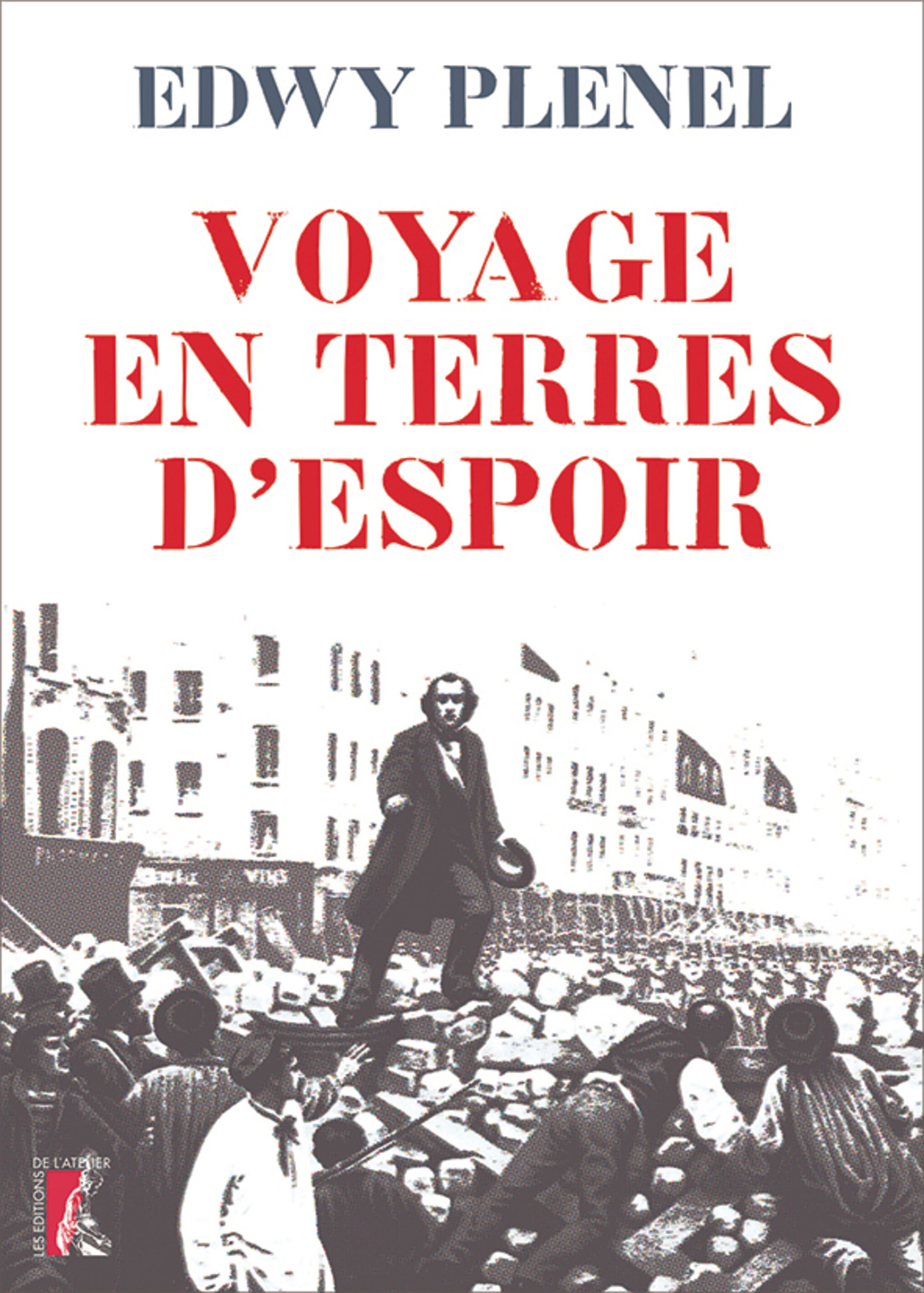
« Infidèle aux canons du matérialisme historique, je dois confesser avoir toujours eu le goût de cette pédagogie par l’exemple où les défis prométhéens sont tissés de ce matériau ordinaire : des vies humaines, aléatoires et imprévues, misérables et grandioses, anecdotiques et légendaires. Ce penchant est moins apolitique qu’il ne paraît : face à la longue litanie des vainqueurs qui réquisitionnent l’Histoire – grande histoire où de grandes circonstances fabriquent de grands hommes –, seule l’invention permanente d’une histoire à petite échelle humaine est à même de sauver le souvenir des innombrables et modestes vaincus. L’histoire aussi est inégale, et les historiens qui ont choisi de travailler sur les territoires d’en bas le savent d’expérience, cherchant minutieusement des traces infimes sous les empreintes solides laissées par les mondes d’en haut.
« Nul hasard sans doute si le monument, immense et infini, qui nous permet de revisiter le mouvement ouvrier, ce continent émergé au xixe siècle et aujourd’hui en partie englouti, est un “Dictionnaire biographique”, une collection d’histoire de vies. Bien que ce soit plutôt un usuel destiné aux bibliothèques, j’ai acquis par souscription ce Dictionnaire en quarante-quatre tomes, fondé par Jean Maitron et dirigé par Claude Pennetier, et, depuis, je m’y promène souvent, baguenaudant d’une notice à l’autre, passant de quelques lignes sur un pseudonyme éphémère à plusieurs pages sur un personnage durable, redécouvrant ainsi la pluralité d’un monde extrêmement divers [1 – les notes sont à la fin de ce billet]. »
À l’occasion de la publication du dernier tome de la cinquième période du Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social, qui clôt un immense cycle allant de 1789 à 1968 [2] – de la Révolution fondatrice à nos révoltes formatrices –, j’ai donc accepté cette proposition des Éditions de l’Atelier, héritières des Éditions Ouvrières : partager ma passion pour le Maitron. La raconter pour essayer de la transmettre. Expliquer en quoi ce monument de savoir n’est pas une citadelle académique, imprenable et lointaine, mais un outil collectif, disponible et proche, au service de toutes celles et de tous ceux qui ne se satisfont pas d’un ordre du monde dont l’injustice mène à la catastrophe, aujourd’hui comme hier. En somme, donner envie d’aller y voir.
Car le Maitron, avec les cinquante-six volumes du dictionnaire principal auxquels s’ajoutent neuf dictionnaires thématiques et onze dictionnaires internationaux, soit soixante-seize tomes fin 2016 [3], ne raconte pas un passé mort, embaumé et desséché, qu’il faudrait vénérer en silence comme l’on visiterait un musée, ses antiquités désincarnées et ses curiosités épinglées. Ses récits de vies animent une histoire vivante, avec ses lumières et ses ombres, ses joies et ses tristesses, ses gloires et ses misères, nullement édifiante et intensément humaine. Et c’est ainsi que sa lecture sauve l’espérance dont furent tissées toutes ces vies, quels qu’aient été leurs aléas, ce « non » qui fut leur acte fondateur par le refus des fatalités et des servitudes, des oppressions et des injustices.
Ce livre est donc d’abord un hommage à cette œuvre monumentale et collective qui continue de s’écrire, de même que son objet d’étude continue de vivre. Hommage à un travail historiographique pionnier auquel la révolution numérique donne désormais toute son ampleur, démultipliant par la mise en ligne du Maitron [4] les chemins de découverte (163 084 biographies consultables à ce jour). Grâce aux liens d’une notice à l’autre, elle permet un incessant peaufinage de l’œuvre, avec des actualisations permanentes (au rythme de 10 000 nouvelles biographies chaque année) et des ajouts de compléments ou de corrections au gré des découvertes des historiens. Hommage, en ce sens, à un chantier toujours inachevé, sans cesse complété par de nouvelles précisions, toujours ouvert aux trouvailles des chercheurs. Une histoire en devenir comme l’est le passé plein d’à présent dont elle témoigne.
Au-delà du compliment, ce voyage est surtout une invitation à s’y promener et à y apprendre, à s’en inspirer et à y respirer. Ne pas se contenter d’admirer à distance mais s’approprier cet héritage sans testament, comme une promesse que nous nous ferions à nous-mêmes. Car en nos temps obscurs, d’incertitude et de doute, visiter le Maitron, c’est reprendre force et courage. À la manière des traces qui, dans notre langue, sont aussi bien des signes d’un passé effacé que des sentiers menant à l’inconnu, l’espoir que portent les centaines de milliers de vies qui sont la matière de ses notices biographiques est un chemin inédit, qu’il nous revient d’inventer en marchant sur leurs pas. Pour cette randonnée, nulle carte préétablie qui donnerait des assurances, transformant le paysage en certitude. Mais, plus essentiellement, la quête d’une hauteur qui nous élève et nous relève, en vue d’une ligne de crête où se laisse approcher, de nouveau, l’horizon d’une espérance : l’émancipation.
Acte de fidélité et geste de survie, ce livre est divisé en deux parties autonomes, que le lecteur peut découvrir comme bon lui semble. La première est un essai sur le Maitron, l’histoire qu’il raconte et l’histoire qu’il pratique. La seconde est une sélection subjective et aléatoire de notices, au hasard des périodes et des volumes du Dictionnaire. Une sorte de version démocratique et sociale de cette « carte de Tendre » que, sous l’Ancien Régime, dessinaient les amoureuses pour exprimer, par la quête d’une contrée imaginaire, leurs rêves et leurs passions, leurs désirs inaccomplis et leurs penchants intimes.
Car la solennité des cimetières pas plus que la froideur des tombeaux ne sont ici de mise. Plurielle et multiple, l’Histoire maillée d’histoires que nous raconte le Maitron est un récit sensible, celui d’une réalité à portée d’utopie tout comme un chœur antique serait à portée de voix.
Paris, le 31 août 2016
––––––––––––––––––
En complément de cet avant-propos, voici le tout début de la première partie de ce Voyage en terres d'espoir, intitulée « La victoire des vaincus » :
« Or quiconque domine est toujours héritier de tous les vainqueurs.
Entrer en empathie avec le vainqueur bénéficie toujours, par conséquent, à quiconque domine. »
Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire (1940).
Les vainqueurs n’ont rien à nous apprendre quand les vaincus laissent des savoirs méconnus.
Des vainqueurs, nous savons tout, sauf ce qu’ils cachent – leurs bassesses, leurs crimes, leurs mensonges, ces inévitables vilénies qui ont accompagné leurs conquêtes. En dehors de ces médiocrités que leurs légendes dissimulent, ils ne lèguent que l’éternité du pouvoir, la force de l’ambition, les ruses de la domination. Leur enseignement est de fascination pour la puissance, cette volonté d’un seul qui réussit à s’imposer à tous. S’il n’est pas négligeable, ne serait-ce que pour sa force de conviction ou comme exemple de détermination, il n’en est pas moins pauvre : rien de bien nouveau depuis les conquérants d’Hérodote, les dieux de Sophocle, les rois de Shakespeare ou le prince de Machiavel. La preuve en est que nous sommes d’ordinaire plus interpellés par leurs faiblesses ou leurs chutes, ces moments où les vainqueurs doutent et trébuchent, souffrent et s’interrogent, retombant enfin à hauteur d’humanité. À notre hauteur.
L’histoire d’en bas que racontent les vaincus est à cette hauteur, justement. Celle de nos vies humaines où l’extraordinaire peut être ordinaire, où la bonté n’a pas besoin de gloire pas plus que la beauté n’y réclame de grandeur. C’est une histoire le plus souvent oubliée ou effacée, méprisée ou déformée ; ses traces sont infimes, fragiles, voire incertaines. Elle ne s’inscrit pas en monuments de pierre ni en décorations clinquantes, en ruines grandioses ou en palais somptueux. Non, elle n’est le plus souvent qu’un souffle éphémère, une vie en pointillé, une œuvre à peine ébauchée. Un dessin inachevé, des desseins interrompus. Une promesse en jachère.
Quand les vainqueurs ne nous proposent que de les imiter, s’inscrivant dans une histoire antiquaire qui n’est que répétition et piétinement, les vaincus nous laissent des possibles à inventer. Suivre leurs pas, c’est partir à la chasse au trésor. Il y a des énigmes à déchiffrer, des secrets à éventer, des impasses à éviter, des mystères à découvrir… En somme, une terre d’aventure à l’inverse des territoires des vainqueurs qui se visitent en touristes, avec guides et conférenciers, chemins balisés et parcours autorisés. Lieux mille fois arpentés, comme un air de déjà vu quand, en revanche, la surprise et l’étonnement sont au détour des sentiers de traverse où se nichent les vaincus d’une histoire écrite par les vainqueurs.
Ils ne sont donc vaincus qu’en apparence, et parce que nous le voulons bien. La paradoxale victoire des vaincus, c’est précisément cette liberté qu’ils nous lèguent : une histoire ouverte, sans fin ni finalité, à faire et à inventer. Une histoire incertaine et imprévisible, avertie de son incertitude créatrice. Et la défaite des vainqueurs, c’est de ne rien savoir de tout cela, à force de croire à l’éternité de leurs conquêtes et à l’immuabilité de leurs privilèges.
De Spartacus [5] à Guevara, en passant par Babeuf et Jaurès, pour ne prendre que quelques figures, d’autant plus emblématiques qu’elles furent martyres, l’histoire dont il s’agit ici n’est donc pas seulement de longue durée. Elle est éternelle, c’est-à-dire sans début ni terme, sans cesse recommencée, toujours à refaire. Et, par conséquent, définitivement actuelle.
Quand, en 1848, ils publient leur Manifeste communiste, c’est dans ce cycle infini que Marx et Engels inscrivent l’affrontement du prolétariat et de la bourgeoisie dont la nouvelle société naissante, celle du capitalisme mondialisé, sera le théâtre. « L’histoire de toute société jusqu’ici connue est l’histoire de la lutte des classes, écrivent-ils. Hommes libres et esclaves, praticiens et plébéiens, barons et serfs, maîtres et compagnons, bref : oppresseurs et opprimés furent en opposition constante ; ils ont mené une lutte sans répit, tantôt dissimulée, tantôt ouverte ; une lutte qui, chaque fois, aboutit soit à une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit à la ruine des diverses classes en conflit. »
Scène éternellement recommencée où « la tradition de toutes les générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants [6] » (Marx de nouveau, en 1852). Récit sans scénario préétabli où « l’histoire ultérieure » n’est aucunement « le but de l’histoire antérieure » [7] (Marx encore, en 1846). Promesse sans certitude où « l’humanité ne commence pas une nouvelle œuvre, mais réalise son ancien travail en connaissance de cause », cherchant à « accomplir les idées du passé » [8] (Marx toujours, en 1844).
Ainsi, nous voici embarqués pour un long voyage aussi inévitable, à raison des injustices qui le motivent, qu’est improbable son issue, tant l’avenir n’est jamais écrit par avance. L’histoire que donne à voir le Maitron, nous laissant libres de la raconter et de la commenter, n’est donc qu’un moment de cet affrontement sans âge entre opprimés et oppresseurs, dominés et dominants, exploités et exploiteurs, travailleurs et profiteurs, colonisés et colonisateurs, etc.
Cependant, les apparences sont trompeuses, confortées par la vulgate de nos vainqueurs du moment, tenants de la « fin de l’histoire » [9] et des révolutions congédiées. D’abord, l’acteur principal du Dictionnaire paraît historiquement daté et géographiquement limité, ce mouvement ouvrier européen surgi de l’oppression capitaliste et dressé contre ses injustices et ses inégalités au nom d’une humanité sans frontières. Ensuite, depuis notre xxie siècle chaotique et imprévisible, l’époque traversée, essentiellement le xixe et le xxe siècles, avec ses histoires défaites et ses géographies effacées, semble étrangère au nouveau monde qu’affronte la jeunesse d’aujourd’hui. Enfin, l’espérance qui anime ses personnages s’est, en deux siècles, de 1789 à 1989, apparemment affaiblie au point d’être jugée minoritaire, après s’être successivement affirmée, affermie et affadie, de l’émergence des idéaux démocratiques et sociaux à la chute du Mur de Berlin, suivie de l’effondrement de l’URSS.
Or, œuvre insaisissable et mouvante, le Maitron se joue de ces clichés prompts à le ramener à un monde révolu dont il ne serait que le cénotaphe : un tombeau vide d’espoir. Tout au contraire, en le feuilletant à la façon de Montaigne, « à sauts et à gambades [10] », on ne cesse d’y exhumer des vies qui nous parlent, ici et maintenant. La raison en est la polysémie consubstantielle au projet originel de Jean Maitron : ne pas s’ériger en juge de l’ivraie et du bon grain, ne pas prétendre au tri des militants prétendument vrais ou purs, ne pas enfermer leurs biographies dans un cadre normatif ou exclusif, bref, ne pas sélectionner entre tous les « ismes » qui ont fleuri dans la foulée du mot socialisme dont le Français Pierre Leroux revendique la paternité, après 1830. Communisme, anarchisme et trotskysme sont les plus connus, mais il y en a bien d’autres, au hasard des personnalités, des querelles et des contextes, des désaccords et des scissions.
Mais, ici, le sectarisme n’a pas droit de cité et le pluralisme est la règle d’or. Et c’est précisément en sauvant cette diversité, d’autant plus infinie qu’elle s’incarne à travers des trajectoires individuelles multiformes, que l’œuvre collective du Maitron sauve l’espoir des décombres des socialismes étatiques qui l’avaient abîmé, sinon trahi, et des chagrins politiques qui ont accompagné leur désastre. Jetant des ponts entre les continents et tissant des fils entre les itinéraires, le Dictionnaire dévoile des pistes oubliées et ouvre des portes inespérées. Ce faisant, tout en rendant compte des dégâts dont les mésaventures sociales-démocrates et staliniennes portent la responsabilité, il réussit à nous entraîner au-delà de ces éclipses de l’espérance qu’entraînèrent la conversion aux nationalismes de la IIe Internationale en 1914 (l’Union sacrée pour la guerre), puis le basculement dans le totalitarisme de la révolution bolchévique de 1917 (la défense aveugle de l’URSS).
S’agissant du communisme français et, donc, du PCF, le Maitron redonne vie aux individualités que le collectif, son idéologie et sa discipline, ont eu tendance à effacer. Co-directeur du Dictionnaire aux côtés de Claude Pennetier, l’historien Paul Boulland le souligne dans un essai récent, Des vies en rouge [11]. Les biographies, ces trajectoires militantes concrètes et incarnées, redonnent humanité et pluralité à une histoire devenue d’autant plus froide et distante qu’elle a été saisie par l’appareil et son immobilisme. « Restituant dans l’histoire du Parti communiste toute la diversité de ses membres et toute la richesse de leurs itinéraires », écrit-il, la voie ouverte par le Maitron permet de faire « resurgir une réalité interne faite de débats et de résistances, de concurrences et de luttes symboliques » [12].Une réalité complexe et diverse perce enfin à la surface après avoir été trop longtemps enfouie sous la contrainte d’une obéissance aux allures de respect – respect du parti, de sa ligne, de son image, de son ordre établi en somme.
Se promener dans le Maitron, c’est ainsi retrouver le possible de l’histoire, un passé non advenu, plein d’à présent. On y découvre que, non seulement ces catastrophes eurent aussi leurs héros, restés fidèles à l’idéal sans tricher avec la vérité, mais que, de plus, sur la longue durée, ces tragédies sont impuissantes à assombrir définitivement l’horizon. On y retrouve, notamment, la fraîcheur des idéaux initiaux, indissociablement démocratiques et sociaux, ancrés dans la liberté et animés par l’égalité, que, trop souvent, au pouvoir, les gauches étatiques du xxe siècle piétinèrent après que le mouvement social du xixe siècle les leur ait légués pratiquement intacts.
C’est en donnant vie à cette durable pluralité politique et aux nombreuses potentialités qu’elle recèle que le Maitron fait souffler un vent bienfaisant, à la fois consolant et revigorant, sur notre époque désolée et déprimée, si prompte à se lamenter sur elle-même. « L’idée d’une autre société est devenue presque impossible à penser, et d’ailleurs personne n’avance sur le sujet, dans le monde d’aujourd’hui, même l’esquisse d’un concept neuf. Nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous vivons [13] » : à ces mots crépusculaires que François Furet croyait sans doute définitifs, l’atelier du Dictionnaire oppose des actes, ceux de centaines de milliers de vies qui ne se sont pas résolues à révoquer l’espérance. Audacieux et maladroits, téméraires ou illusoires, quelles que soient leurs faiblesses ou leurs limites, ils nous rappellent que non seulement l’histoire n’est jamais finie mais que, surtout, elle ne fait rien d’autre que nous attendre.
> Commander Voyage en terres d’espoir sur le site des Editions de l’Atelier. Sinon, il sera disponible le 20 octobre chez votre libraire ou sur tous les sites de vente en ligne.
> Télécharger
Le dossier de presse de "Voyage en terres d'espoir".
> Une soirée de lectures autour du Maitron aura lieu le lundi 28 novembre à 19 heures à la Maison des Métallos à Paris.
> Mediapart s'était déjà associé début 2013 à un hommage rendu à Jean Maitron et au Dictionnaire dont il fut l'inventeur, organisé à la Mairie de Paris : Hommage au Maitron, cette Atlantide de l'espérance. Ci-dessous la vidéo de mon intervention à cette occasion :
–––––––––––––
Notes
1. Paru en 2001 chez Stock, réédité chez Folio en 2003.
2. Le dictionnaire principal est actuellement découpé en cinq périodes, désormais complètes : 1789-1864, 1864-1871, 1871-1914, 1914-1939 (quarante-quatre volumes au total pour ces quatre premières séries), 1940-1968 (douze volumes).
3. Les dictionnaires par thèmes concernent des secteurs professionnels (gaziers-électriciens, cheminots, militants du Syndicat général de l’Éducation nationale), des régions du monde (Autriche, Allemagne, Japon, Chine, Grande-Bretagne, Amérique du Nord, Maroc, Algérie) ou des moments politiques (l’anarchisme, le Komintern, les fusillés, les coopérateurs). L’ensemble des volumes sont présentés à la fin de ce livre.
4. Voici : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr
5. Sur la mémoire souterraine de Spartacus et de la révolte des esclaves (entre - 73 et - 71 avant J.-C.), lire mon avant-propos à Rosa, la vie, recueil des lettres de Rosa Luxemburg choisies par Anouk Grinberg, Ivry-sur-Seine, Les Éditions de l’Atelier, 2009.
6. Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852) in Karl Marx, Sociologie critique, pages choisies, traduites et présentées par Maximilien Rubel, Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2008, p. 154.
7. Karl Marx et Friedrich Engels, L’Idéologie allemande (1846), in Karl Marx, Sociologie critique, op. cit, p. 153.
8. Karl Marx, Annales franco-allemandes (février 1844), in Karl Marx, Sociologie critique, op. cit, p. 90.
9. Cf. Francis Fukuyama, La fin de l’histoire et le dernier homme (1992), Flammarion, coll. « Champs Essais », 2009.
10. Montaigne, « De la vanité », Essais, liv. III, chap. 9 : « J’aime l’allure poétique, à sauts et à gambades. » Ou encore : « Je vais au change, indiscrètement et tumultueusement. Mon style et mon esprit vont vagabondant de même. »
11. Paul Boulland, Des vies en rouge. Militants, cadres et dirigeants du PCF (1944-1981), Ivry-sur-Seine, Les Éditions de l’Atelier, 2016. Voir aussi Bernard Pudal, Prendre parti. Pour une sociologie historique du PCF, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1989.
12. Paul Boulland, op. cit., p. 12 et p. 307.
13. François Furet, Le Passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au xxe siècle, Paris, Livre de poche, Paris, 1996, p. 808-809.



