« La première victime de la guerre, c’est la vérité » : en souvenir de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, notre consœur et notre confrère de RFI assassinés en 2013 au Mali, j’avais rappelé, ici même, que Marcel Ophüls était parti de cette maxime, attribuée à Rudyard Kipling et reprise par l’historien des médias Philip Knightley, pour son exceptionnel Veillées d’armes. Un an plus tard, fin 2014, le cinéaste avait sollicité Mediapart pour Des vérités désagréables, un projet qui n’aboutira pas, en raison de conflits entre ses divers protagonistes, dont, déjà, une énième guerre d’Israël à Gaza avait été l’événement déclencheur.
« Le scandale est-il un bon test pour la démocratie ? », lui avaient demandé Fabrice Arfi et Antoine Perraud, dans un entretien de 2012. Réponse : « Assurément, surtout s’il passe par le biais de l’investigation. Je ne crois pas à la presse comme un contre-pouvoir. La presse n’a pas de pouvoir, le pouvoir est ailleurs. La presse fait partie intégrante de la liberté. Elle doit gratter où ça fait mal, pour faire sortir des affaires aussi scandaleuses que l’affaire Bettencourt. Elle doit, en définitive, bâtir une contre-mise en scène, face aux agendas officiels. »
Au point de départ de ce cheminement partagé, une complicité intellectuelle née quatorze années avant la création de Mediapart. C’était en 1994, à propos de Veillées d’armes, précisément. En hommage à ce flamboyant indocile, je republie ci-dessous l’article que j’avais consacré à ce film dans Le Monde du 24 novembre 1994 dont le journalisme – sa responsabilité et ses limites, ses risques et ses pièges – est le propos, un propos en douloureuse résonance avec nos impuissances d’aujourd’hui, notamment face aux guerres de Gaza et d’Ukraine.
*
Marcel Ophüls a l’humour des désespérés. Nul moment ne le fait plus sentir, dans Veillées d’armes, que celui de son détour par Venise. Soudain, dans cette ville de palais et de splendeur, encerclée par les eaux, il se moque de lui, de nous, de son sujet, dans un mélange d’amertume et de jubilation. Ophüls ne goûte guère la lamentation et son cortège de postures avantageuses, de bons sentiments et de pensées convenues ; il est du côté de la vie, de ses combats et de ses plaisirs, de ses joies et de ses souffrances, de ce métissage de larmes et de rires qui fait sa scandaleuse indécence. Et c’est ce qu’il nous montre brutalement à Venise, débarquant en coup de vent d’une ville d’Europe qui n’en finit pas de souffrir un siège de Moyen Âge – Sarajevo – pour aller s’amuser et danser, se grimer et se masquer dans la Cité des Doges, symbole de cette civilisation urbaine de mélanges et de brassages que l’on assassine là-bas, en face, de l’autre côté de l’Adriatique, et qui, ici, s’enfonce lentement dans la lagune.
Mais il aurait pu pousser encore plus loin la résonance. Venise, où s’est inventée une bonne part de notre modernité, nous a légué trois mots. Trois mots qui, tels les angles d’un triangle, encadrent notre devenir. Trois mots qui, à eux seuls, rassemblent la quête douloureuse d’Ophüls : arsenal, ghetto et gazette. Récupérant ce vocable d’origine arabe, Venise a donné à « arsenal » un sens qui va bien au-delà de sa signification ordinaire : ce n’est pas seulement l’entrepôt des armes, c’est le cœur de la puissance et le lieu du secret. Pour « ghetto », l’histoire est plus connue : c’est la Sérénissime qui invente ce mot et ce qu’il désigne, ce quartier où les juifs seront assignés à résidence, soumis à des horaires stricts d’ouverture et de fermeture, obligés de construire des immeubles à étages pour s’entasser dans un espace réduit. En revanche, on sait moins que ce n’est pas un hasard si le principal quotidien vénitien se nomme toujours Il Gazzettino : réservée aux nouvelles commerciales intéressant les banquiers et les marchands, la première « gazzetta » parut à Venise au début du XVIIe siècle et devrait, selon Fernand Braudel, son appellation à l’espèce numéraire qui fixait le prix de son achat.
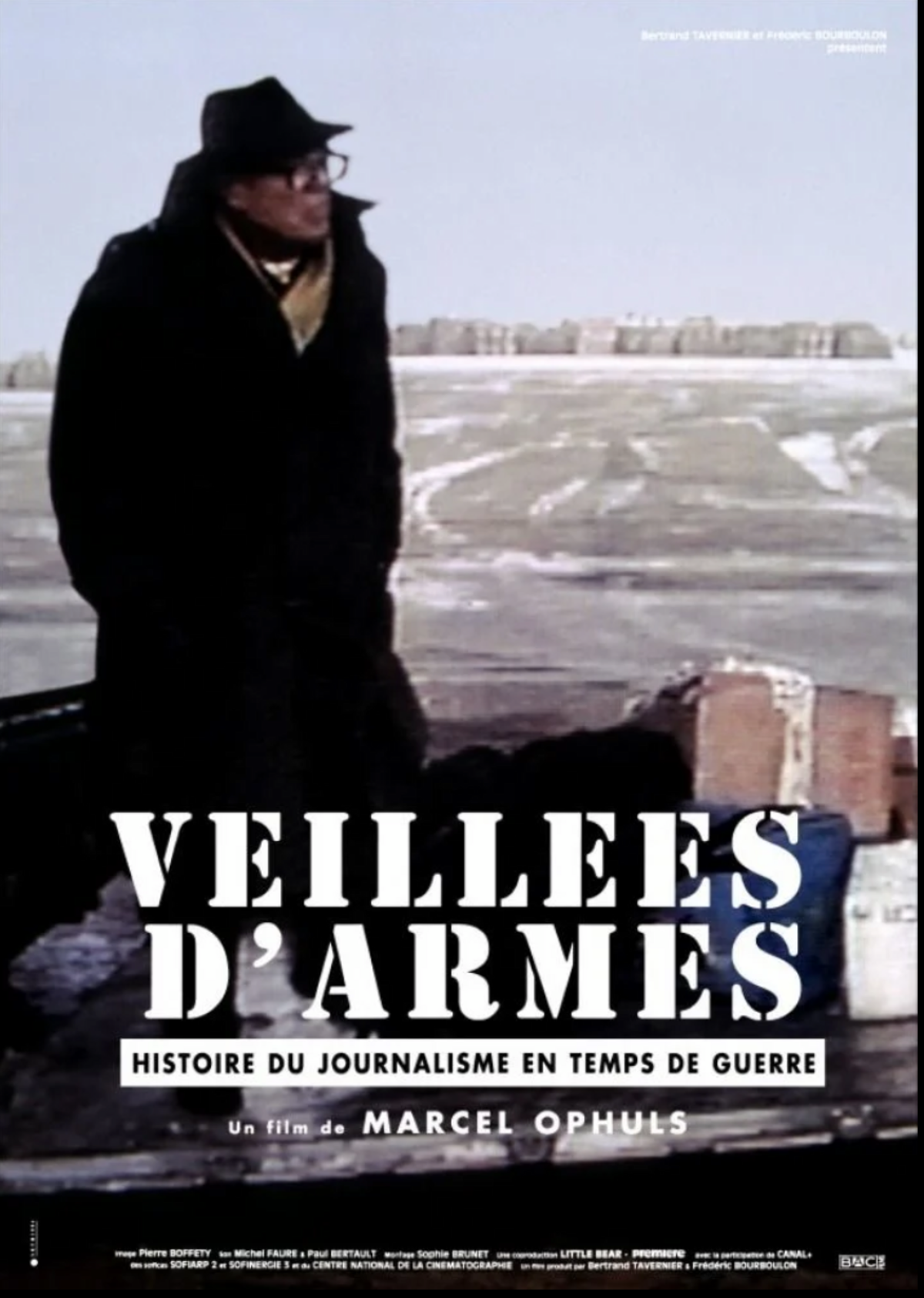
Agrandissement : Illustration 1
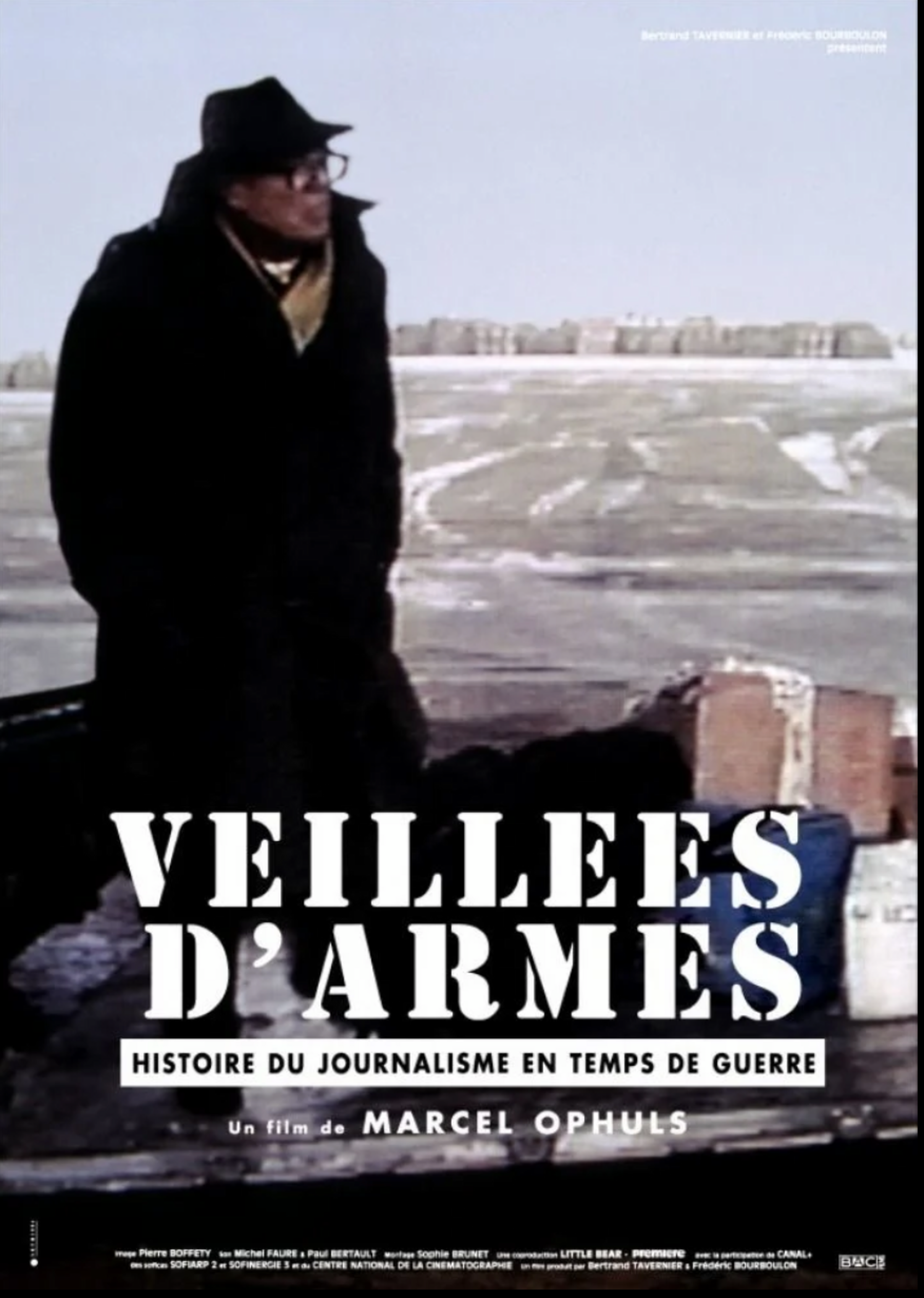
Arsenal, ghetto, gazette – autrement dit : la guerre, l’exclusion, l’information. Mieux encore : l’information marquée dès l’origine du sceau de l’argent, de la monnaie et du profit. La mort, le racisme, les médias : c’est en ayant en tête cette trilogie vénitienne qu’il faut lire le film d’Ophüls. Oui, lire, car cette enquête en images sur le journalisme en temps de guerre est une réflexion réellement écrite, c’est-à-dire minutieusement pensée au moment du montage. Le désordre n’est ici qu’apparent, les divers niveaux de discours et de conscience s’entremêlant dans un ordonnancement savamment construit. Le journalisme sert de fil conducteur, mais il n’est qu’une partie du propos, un point de départ qui entraînera Ophüls plus loin qu’il ne l’imaginait : au cœur de notre avenir, de l’ombre qui revient sur ce siècle finissant et face à laquelle ceux qui font profession d’informer se sentent impuissants.
La genèse du film en témoigne. A l’origine, la guerre du Golfe et cette conviction immédiate que, selon le mot de l’historien des médias Philip Knightley, « la première victime de la guerre, c’est la vérité ». Mais cette guerre-éclair est derrière nous et, entre-temps, il y eut la Bosnie. Or Sarajevo n’est pas Ryad ou Bagdad, et l’on en revient changé, différent, comme décalé. Ophüls, qui se méfie des gloses complaisantes où l’on tenterait d’affadir son propos, l’explique lui-même dans l’interview qui tient lieu de dossier de presse : « Hôtel Terminus ne m’a pas fait changer d’opinion sur Barbie. Idem pour la chute du mur de Berlin, dans November Days. Cette fois, en revanche, ce fut différent. Je suis parti à Sarajevo dès que j’ai eu un peu d’argent, pensant qu’un seul voyage suffirait. En rentrant du premier, je savais qu’il en faudrait d’autres. J’en ai fait six. Voilà. Le point de départ est là : un cinéaste de documentaires qui a son petit sujet se retrouve entraîné dans la tragédie la plus caractéristique de notre culture de la fin du siècle. Et ça non plus, je ne l’avais pas prévu. »
Six voyages au terme desquels Ophüls, par petites touches subtiles, sans pathos ni déclamation, nous lance une question terrible qui nous renvoie à nos responsabilités – de journalistes, de citoyens, de journalistes et/ou de citoyens. C’est la « question d’Auschwitz », posée par Philippe Noiret : « Et si l’on avait vu Auschwitz à la télé, est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Non ça n’aurait rien changé, vu justement Sarajevo et la purification ethnique. » Ce serait un contre-sens d’imaginer dès lors qu’Ophüls s’est livré à un réquisitoire contre le journalisme, ses prudences et ses impuissances. S’il désigne clairement ses complaisances et ses fréquentations, ses mises en scène et ses dérobades, c’est en le prenant comme le révélateur de l’époque, de ce temps d’oubli et de ce monde d’indifférence.
Reste qu’au bout du compte il nous pose confraternellement la question de notre responsabilité. C’est entendu : artisan du petit fait vrai, aucunement détenteur d’une Vérité immuable, travaillant dans les misères du présent, le journaliste doit savoir rester modeste. Il n’en est pas moins en première ligne de ce combat qui fait les démocraties vivantes et conscientes : l’intelligibilité du récit. Les pouvoirs ont appris à mentir en communiquant, ils savent désormais cacher en révélant, ils maîtrisent leurs secrets à l’abri d’une transparence proclamée. Dès lors, le journaliste a, vis-à-vis des autres citoyens, une mission particulière : empêcher que l’enchaînement des événements ne devienne compréhensible qu’à ceux qui veulent se l’accaparer, en se livrant à leurs jeux de pouvoirs sans que l’opinion s’en mêle.
À son corps défendant, le journaliste est requis, convoqué par l’événement : il dépend de lui aussi que la démocratie devienne spectatrice de son renoncement ou actrice de son redressement. Et c’est cette leçon-là qu’assène, modestement, dans Veillées d’armes, John Burns, correspondant du New York Times à Sarajevo et Prix Pulitzer pour ses reportages en Bosnie, en désignant clairement les évidents responsables de cette guerre que les chancelleries occidentales renvoient aux mystères de l’âme balkanique. Une leçon civique ou citoyenne, selon que l’on préfère la langue républicaine ou l’appellation démocratique, que toute école de journalisme devrait désormais accueillir.



