
Agrandissement : Illustration 1

Evidemment. Comment en finir avec Docteur Strange sans en passer par ces cercles de feu qui vous téléportent ici ou là ? A Londres. En plein Himalaya… Ou ces fenêtres qui, par un simple commutateur, ouvrent à notre guise sur le désert, le vrai, plein de sable, ou la mer, les montagnes, ou, pourquoi pas, la gare de Perpignan ? Est-il meilleur emblème des pouvoirs de la connectivité que ces fenêtres qui réalisent magiquement, sur grand écran, ce que nos écrans minuscules nous font fantasmer chaque jour : voyager du fin fond de notre chambre ? Google Maps et Street View restent le lieu d’étonnantes promenades, qui finiront peut-être par se confondre avec les longues marches amicales à la tombée de la nuit.
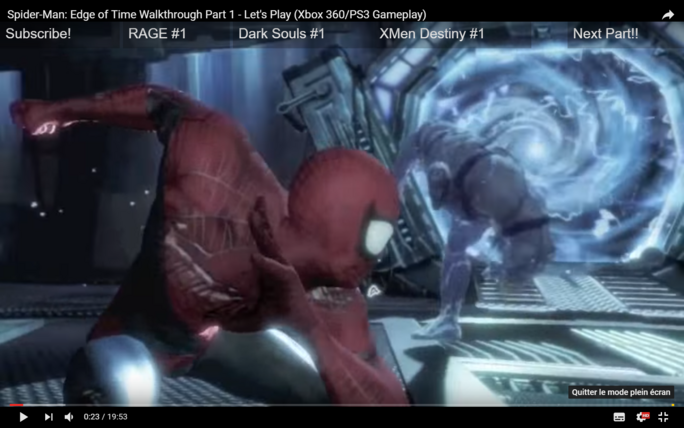
Agrandissement : Illustration 2
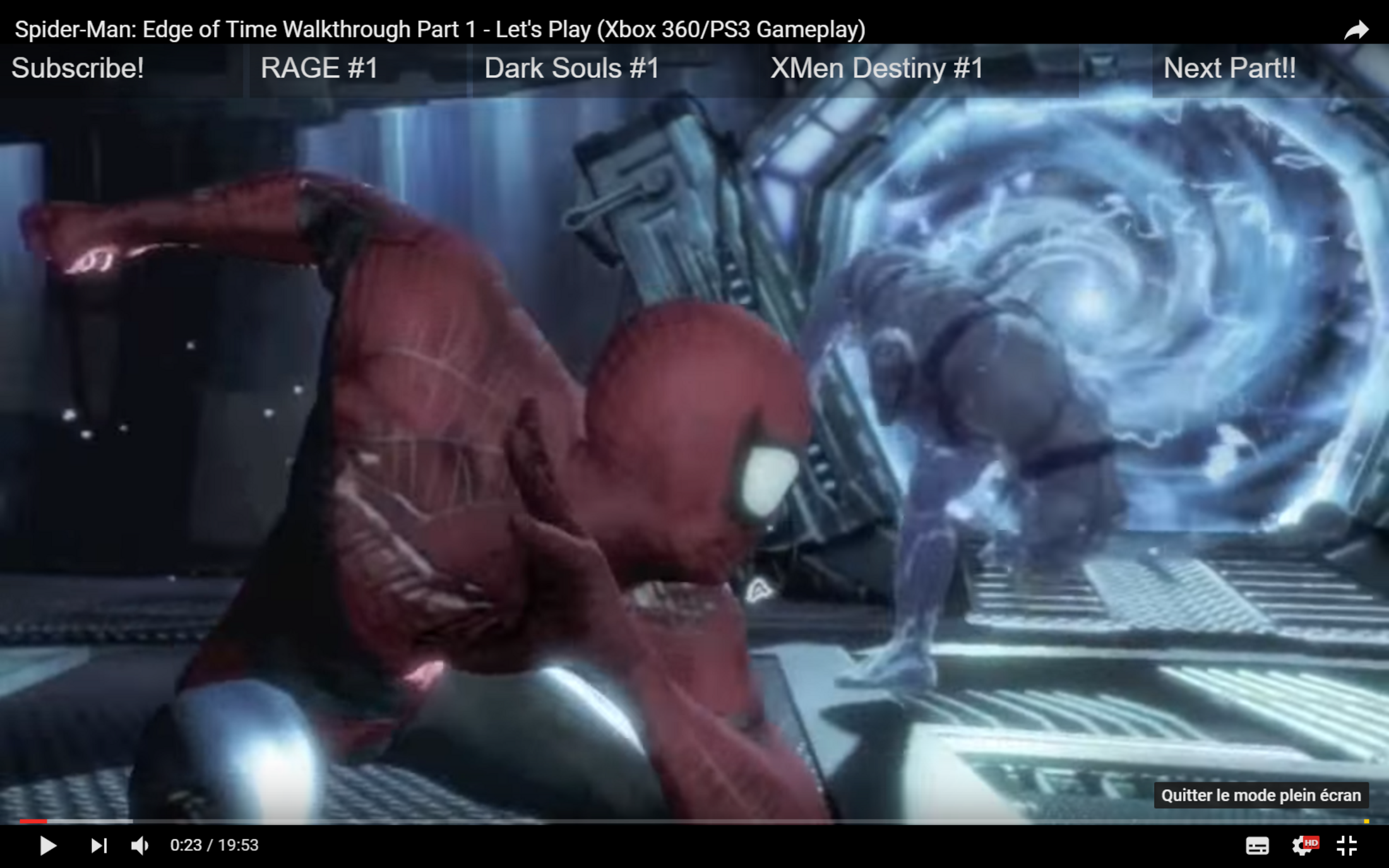
L’originalité, il est vrai, n’est pas au rendez-vous. Les portails plus ou moins enflammées, vous transportant ici ou là, bien loin, dans une autre dimension, courent les comics comme les jeux-vidéo… Quant aux fenêtres à orientation ultra-variable, on avait déjà croisé leurs cousines dans Matrix Reloaded (2003) : une porte ne s’ouvre pas forcément deux fois sur le même fleuve, ni sur la même montagne. Dans L’Agence (2011), Matt Damon découvrait pour sa part un réseau de chemins parallèles en plein New York, se jouant de toute géographie physique. Des portes, toujours des portes, et derrière, les lieux les moins prévisibles, le Moma, un stade, une rue passante… pour une séquence de course poursuite renouvelée. L’intrigue, comme si souvent, est étonnamment plate, sans le moindre arrière-fond. Au moins faudra-t-il reconnaître, dans ces accessoires qui hantent la culture populaire, une véritable séduction, qui pourrait bien finir par gagner, sait-on par quel chemin, le monde de l’architecture proprement dit.

Agrandissement : Illustration 3

Pour en rester à Docteur Strange, il faut en tout cas le remarquer : tous ces attirails progressent inéluctablement vers leur reprise au carré. Cercles et fenêtres ne font que préparer le gouffre final, le portail ultime ; celui qui, par le passage à une ouverture maximale, ferait basculer la totalité du réel dans la zone noire – de l’autre côté de l’entonnoir. Le rêve de translation instantanée s’achève dans la possible mise à mort de l’espace, la promesse d’une errance sans fin. La fascination pour les effets spéciaux, et tout l’attirail spectaculaire de l’informatique, débouche sur la grande peur des temps : que nos adolescents coupent définitivement tout rapport au réel, et se laissent aspirer par les pouvoirs du virtuel.
Ici aussi, d’ailleurs, rien de très neuf, avouons-le. Cahin-caha, le spectateur pop-corn s’est habitué ces dernières années à ces aspirateurs géants qui menacent d’engloutir nos belles prairies. Les 4 Fantastiques, l’an dernier, en offrait un modèle similaire, étrangement perçu de l’autre côté du tuyau.
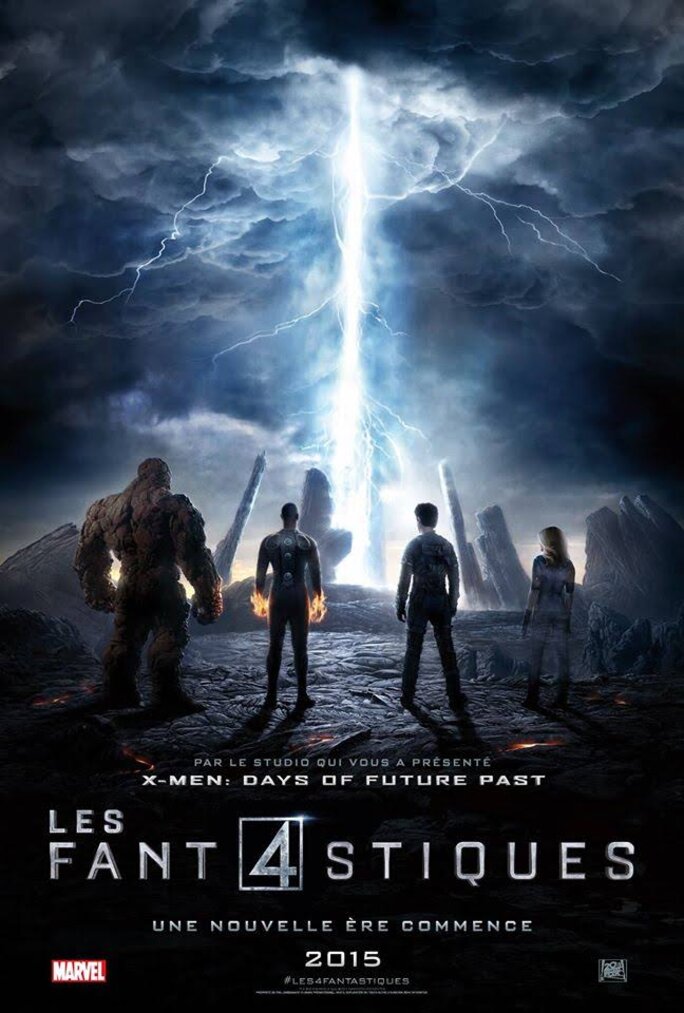
Agrandissement : Illustration 4
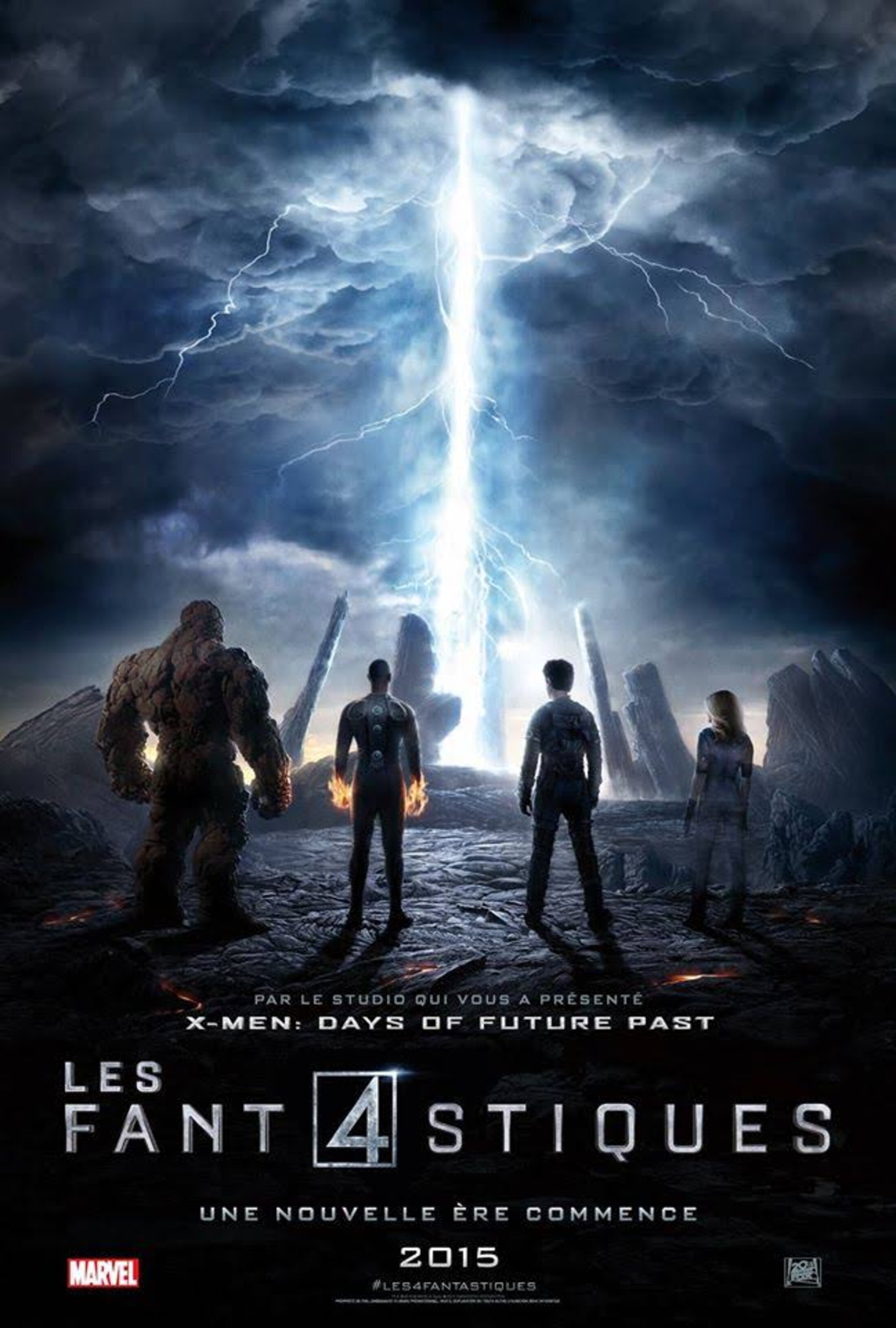
Et l’on pourrait aussi bien revenir vers les entonnoirs majeurs qui viennent déverser dans notre monde – et pour sa perte – les créatures venues des zones les plus hostiles. Ghostbusters 3, il y a quelques mois à peine, installait un vortex au-dessus de New-York, à même de propulser parmi nous les fantômes de la pire espèce – à commencer par celui de Ghostbusters 1, dont le nouvel opus n’offrait que la pâle copie. Plus en amont, on se souviendra peut-être de la porte cosmique qui voyait déferler les terribles ennemis des Transformers 3 (2011) ou, dans un scénario étrangement (?) similaire, les terribles ennemis de The Avengers (2012)… Que d’équipes différentes pour une même tâche : refermer la porte intersidérale.
Parmi ces portails majeurs, retenons-en pourtant un : celui qui, à l’ouverture de Warcraft, sorti cette année, fait transiter par un portail vert-pomme une horde d’orcs aux canines saillantes et musculatures surdimensionnées. Rien n’est épargné au spectateur pour mettre en scène ce passage traumatisant à travers l’eau et l’asphyxie ; on a même trouvé bon de l’accompagner d’une naissance véritable ! Otto Rank, au secours ! Il faut dire que le motif, s’il vient directement du jeu vidéo adapté par le film, tient de cette adaptation même une toute autre force. Ce ne sont pas seulement les orcs qui vont d’une planète à l’autre, mais bien l’histoire tout entière qui bascule d’un médium à l’autre.
Véritable opérateur de transit intermédial (chic !), le portail, dans un tel contexte, se révèle dès lors d’autant plus angoissant que le cinéma a réellement été envahi par le monde de l’informatique. Par l’adaptation de plus en plus courante de jeux vidéo, bien sûr – ou leur retour furibond dans Pixels – hommage bien involontaire à une industrie culturelle devenue dominante. Mais aussi, et surtout, par le poids toujours plus grand pris par l’informatique dans la genèse de l’image cinématographique. Le cinéma, longtemps déclaré art du réel, ne peut que s’inquiéter de ce basculement vers la construction d’une image artificielle, qui redouble désormais l’aspiration du spectateur dans le monde de la fiction.

Agrandissement : Illustration 5

Le cinéma fantasmerait-il à plein régime son absorption dans la zone noire de l’informatique ? Serait-il la proie d’un drame médiatique toujours répété, et d’une fuite du réel jamais vraiment colmatée ? Le super-héros, dans cette histoire-ci, viendrait sans cesse lui sauver la peau, comme on dit, et conjurer la perte augurée par des effets spéciaux toujours plus omniprésents… Il est au moins amusant, de fait, que ce même super-héros (Docteur Strange, les Avengers, les 4 Fantastiques) provienne lui-même d’un autre médium, moins technique cependant, la bande-dessinée, et donc certainement plus rassurant. Comme si un certain cinéma de genre, plus encore que son basculement informatique, mettait en scène l’étrange sandwich médiatique dans lequel il se trouve pris… et toujours sauvé.
A la fin de Docteur Strange, le monde déjà défait se reconstruit. On tient là une séquence remarquable, où chaque élément arraché à la ville, à l’architecture, se voit réintégré à son espace d’origine : un bel effet de retour arrière, propre au cinéma et à ses tout premiers trucages. A la fin de Ghostbusters 3, déjà, l’immeuble détruit par le vortex se voyait magiquement reconstitué. Mais c’est ici tout un ballet de poutres, de pierres, d’objets, et – merveille de la désynchronisation – les acteurs peuvent encore interagir avec ce retour en arrière généralisé. La ville hantée par l’aspiration informatique est une ville de fragments, de miettes, osons-le dire… de pixels. Et il ne serait d’ailleurs pas étonnant que l’architecture elle-même, la vraie, la solide, se prête à ce genre de fantasmes, tant elle dépend désormais de la conception par ordinateur et peut être prise du même vertige médiatique.
A défaut de figurer vraiment le portail majeur qui la menace, on voit d’ailleurs ce qu’elle pourrait faire : mimer son engloutissement progressif, sa dispersion… Ce serait là naturellement l’occasion de trouver d’autres décors pour la suite de Docteur Strange. Le Mahanakhon Building, naturellement, que l’on a déjà pu croiser dans ces colonnes, et qui semble se dépiauter progressivement. Ou bien des réalisations de MVRDV, jouant explicitement sur l’effritement pixellisé du bâti. Le centre commercial pour Lyon Part-Dieu, qu’on a ici même rapproché de Pixels ? Le Ravel Plaza, prévu pour Amsterdam ?

Agrandissement : Illustration 6

Il est amusant que le siège de la banque DNB Nor, réalisé par l’agence à Oslo en 2012, puisse être presque naturellement comparé au jeu électronique de Tetris, auquel ont également été rapportés les décors de Docteur Strange. Un coup de plus, et les lignes s’annuleront ? Comme dans Pixels, encore ?

Agrandissement : Illustration 7

La ville bâtie, la ville rêvée, recomposée, projetée, participent d’un seul et même monde, largement réinventé par le médium informatique qui redessine aussi bien les images, les méthodes de construction que les espaces habités. Un espace de fiction ? Assurément. Ou mieux, de fictions, tant celles-ci peuvent se multiplier, se concurrencer, s’entremêler… Les blobs auraient ici leur mot à dire.



