Un bâtiment contre-utopique, est-ce possible ? Vraiment ? A s’en tenir à une définition minimale du terme, il faudrait non seulement qu’il porte une part de fiction, mais même deux fictions concurrentes… et opposées. Qu’il hésite à tout le moins entre une lecture utopique et son contraire, ou les confronte violemment.
Profitons du troisième volet de Divergente et de son auscultation de la ville informatique pour tenter un exemple : la rénovation à Lyon du centre commercial de la Part-Dieu, sous la houlette de Winy Maas et MVRDV.

Agrandissement : Illustration 1

Le projet vient de tomber, il n’en existe que des images. Elles sont parlantes. Même les tours adjacentes – plutôt brunâtres habituellement – sont devenues d’une blancheur immaculée. Alléluia ! Le monde libéré de la matière ! Au centre, le shopping mall revu et corrigé, plus éclatant encore, semble se dissoudre en toute légèreté, comme si ses façades se convertissaient progressivement à la transparence… voire à l’immatérialité tout court.
Le modèle de cette virtualité est d’ailleurs assez affirmé par les zones pixellisées, qui font la transition entre le mur et sa disparition vitrée. Bienvenue à l’âge de l’informatique ! Si la rénovation du bâtiment doit certainement peu aux nouveaux outils de conception, la devanture l’affirme pourtant sans détours : à l’heure nouvelle, l’architecture ne pèsera guère plus que les décors toujours renouvelés des jeux vidéo, pour le plus grand plaisir des gamers. Un peu plus, et la dissipation de l’ensemble se poursuivait en un merveilleux nuage de pixels, comme au temps des mémorables réclames pour Bouygues…
Défendant l’idée d’un espace à la fois ouvert et fermé, Winy Maas n’y va pas de main morte : l’ancien centre commercial ressemblait à un bunker. Et il faut bien dire que sur plusieurs de ses faces au moins, absolument closes, l’analogie n’est pas déplacée. C’est une loi du genre : nos chers oripeaux, pour être vraiment appréciés – et vendables – doivent échapper à ce que la lumière externe a de trop variable. Mais la mention du bunker gagne encore en à-propos dès qu’on élargit un peu le regard. A cinquante mètres à peine, l’Auditorium Maurice Ravel présente un des plus beaux fleurons du néo-brutalisme à la française. Un vrai blockhaus celui-ci ! Et de l’autre côté, la Bibliothèque Municipale, juchée sur des piliers de béton brut cyclopéens, n’est pas en reste. Les archives de Géorgie n’ont qu’à bien se tenir. Si l’on y ajoute le parking patibulaire du centre lui-même… Le quartier, convenons-en, est marqué par une certaine violence symbolique. La proposition de MVRDV dans un tel contexte, ne joue pas seulement d’heureux contrastes : elle apporte un véritable soulagement.

Agrandissement : Illustration 2

Est-ce à dire qu’elle échappe à toute violence ? Autant ses voisins semblaient se protéger d’une menace énigmatique, autant elle paraît avoir pris sur elle les puissances de destruction supposées. Car à la vérité, ce sont bien ses propres murs qui se trouvent en proie à leur disparition programmée…
La rénovation du centre commercial de la Part-Dieu a dans l’histoire de l’architecture un modèle évident : la série des magasins BEST dessinée par James Wines et l’agence SITE dans les années soixante-dix. Le plus fameux voyait sa façade comme à moitié effondrée, réduite à un tas de briques. Un autre montrait de larges baies vitrées percées de telle manière qu’elles semblaient de sauvages trouées dans le mur du bâtiment…

Agrandissement : Illustration 3

James Wines était d’ailleurs formel : « La menace d’une apocalypse nucléaire est si omniprésente que la vision de la catastrophe est probablement la seule image universelle de notre temps. » Ses magasins répondaient eux aussi aux bunkers contemporains, qui chantaient sur un autre ton le même cataclysme à venir.

Agrandissement : Illustration 4

Certes, la Guerre Froide n’est plus à l’horizon des projets de MVRDV. Mais c’est là que le scénario se complexifie. L’utopie informatique ne suppose-t-elle pas la dématérialisation de l’architecture ? La disparition possible de tout un ensemble de commerces ? Des librairies, pour commencer, voire des livres ? Des CD aussi bien, des guichets de banque…
L’informatique porte avec elle l’accélération brutale de la destruction créatrice du capitalisme, chère à Schumpeter. Et Lyon le sait bien, qui joue pleinement la carte de la compétition architecturale entre métropoles (ensemble de la zone Confluence, avec Portzamparc, MVRDV, déjà, et Coop Himmelb(l)au pour le Musée qui lui est attaché…). La ville ne s’y engage que pour ne pas être surclassée par ses rivales… laissée à l’agonie sur le nouveau champ de bataille du néo-libéralisme déterritorialisé, désormais sans freins ni limites de vitesse.
Le centre commercial de la Part-Dieu intègre-t-il, au revers de son utopie, les signes de son obsolescence nécessaire, de sa ruine toujours possible ? Economiquement, la stratégie ne serait peut-être pas mauvaise. Car l’on fait difficilement plus vendeur que la contre-utopie. Il suffit de voir le nombre d’entrées de Divergente, ou Hunger Games… Et puis, après tout, qui dit consommation, dit un peu consumation. La petite mort vaut bien la grande.
Autant que la fin de Divergente 2, il faudrait ainsi convoquer Pixels, sorti à la fin de l’année dernière. Les anciens jeux d’arcade, balancés dans l’espace, en reviennent sous forme d’armes de destruction massive. Avec, à la clé, la pixellisation avancée de New York (Bouygues reste loin derrière). Même reprise de la catastrophe dans un scénario ludique, même assomption du gamer comme figure nouvelle de l’apocalypse joyeuse…

Agrandissement : Illustration 5

Pour ce qui de la guerre entre métropoles, on se contentera d’un tweet du maire de Lyon.
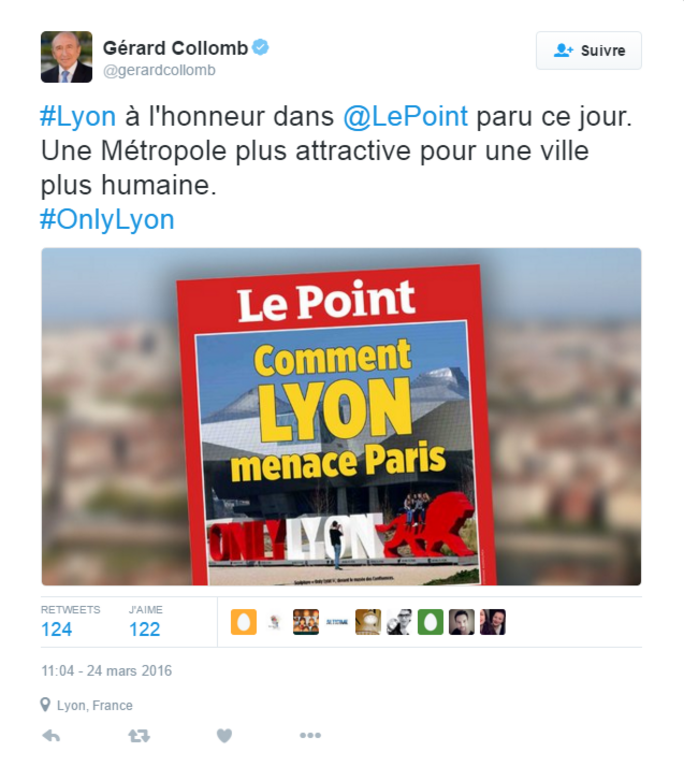
Agrandissement : Illustration 6
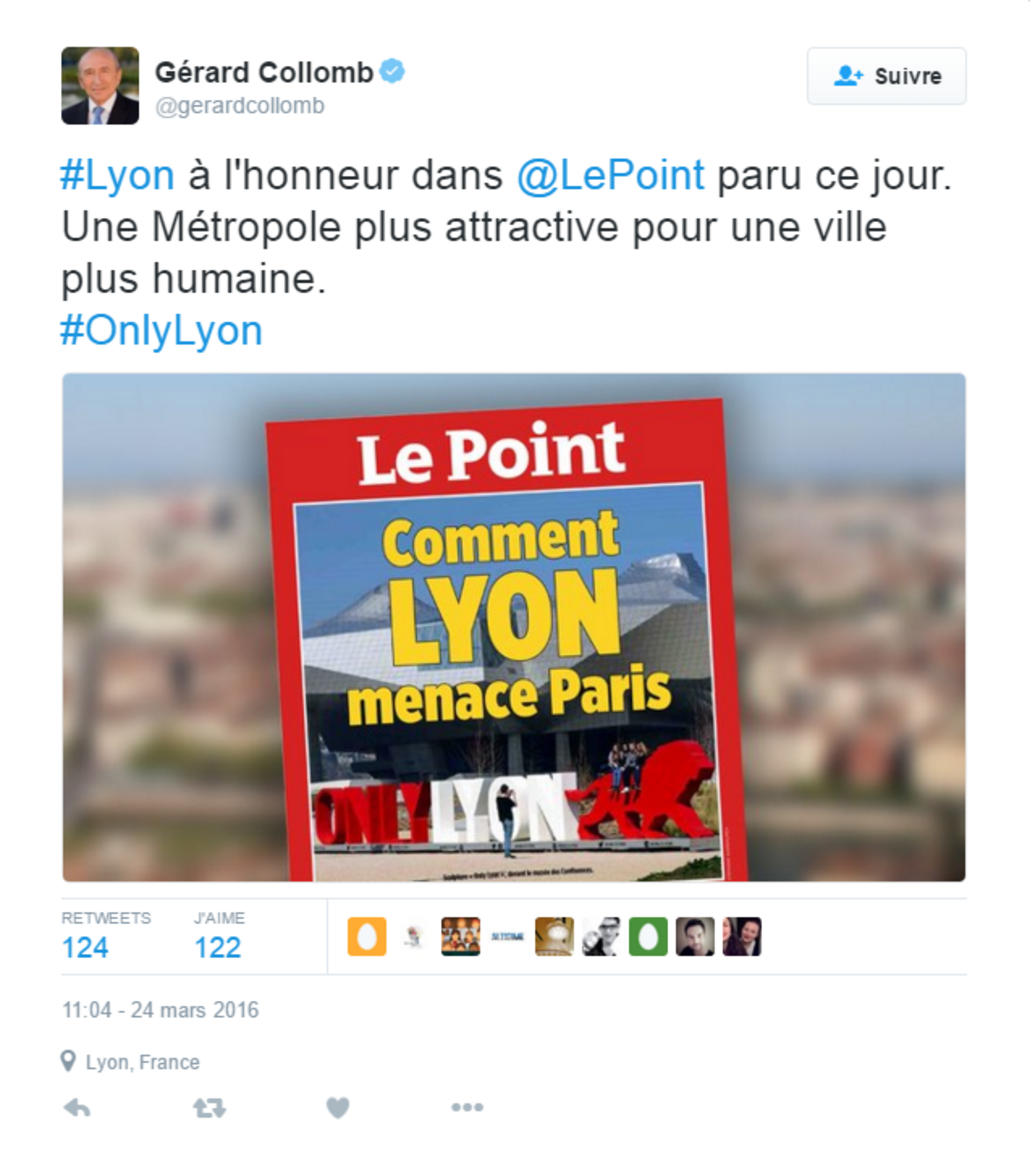
A lire absolument : James Wines, De-architecture, Rizzoli, 1987.



