Si l’ensemble du livre de François Hollande s’apparente à un exercice d’autocélébration assez gênant (lire ici la chronique qu’en a fait Pauline Graulle), un chapitre a particulièrement retenu mon attention. Il s’agit – on s’en doutera – de celui consacré à la social-démocratie, dont j’ai bien conscience qu’il sera plus lu que ma volumineuse thèse récemment publiée chez Dalloz (oui, les chercheurs sont également capables d’autopromotion éhontée).
Tout commence avec une métaphore : « Elle était la reine de l’Europe. Elle a perdu sa couronne ». Et se poursuit par quelques lignes qui perdent d’emblée le lecteur sur la chronologie du phénomène.
On apprend ainsi que les indicateurs étaient au vert au milieu des années 1980 (c’est sans doute pour cela que la littérature sur la « crise » de la social-démocratie a particulièrement fleuri à cette période), et même encore à la fin des années 1990 (au moment où semblait en effet réussir un autre régime social-démocrate que celui des décennies précédentes). Quant à savoir quand les choses ont dérapé, il nous est successivement proposé la révolution reagano-thatchérienne de 1980 (au moment où la social-démocratie avait triomphé, il faut suivre…), puis les attentats du 11 Septembre 2001, et enfin la crise économique de 2008, sans qu’une hiérarchie soit établie.
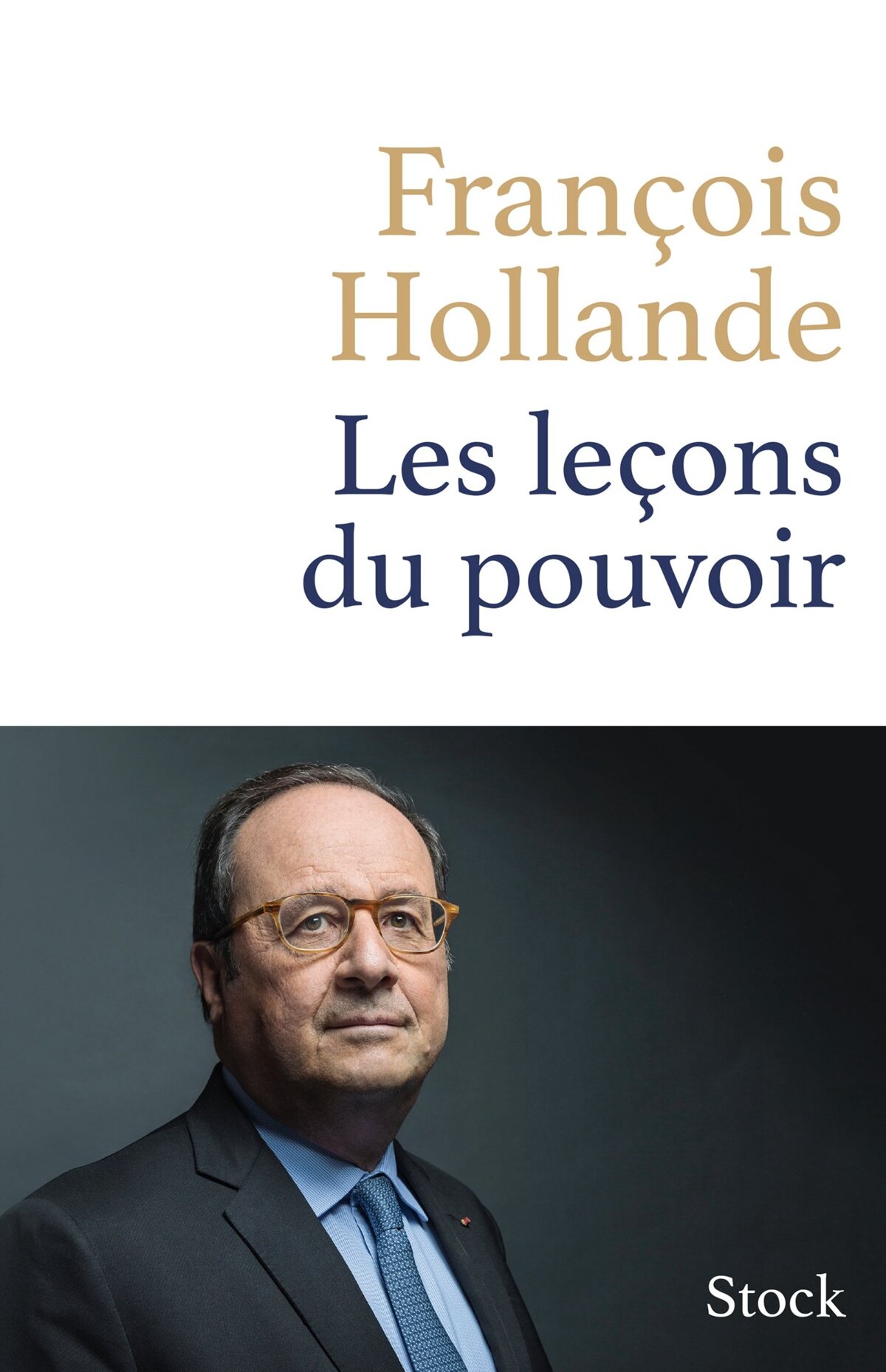
Agrandissement : Illustration 1
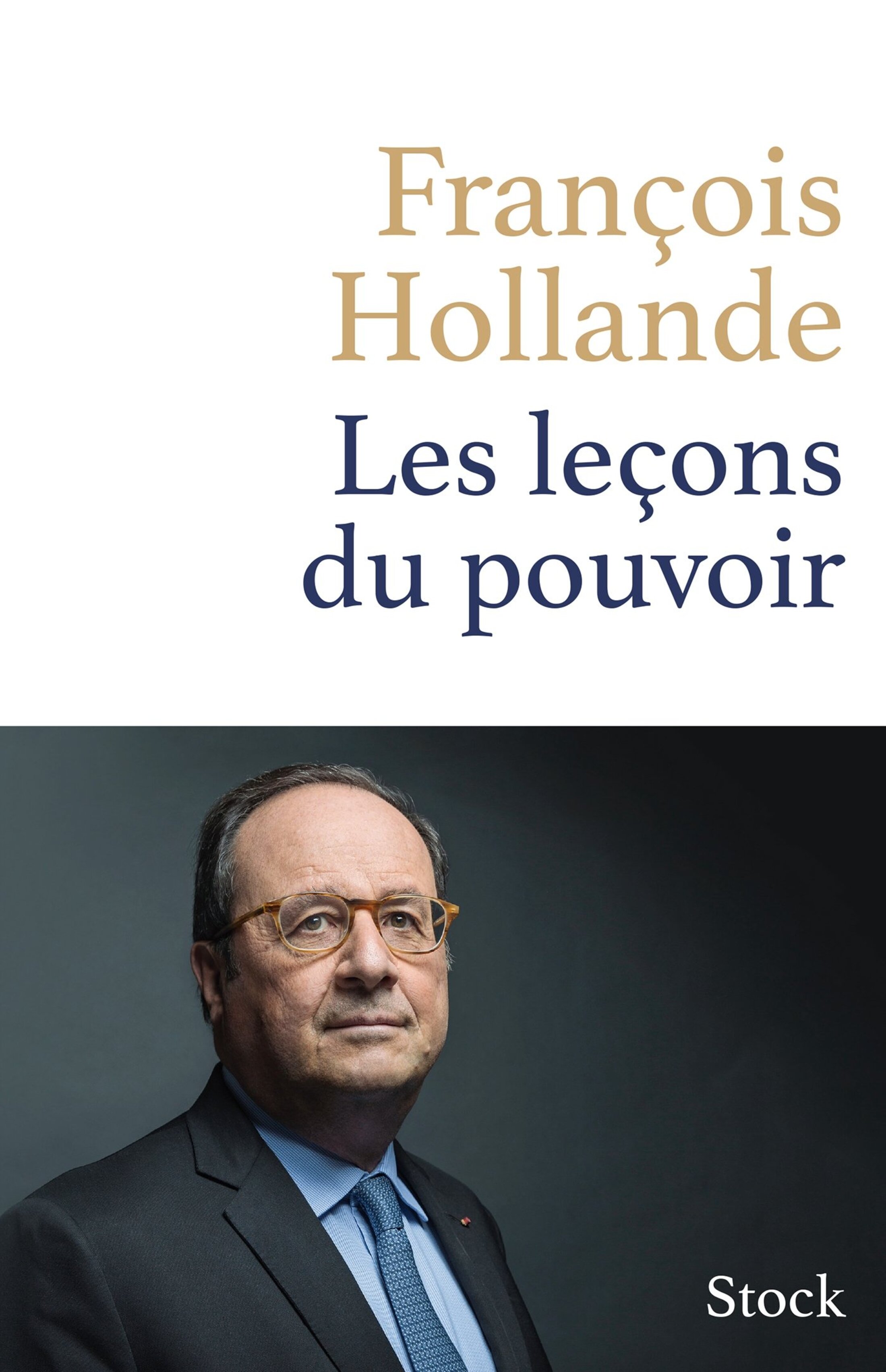
Le credo européen, « whatever it takes »
Le chapitre se poursuit par une série de questions rhétoriques justifiant le choix d’avoir accompagné la globalisation existante. Pour l’ancien président de la République, la seule alternative aurait été d’« arrêter l’horloge du monde ». Il enfonce le clou sur le choix spécifique de l’intégration européenne, dont il estime qu’il est le point de fracture avec la gauche radicale, fustigée pour son manque de crédibilité.
Ici au moins, les choses sont affirmées nettement : « il ne s’agit plus de rêver d’une Europe nouvelle, il faut poursuivre les ambitions de l’ancienne. Il s’agit de savoir s’il faut partir ou rester. Il n’y a plus de demi-mesure. Tout le reste est artifice. On n’est pas à moitié dans l’Union économique et monétaire. On n’est pas un peu ou beaucoup dans Schengen. On est européen ou on ne l’est pas ».
Le problème, c’est que la structuration même de l’Union européenne (UE) va à l’encontre de deux combats jadis au cœur de la force propulsive et de l’originalité de la social-démocratie, à savoir celui pour l’extension des droits civiques dans le cadre de régimes parlementaires pluralistes, et celui pour le plein emploi dans le cadre d’une régulation organisée, non marchande, du rapport salarial.
Il n’y eut bien sûr jamais d’âge d’or. Très tôt, ces combats s’inscrivirent dans des structures stato-nationales et capitalistes qui comportaient leur lot de dominations et d’aliénations (dont les femmes et les peuples colonisés, en particulier, ont pu faire les frais). Cela n’enlève rien au fait que la primauté du marché codifiée par l’UE, et la soustraction croissante de pans entiers de la décision publique aux corps souverains qui la composent, se révèlent en contradiction avec la primauté démocratique du politique que la social-démocratie a incarné pendant quelques décennies.
Il est vrai que la même force politique, sous le poids de facteurs très puissants que nous n’avons pas la place d’évoquer ici, a contribué directement à la mise en place de cette intégration européenne-là, et que ce choix a été cohérent avec les mutations de la social-démocratie dans les espaces nationaux. Repérables dès les années 1980, ces mutations se sont d’ailleurs produites également en dehors de l’UE, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Pour autant, depuis la crise de 2008, les sociaux-démocrates connaissent de telles déconvenues qu’une nouvelle réinvention est requise s’ils veulent échapper à l’obsolescence. Au milieu du déclin voire de l’effondrement de certains partis, de nouvelles opportunités se dessinent ou doivent être suscitées. Certains le tentent en cherchant à préserver leur ancrage à gauche. C’est le cas de Corbyn dans un Royaume-Uni ayant choisi de quitter l’UE, et l’on a dit ici que Paul Magnette s’y essayait dans une optique de démocratisation de l'UE.
La social-démocratie, entre dame patronnesse et piétaille du combat contre « les » populismes
François Hollande ne se situe pas sur ce terrain. Ses propos témoignent en effet d’une imprégnation totale des principes néolibéraux. Selon lui, Tsipras a « sauvé son pays » et le centre-gauche a eu raison de « redresser et de moderniser » en Allemagne (lire « sous Schröder »), en Italie (lire « sous Prodi, puis Renzi ») et en France (guess who ?). Bien qu’il assimile socialisme et social-démocratie, Hollande ne définit cette dernière que par la tâche d’« humanisation » qu’elle est censée accomplir.
Avec son style patelin, Hollande réinvente donc la social-démocratie en dame patronnesse, ne cherchant surtout pas à altérer les structures politiques et productives d’un ordre social façonné par d’autres (ou tombé du ciel par la force mystérieuse d’une « Histoire » dont il ne faudrait surtout pas sortir).
À la limite, il y aurait une cohérence à vouloir se faire sa place parmi les élites dirigeantes d’une globalisation pour laquelle il reste tout de même à reproduire un consentement électoral suffisant (du moins tant que l’universalité du droit de suffrage n’est pas remise en cause). Sauf que François Hollande n’explique jamais par quelle voie stratégique cela serait possible, alors que d’autres y parviennent mieux que la social-démocratie pour l’instant, qu’il s’agisse des macronistes en France ou de droites diverses au Benelux et dans l’espace germanophone. Tout juste égrène-t-il quelques mesures technocratiques et des balancements rhétoriques usés jusqu’à la corde (l’efficacité mais la justice, l’écologie mais la croissance, etc).
Ne traçant guère d’esquisse de « reconnexion » à un socle électoral assez large pour rester une grande alternative gouvernementale, l’ancien président de la République lance finalement un appel convenu à lutter contre « les populismes » – le pluriel servant à amalgamer tranquillement droite nativiste et gauche radicale, tout en témoignant d’une solidarité intacte avec des forces supérieures ne partageant aucunement les objectifs traditionnels et historiques des sociaux-démocrates. D’où, pour les moins malins d’entre eux, une perspective assez peu radieuse de piétaille subalterne, en défense jusqu’au-boutiste du « projet européen ». Dans un article récent sur les votes du Parlement européen, Jean Quatremer ne parle-t-il pas d’« armée de réserve des conservateurs » ?
Il paraît que François Hollande a rédigé ce chapitre sur la social-démocratie « d'une traite dans l'avion ». Cela se voit. En guise de réflexion sur l’état et les reconfigurations envisageables de la social-démocratie, il prétend perpétuer les « valeurs » de cette dernière tout en liquidant son originalité (ou en acceptant benoîtement des cadres institutionnels qui empêchent la réinvention de cette originalité). Une incohérence à mettre en regard avec la capacité qu’a eu Macron d’agglomérer les groupes sociaux et les cadres politiques correspondant à son projet. Lui est président, l’autre ne l’est plus.



