Une histoire du bricolage budgétaire
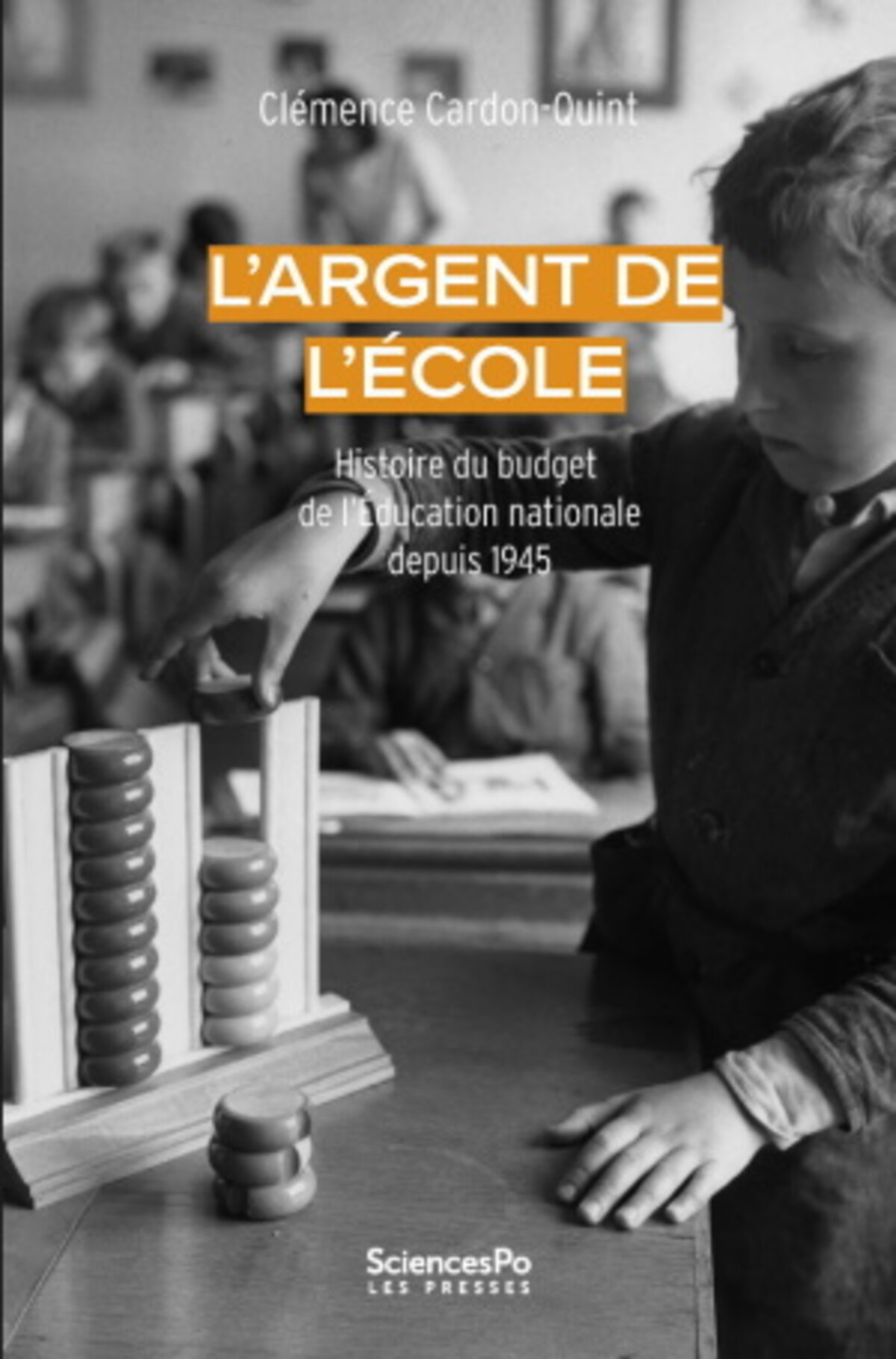
"La rue de Grenelle commence et se termine à Bercy". Clémence Cardon-Quint restitue la part de vérité et d'erreur dans cet adage. "L'argent de l'école" (Sciences Po Presses) n'est pas une histoire économique de l'éducation en France. Ce livre "examine la fabrique du budget de l'Education nationale des prodromes de l'explosion scolaire jusqu'au milieu des années 1980". Il le fait de façon extrêmement précise. Si l'ouvrage s'appuie beaucoup sur les traces des négociations entre le 1er ministre et son directeur du budget et les directions du ministère de l'éducation nationale, notamment celle du budget, il montre aussi le rôle d'autres acteurs (les syndicats par exemple) et du contexte socio-économique, comme la démographie. Un épilogue éclaire les années suivantes jusqu'aux décisions de G. Attal.
L'histoire du budget de l'Education nationale est aussi celle du progrès technique et ses limites dans la gestion budgétaire. On se rappelle l'échec récent de Sirhen, le logiciel qui devait permettre de maitriser la paye des agents de l'E.N. et qui se solda par un trou de 400 millions. Le projet est aujourd'hui abandonné. Et la gestion des heures supplémentaires et du glissement vieillesse technicité apporte encore son lot de surprises au ministère. Il faut savoir cela pour apprécier la capacité de l'Education nationale à gérer ses déficits, comme ce trou d'un milliard en 2024. Alors, apprécions la remarque un peu nostalgique de C Cardon-Quint : "ce que les Finances gagnent en visibilité, l'éducation nationale le perd en souplesse"...
Des éclairages sur l'histoire de l'Ecole
C. Cardon-Quint montre que "pour repérer les postes de dépense qui ont, à un moment donné, représenté de véritables priorités pour le gouvernement, il est vain de raisonner à partir des données comptables... L'entrée matérielle dans la fabrique budgétaire offre une voie plus laborieuse, mais plus sûre pour identifier de véritables priorités". Ce sont des moments clés de l'histoire de l'école que l'on revit dans l'ouvrage à travers témoignages et documents des différents acteurs. Pour en citer quelques uns : la loi Debré, la revalorisation de 1961 (un mauvais souvenir pour le Budget par suite du "tourbillon" qu'elle a lancé), la réforme Haby, la loi Guermeur, les revalorisations Mitterrand et Jospin, la décentralisation et même le plan Informatique pour Tous.
L'apport historiographique de l'ouvrage est très important. On comprend mieux la loi Debré quand on sait qu'elle permet de faire face à l'explosion démographique en réduisant les investissements de l'Etat tout en contenant le privé au "besoin constaté". On interprète mieux la décentralisation mitterrandienne quand on sait qu'elle prolonge un projet lancé sous Giscard par C. Beullac en en réduisant la portée... et le financement. Alors que G Attal enterre le collège unique, C Cardon-Quint montre comment la réforme Haby a été sabotée dès le départ par la direction du Budget. Elle dévoile le financement original du Plan Informatique pour Tous (location-bail sur crédits des PTT !), trace d'une réforme éducative largement inspirée par des préoccupations d'emploi et de développement industriel. Impossible ici de revenir davantage sur ces 40 années de gestion de l'Ecole. Intéressons nous aux idées forces qui se dégagent de l'ouvrage et qui permettent de mieux saisir l'Ecole actuelle.
Le budget un choix moral et politique
Qui fabrique le budget de l'Education nationale ? D'abord des forces de fond. "La discipline reine des planificateurs reste la démographie", note C. Cardon-Quint. En période de croissance démographique, le gouvernement est obligé d'investir dans l'éducation et le budget monte. Il le fait en s'étirant par étapes plus ou moins longues. En période de baisse démographique, la décrue s'installe et même s'anticipe. C'est ce que nous vivons en ce moment.
Mais le choix d'investir en éducation est aussi moral et politique. Jusqu'au milieu des années 1960, s'installe la croyance dans le fait que l'éducation est un investissement pour l'économie, rentable à échéance. L'idée ne fait plus aujourd'hui recette. Le coût de l'éducation reste un choix politique. Il est largement dépendant des priorités et des arbitrages du pouvoir politique, des rivalités politiques, des élections à gagner. Ainsi la loi Guermeur apparait pour pousser la gauche à se déclarer contre le privé avant des législatives. La revalorisation Jospin vise à gagner les élections de 1988. C'est hors période de l'ouvrage, mais les 60 000 postes de F. Hollande en 2012 s'inscrivaient aussi dans la même problématique.
Croissance et doxa économique
Peut-on s'en tenir au politique ? Non. C. Cardon-Quint montre le poids de la croissance économique sur le financement de l'éducation. "L'expansion du système de formation a puisé ses racines dans l'activité des entreprises, les progrès de la productivité... Le tempo des mutations du système éducatif s'est donc aligné sur celui de la croissance économique". Ce n'est pas la même chose d'avoir une école qui absorbe 6.5% du PIB quand le PIB augmente ou quand il stagne. On en sait quelque chose actuellement.
La doxa économique joue aussi son rôle. A partir du milieu des années 1960, la règle devient la stabilisation du poids de l'Etat dans l'économie. Et les modèles économétriques renforcent cela. C. Cardon-Quint souligne le rôle de l'OCDE dans la diffusion de ces modèles. La comparaison internationale pousse toujours la dépense éducative vers le bas. "A défaut de pouvoir modéliser les retombées éventuelles sur la croissance des investissements collectifs, les planificateurs se retrouvent prisonniers de scénarios dans lesquels les dépenses sociales plombent l'économie", écrit C. Cardon-Quint. Cela réduit aussi le débat politique à des questions rituelles (quelques postes) pour un sujet beaucoup plus vaste et qui mérite mieux.
Même les travaux de recherche économique amènent à des politiques à moyens constants ou inférieurs. C. Cardon-Quint donne en exemple la réduction du redoublement qui se traduit par des suppressions de postes en douce. Les dédoublements, annoncés par les travaux de Valdenaire et Piketty, ne sont effectués que parce qu'ils ne coutent rien (ils sont financés par redéploiement de postes). Si les difficultés de recrutement (une constante dans l'enseignement) poussent à des revalorisations, depuis les années 2000 celles-ci sont toujours annulées par la baisse continue en valeur réelle du point Fonction publique. L'exemple récent de la revalorisation Blanquer laisse un souvenir amer aux enseignants. L'augmentation des rémunérations ne se fait plus que par des primes. C'est encore le cas avec le Pacte. Quand lui-même n'est pas gelé... Les primes poussent à penser la réforme du métier enseignant. La tentation existe depuis longtemps au gouvernement de jouer sur le temps enseignant pour dégager de nouvelles économies. Ainsi le débat sur la durée des vacances n'a rien d'une nouveauté. On le voit régulièrement émerger pour gagner du temps de travail gratuitement.
C. Cardon-Quint pose la question essentielle. Celle de l'adéquation des moyens et des fins en éducation. "Le mythe de la réforme décidée au sommet de l'Etat est encore vif en France, tout comme celui de l'autonomie des établissements", écrit-elle. "Deux niveaux d'action bien peu adaptés au changement durable d'une réalité aussi complexe, a fortiori sous forte contrainte budgétaire". Finalement, cette histoire budgétaire nous fait regretter les années difficiles où les espoirs alimentaient un débat de fond sur l'Ecole.
François Jarraud
C. Cardon-Quint, L'argent de l'école. Histoire du budget de l'Education nationale depuis 1945. Les Presses de Sciences Po, 485 pages, ISBN 978-2-7246-4270-4, 26€.



