Effluves de la pauvreté. Ivresse des profondeurs. Les majuscules de convention ont sauté (Orcel et les conventions...); chaque chapitre, sans titre ni numéro, est une longue phrase unique entrecoupée de virgules-alliées (la suffocation du lecteur n’étant pas un but en soi); les mots mordent, torturés, affluent à la vitesse des idées, s’enlaçant furieux, s’entrechoquant tels les souvenirs qui remontent - vipères folles, belliqueuses, sensuelles - et les soliloques intérieurs des personnages d’être ainsi saisis sur le vif, attrapés en pleine montée puis balancés à la face du lecteur, déchargés plutôt.
« il pleuvait des hallebardes ce vendredi de mai quand on avait baisé dans les latrines, repaire de tout ce qui n’est plus de la priorité humaine, qui se vide de son utilité, de son rayonnement »
Une séance d’onanisme dans les latrines de ce bidonville de Port-au-Prince et le second roman de Makenzy Orcel d’afficher d’emblée la couleur. Se soulager, se vider enfin. De tout ce que le corps peut produire, sons, matières et pensées trop pesantes. Ainsi cette mère-baobab, séant posé, qui raconte tous les jours à voix haute ses cauchemars à Madam Victò, génie des latrines (« on dit qu’elle aurait le pouvoir d’empêcher ce qu’on a vu la nuit en rêve d’influencer la réalité, de le changer en faveur du rêveur »). Expulser les trop-pleins explosifs et savoir en rire, oh oui!, savoir en rire ! Car les occasions ne sont pas nombreuses, ici. Ici dans les bas-fonds de la cité.

Agrandissement : Illustration 1

« quartier en patchwork, quartier chute, de toutes les déchéances, veine ouverte, en convalescence, enchevêtrement de souffles de corps de corridors de tout, quartier du temps qui s’écroule, du temps suspendu à ces visages nocturnes, balafrés par les larmes, ces cases qui sont debout malgré les bourrasques du temps et l’effritement, la peur, l’incertain »
Sous la surveillance des radoteurs de la place d’Armes (faiseurs et briseurs de réputations), les habitants de ce quartier abandonné à ses excréments, livré à ses rats-violeurs, à ses nuisibles-pédophiles, destructeurs des corps et assassins des âmes, y survivent. L’espoir ? Il semble privatisé, inatteignable. Ils n’ont pas de noms, ces habitants. Parfois le lecteur s’y perd. Puis les identifie à nouveau, les reconnaît, eux dont l’histoire est déroulée par vagues puissantes, portée haut par les mots pourtant crus de l’écrivain. Oui crus, car l’urgence est là, il ne semble même rester que cette urgence sur cette île damnée; impression d’éruption imminente, charnelle, organique telle une vessie prête à éclater, il n’y a pas le choix pas le temps de se tortiller avec les mots, de flirter avec la préciosité : tout va péter, pour sûr ! Bientôt, oui, tout va péter. Mais quand ? Le pathos est avalé tel un étron emporté par la puissance du jet, le style poétique, souffle nerveux fou, colère maîtrisée et incensurable de l’auteur face aux injustices répétées ne laisse guère le temps de s’apitoyer. Pour survivre il faut se libérer du trop-plein intérieur qui sinon fera exploser tripes et cervelle. ‘Les Latrines’ ne sont pas pour autant un simple exercice de style. Plutôt le portrait d’un quartier, d’une ville, d’un pays au bord de l’asphyxie. Le lecteur devient cette stripteaseuse la nuit qui s’occupe le jour de torcher la vieille dame (il faut bien payer les factures. Si tu ne payes pas tu deviens moins qu’un chien). Il est sa petite-fille qui n’a pas le temps; Madame, elle ne se salit pas les mains, Madame ne songe qu’aux chiffres. Et au silence. Un chapitre plus loin il se métamorphose, le lecteur, en poète à dread-locks qui n’en est pas vraiment un venu soulager la libido de la riche bourgeoise des hauteurs, chibre noir-objet vite renvoyé à ses latrines puantes. Ils sont une dizaine à dériver ainsi, à esquiver les balles perdues, à se consumer, se croisant parfois mais ne communiquant jamais. Furtivement, si parfois, un temps vite chassé. Ainsi cette scène inattendue et bouleversante entre deux prisonniers (qui n’est pas sans évoquer ‘Le secret de Brokeback Moutain’ d’Ang Lee dans le traitement des non-dits). Comme si l’amour ne pouvait qu’être une chimère aux pieds des latrines et la tristesse la seule valeur certaine. Le séisme de 2010, la dictature Duvalier, l’insécurité maîtresse des rues; l’omniprésence des ONG qui n’aide pas un état à se renforcer au contraire, la corruption dudit pouvoir : tout est mis sur la table, décors effarants qui ne voleront pas la lumière pour autant, pas cette fois, pas ici aux personnages, à leurs identités bouleversées. Les cuisses des femmes violemment écartées, les crânes explosés à coups de rafales sous les yeux gourmands des radoteurs de la place d’Armes et Orcel de se saisir des doutes des survivants-guerriers, de les rappeler universels, au-delà du cadre de l’île des Caraïbes. Amour maternel, manque du père absent/défaillant, tentation de la fin mais aussi de saisir tout ce qui fait l'humain : les ventres sont ouverts et la littérature de s’engouffrer; « seul le couteau sait le secret de l’igname » et Orcel de poser les thèmes récurrents de son œuvre.

Agrandissement : Illustration 2

Ici un extrait de ce récit habité qui permet de se faire une idée de la puissance évocatrice et poétique* de ces ‘Latrines’ qui débordent.
« je continue à être seule avec moi-même, avec le monde que je me crée où chaque vie est une kyrielle de pirogues en papier jetées à la mer, à me poser les mêmes questions pour avoir les mêmes réponses, arriver à la même conclusion à chaque fois, partir est tout ce qui me reste, je ne sais pas, je ne sais plus, tout ce que je sais moi c’est qu’une maison sans enfant, sans livres est une maison vide, c’est que le chien est humainement l’animal le plus généreux, le plus parfait, c’est que quand le haut patronat se réunit chez Madame, quand elle reçoit ses amis qui ne viennent que rarement lui faire honneur en l’aidant à manger ses saucisses, à bouffer ses fromages et à vider ses bouteilles de vin qui, leur disait-elle, aurait le même âge que, je n’ai pas entendu la suite de la phrase, je ne dois pas être là, faut surtout pas que ces pets prétentieux, ces xénophobes, ces racistes, ces péteux de collègues de travail voient qu’elle a donné à sa grand-mère une négresse pour chienne, faut s’esquiver dans son coin, dans le noir, tu vois ce que je veux dire, ici les gens sont supérieurs parce qu’ils sont riches, ne fréquentent, ne mangent pas les mêmes choses sur les mêmes tables dans les mêmes restaurants que des gens comme moi, les gens comme moi ils n’ont qu’à se barrer, se charger de leur croix tout seuls, moi la mienne consiste à amener aux toilettes la grand-mère de Madame et la torcher après, aussi lui donner à manger, faire la lecture, chanter des stupides chansons à l’eau de rose pour qu’elle s’endorme à poings fermés, chanter même si j’en ai pas envie, c’est le boulot, sans ça je ne pourrai pas payer les factures, et les factures non payées ça veut carrément dire qu’on est dans la merde, dans tout ce qui est mauvais, je dois m’assurer qu’elle fait caca trois fois par jour, les gens quand ils deviennent vieux ils vont souvent aux toilettes, je ne me rappelle plus où j’ai lu ça, ou si c’est Madame qui me l’a dit, en un mot être à même de faire croire à cette carcasse humaine qu’elle avait encore du temps devant elle à vivre, qu’il n’y avait pas mieux dans une autre vie que ce qu’elle était en train de vivre là maintenant, et qu’elle avait intérêt à s’y accrocher, en profiter au maximum, oui Madame, c’est très clair Madame, même trop clair, espèce de pute, comment oses-tu me demander ça, de quel droit, trouves-tu que tu me paies assez pour me demander ce que tu veux ou quoi, c’est quoi ce bordel, cette tendance qui porte une personne à croire qu’elle a le droit de prendre une autre pour la plus conne du monde parce qu’elle est devenue vieille et ne peut pas s’occuper d’elle-même toute seule, oui Madame, c’est très clair Madame, même trop clair, salope, as-tu oublié que cette femme t’a bercée, dorlotée, aimée, changé de couches, veillé sur ton sommeil et tout, quand tes parents étaient en voyage ou je ne sais quoi, comme si tu étais sortie de son propre ventre, oui elle m’a tout raconté, sans elle tu ne serais sans doute pas devenue celle que tu es aujourd’hui, cette petite prétentieuse qui se croit au-dessus de tout, excuse-moi, je ne suis pas en train de te faire la leçon, s’il fallait quelqu’un pour lui faire sentir qu’elle compte aujourd’hui, ça devait être toi, personne d’autre, c’est très clair Madame, comment arriver à enfoncer ça dans la tête de quelqu’un, en plus une vieille femme de quatre-vingt-dix ans qui a tant vu et tant vécu, qui aurait pu m’asseoir sur ses genoux et m’enseigner bien des choses de la vie, combien de fois pense-t-elle à se faire euthanasier ou je ne sais quoi, comme bien d’autres l’ont déjà fait dans les familles de certains de tes collègues de travail, elle ne l’a pas fait en dépit de son grand affaiblissement et sa fatigue, c’est clair Madame, ta grand-mère est la femme la plus courageuse que j’aie jamais connue. »
« il pleuvait des hallebardes ce vendredi de mai »
Les hallebardes, ces armes pensées pour percer les armures.
‘Les Latrines’ - Makenzy Orcel - ed. Mémoire d’Encrier (2011)
[— Makenzy Orcel a dernièrement publié ‘Maître-Minuit’ aux éditions Zulma et ‘Une boîte de nuit à Calcutta’, avec Nicolas Idier, aux éditions Robert Laffont —]
*un écrivain à Haïti ne pouvant qu'être poète, pour se familiariser avec la poésie haïtienne, vivier créatif en ébullition, acte de résistance lumineux et en complément de l’œuvre de Makenzy Orcel : voir aussi la pertinente ‘Anthologie de la poésie haïtienne contemporaine’ sous la direction de James Noël (ed. Points)
*voir également 'Makenzy Orcel, fils d’Haïti : la plume dans les plaies. Etude d'une oeuvre de feu'
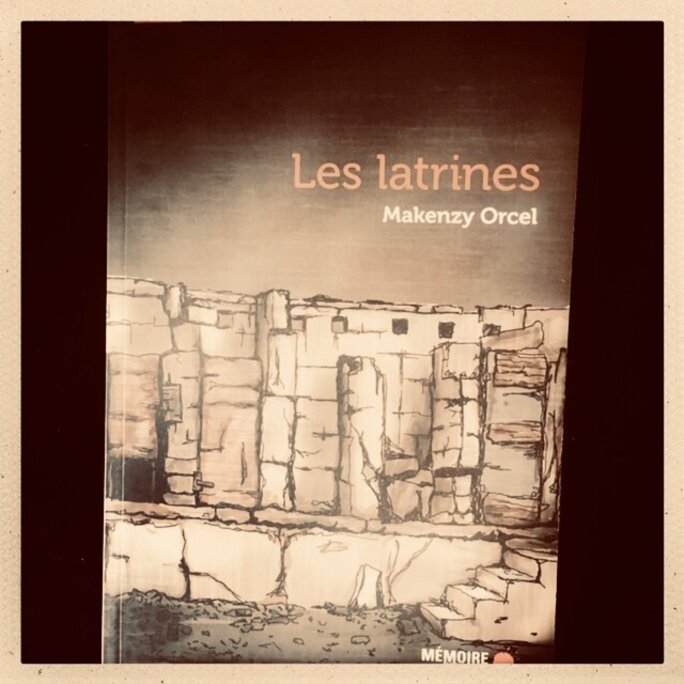
Agrandissement : Illustration 3




