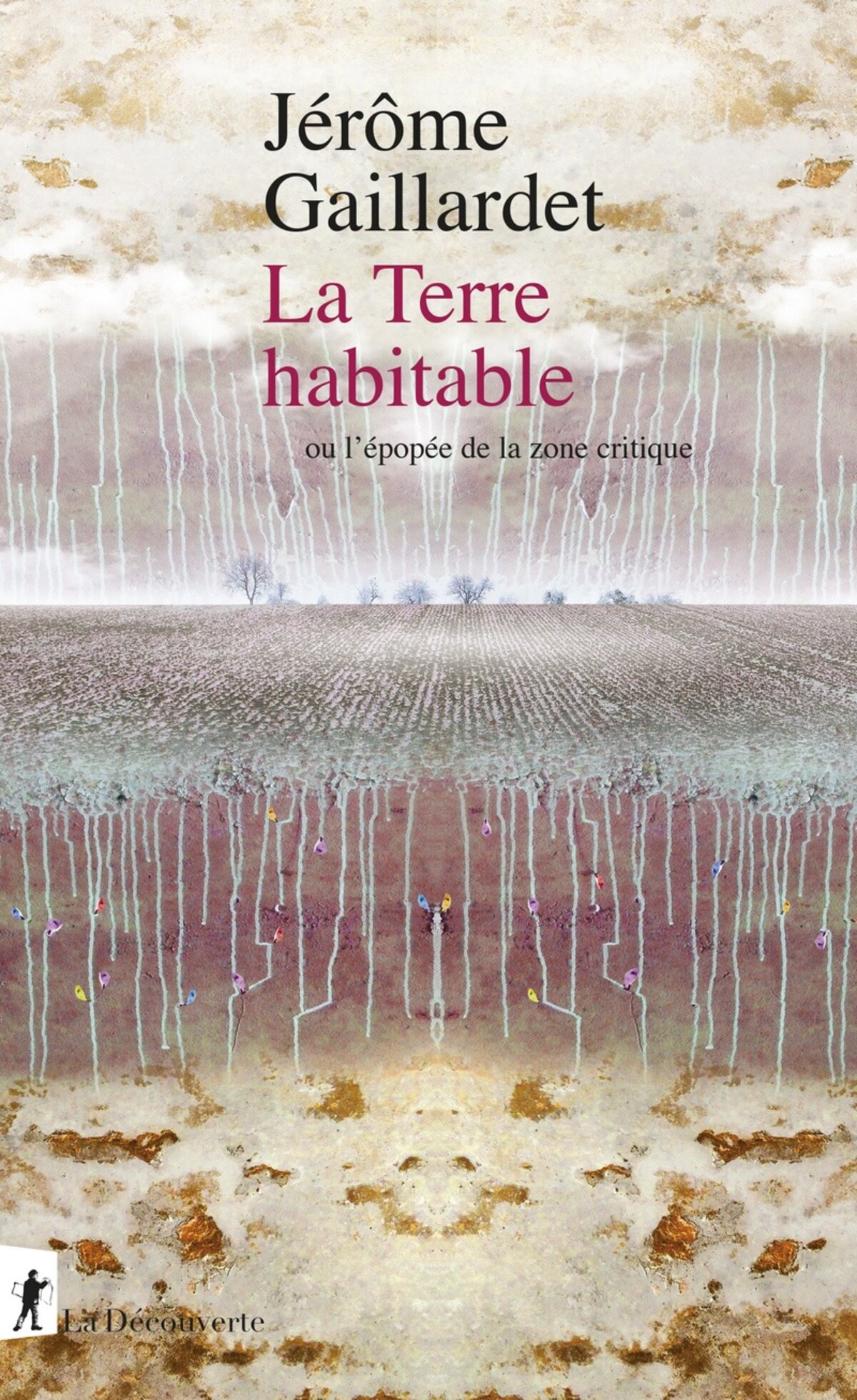
Agrandissement : Illustration 1
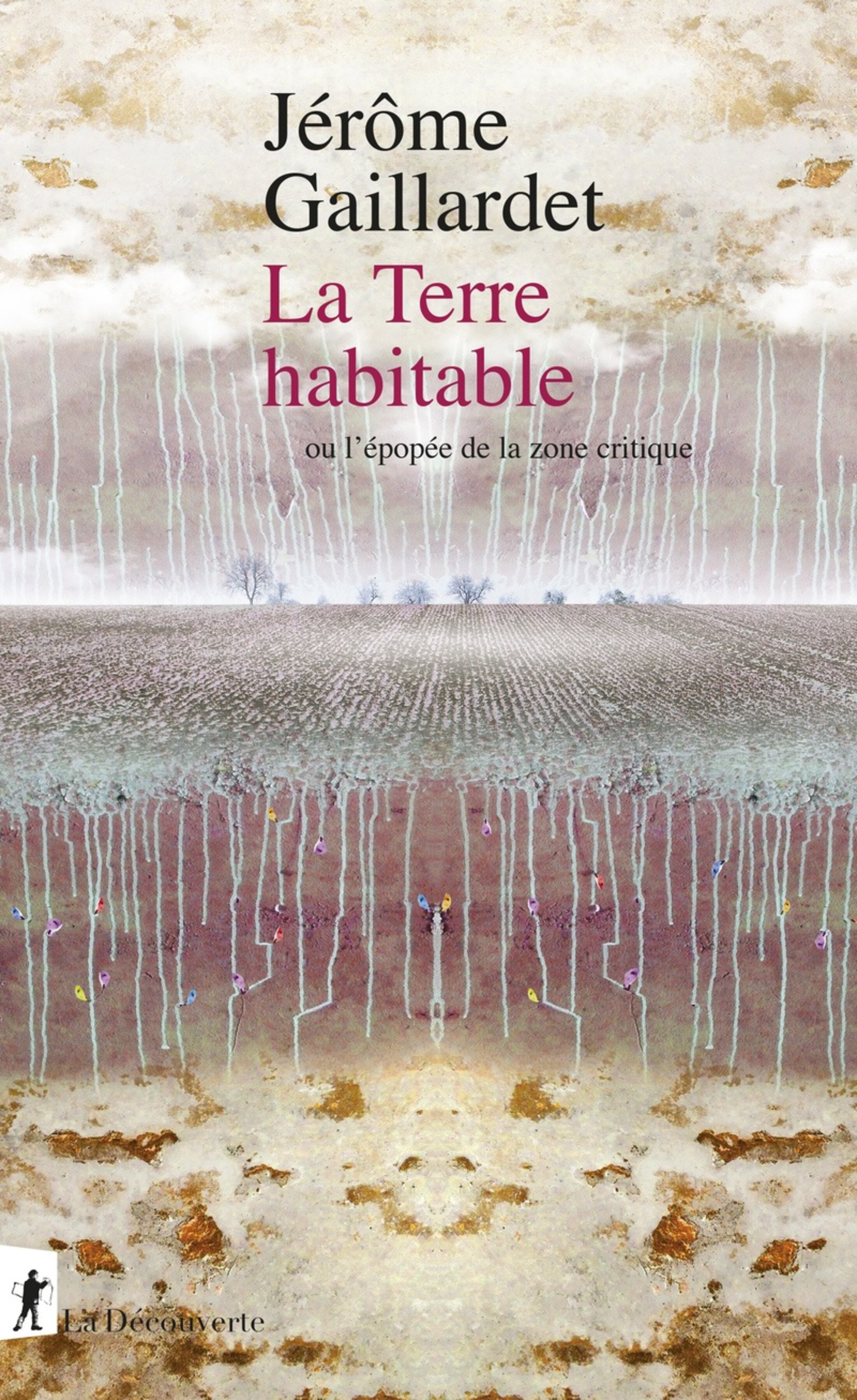
Ils sont nombreux à pouvoir répondre à la question pour tenter de conjurer le pire mais bien peu sont entendus. Bruno Latour (1947-2022) a lancé dans le grand bain du débat public toute une cohorte de philosophes, architectes, scénaristes et un seul scientifique (sauf erreur), le géochimiste Jérôme Gaillardet, de l’Institut de physique du globe de Paris et coordonnateur de réseaux de recherches au CNRS. On a pu le convaincre de publier le récit de son travail de chercheur et une profession de foi sur ce que nous pouvons pour faire. Son livre, brillant, poétique et parfois philosophique, est un ovni.
Faire parler les montagnes et les fleuves
Nous entrons dans la vie de Gaillardet par celle d’un géologue, aujourd’hui inconnu même si son nom est inscrit avec celui des savants de son époque sur la Tour Eiffel : Jacques-Joseph Ebelmen (1814-1852). Ce polytechnicien parvient à deviner ce qu’on appelle aujourd’hui le cycle géologique du carbone. Visionnaire ! Voici une entrée pour rappeler que notre géochimiste et son équipe sur l’Amazone vont pouvoir « faire parler les fleuves ». Avec une thèse sur les isotopes du bore, pister les traceurs chimiques de l’eau, pour Gaillardet, c’est un jeu d’enfant. À l’échelle du bassin-versant amazonien d’une taille équivalente à quatorze fois la France, la chose demande de la méthode. Il faut un « espion », le néodyme, et des « témoins », les sédiments (et les poussières) dont la « faconde géochimique parlera des montagnes régulatrices, des vivants sacrifiés, des calciums libérés pour que l’habitabilité de Terre puisse se maintenir ». Car aujourd’hui, on mesure aussi l’intensité de la consommation de gaz carbonique par les roches. « La montagne est un immense laboratoire naturel où toutes les forces physiques et chimiques sont à l’œuvre, se servant, pour accomplir leur travail de cet agent souverain que l’homme n’a pas à sa disposition : le temps », écrivait déjà le géographe Élisée Reclus en 1881.
"Les roches respirent"
Le temps, le voici qui donne l’occasion à Jérôme Gaillardet de présenter la cinétique des réactions chimiques, autrement dit la vitesse à laquelle elles se produisent. A quelle vitesse se dissolvent les minéraux ? Moins d’un an pour le calcaire, près de 80 millions d’années pour un quartz. Entre en scène l’énergie dont les usages des 8 milliards de Terriens sont phénoménaux : 600 milliards de milliards de joules, par an. Sa présentation passe par un récit de missions scientifiques sur l’île de la Réunion qui lui permet d’illustrer un combat entre Hadès (le manteau de la Terre) et Hélios (le soleil). A Hélios, nous devons la chaleur et la pluie, à Hadès, les continents, le relief, l’atmosphère, le carbone, brique élémentaire de la vie. Mais plus encore, les roches maintiennent l'air respirable en s'exposant à l'eau de pluie (acide, car chargée en gaz carbonique) lesquelles s'altèrent devenant des calcaires dans les océans. Lesquels sont du carbone craché par les volcans dans l'atmosphère. Jérôme Gaillardet explique qu'une "fuite" dans ce cycle a donné une possibilité à la vie qui naît d'un cycle secondaire entre animaux et végétaux, laquelle travaille à son tour les roches, fabrique de l'humus... "Des boucles se forment dans les boucles, ainsi va la Terre" conclut Patrice Maniglier.
Zone critique
Lorsque le géochimiste parle poétiquement de la « chorégraphie de l’habitabilité » de la Terre, il rejoint la physicienne, spécialiste des turbulences, Bérengère Dubrulle théorisant son modèle de formation des planètes[1]. Cette scientifique exploite aujourd’hui son expertise ès tourbillons en géophysique, pour mieux comprendre les caprices de l’atmosphère et l’impact des activités humaines sur le climat. Mais Gaillardet, géologue de formation, ausculte tous les acteurs du « théâtre imaginaire » d’Hélios et d’Hadès qui engendrent un « monde symbiotique nouveau, destiné à pérenniser l’activité des vivants ». Refaisant l’histoire du concept de « zone critique », il rappelle que cette pellicule externe de la planète Terre qui va de la haute atmosphère jusqu'aux roches non altérées sous nos pieds, est le siège d’interactions chimiques entre l’air, l’eau et les roches. Ce un milieu poreux où les minéraux se transforment au contact de l’oxygène, du CO2 et de l’eau est le siège de la vie et l’habitat de l’espèce humaine. Elle est donc critique au sens physique du terme car c’est une des interfaces de la planète mais aussi car c’est là que nous cultivons, c’est là que se forme et évolue la ressource en eau et en sol, et c’est là que nous stockons nos déchets. Notre géochimiste démonte les machines thermiques « enchaînées qui décrivent des cycles », telles ces boucles de l’eau, de l’azote, du carbone (grands et petits cycles). Il décrit comment la compréhension des temps de résidence de l’eau, du carbone, etc., peut permettre d’« atterrir ». Mais où, quand on est à la recherche de Gaïa, quand on se demande « que fait la vie ? » alors que les bactéries vaquent sans plan préconçu comme aime le décrire l’astrophysicien Jean-Pierre Luminet : « Prenez une colonie de bactéries quelconques, laissez-la s’ébattre au soleil, et quand vous reviendrez quelques centaines de millions d’années plus tard, vous pourrez admirer des baobabs, des mousses, des mangues, des coléoptères, des hirondelles, des tyrannosaures ou des ruminants, selon le temps et les ressources locales disponibles ».[2]
De l'écologie à la biogéologie
Lorsque Gaillardet explore la Terre par ses mécanismes en boucle, il livre aussi, plus intimement, ce que lui inspire son travail scientifique, il voudrait qu’on comprenne que nous ne vivons plus sur la Terre mais en elle : « Nous vivons dans les interstices, les plis de cet affrontement entre David (la Terre rocheuse) et Goliath (le Soleil) qui crée la seule mince couche habitable ». L’écologie définie par Haeckel en 1866 ne dit rien des turbulences déréglées au milieu desquelles nous sommes ballotés. S’il n’y a plus d’infini, nous sommes alors logés dans un espace transformé et mouvant, animé par l’écoulement de l’eau, des gaz, des polluants. Il faut alors imaginer de nouvelles cartes frontières entre humains et la Terre habitable, un nouveau theatrum mundi comme Alexandra Arènes, Axelle Grégoire et Frédérique Aït-Touati les ont imaginées dans Terra Forma[3]. Il faut marteler que la force géologique des humains va croissant : en 2020 « la masse des infrastructures humaines (ciments, graviers, sables, asphalte, briques, métaux, plastiques) a atteint la masse de l’ensemble des êtres vivants logés dans la partie habitable de la Terre, et cette quantité croît au rythme vertigineux de 29 milliards de tonnes par an. » Un apport à la zone critique représentant annuellement trois fois ce que les volcans crachent de lave et presque deux fois ce que l’ensemble des fleuves apportent de matière dans l’océan. Du côté du vivant, un million d’espèces sur les 8 à 10 millions sur la planète sont en voie d’extinction. Il faut arrêter la machine productiviste. Dépasser l’ambition de l’écologie par une biogéologie, pour réconcilier le point de vue des vivants et des non-vivants. Gaillardet appelle à une nouvelle « science des terrestres » pour se connecter aux pulsations de la planète, échapper à la « crétinisation de l’université qu’Edgar Morin évoquait dès 1990 », « revoir de fond en comble la place des sciences dans la société ». Géologue à l’aise avec des échelles de temps de centaines de millions d’années, Jérôme Gaillardet nous prévient : « Un jour, Hélios brûlera la Terre et évaporera l’océan, condamnant le cycle de l’eau. Un autre, Hadès s’épuisera et la tectonique des plaques cessera, faute d’énergie thermique. La Terre deviendra plane et morte ».
*
Ovni, ce livre ? Gaillardet écrit comme il parle à ses étudiants et ses auditeurs. Vous le verrez vous inviter à le suivre avec ses collègues sur le terrain. Il vous prend à partie, vous entraîne dans ses questions. Il aime la langue et les mots. Le carbone est un «fuyard», les Andes un «ogre», le sodium « flâne », les discordances géologiques un « entracte », l’humus une « forme procrastinante ». Il cite volontiers les écrivains : Victor Hugo qui prévient : « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent » et même Virginia Woolf qui s’étonne de ses « moments d’être ». Hélios et Hadès sortent rajeunis de la mythologie par le combat de titans qu’il leur prête. Il titre un chapitre « A fleur de terre », il parle de « l’échographie de la Terre », la « chorégraphie » de la matière, toutes ces cartes géologiques qu’il « aime lire » comme Bach écrivait ses partitions les plus complexes, ces lieux aux quatre coins de la planète où il emmène ses lecteurs avec ses collègues de terrain, ces observations sur les toits d’ardoise bretons, la cathédrale Notre-Dame, la galerie des Glaces de Versailles, tout parle au géochimiste émerveillé par ses découvertes, les relations qu’il peut établir. Son livre s'ouvre s'ouvre et se ferme sur deux petits textes autobiographiques qui sont des bijoux de sensibilité. La gaieté qu’il tire de son travail de chercheur percole dans ses innombrables étonnements et trahit un évident bonheur de transmettre. Une science joyeuse mais réaliste, avec un implacable constat qui nous enjoint de ne pas lâcher prise devant la catastrophe en cours.
----------
[1] Carnets de science. La revue du CNRS, #14, printemps-été 2023, p. 42-47.
[2] Sommes-nous seuls dans l’Univers ?
[3] Terra forma, manuel de cartographies potentielles, Ed. B12
-----------------------
Pour alimenter le débat :
Bruno Latour, par Manouk Borzakian
Chaud et froid sur la planète, par Gilles Fumey
Voyage en terre méconnue, par Patrick Maniglier (Libération)
Comment nous vivons dans des mondes toxiques, par Gilles Fumey
Nos imaginaires échouent sur le climat, par Gilles Fumey
Mark Alizart : notre époque a besoin d'espoir, par Manouk Borzakian
La guerre de l'eau aura-t-elle lieu ? par Renaud Duterme
-----------------------
Pour aller plus loin, le film passionnant de Daniella Ortega, sur l'histoire du carbone (2021)
Pour nous suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/geographiesenmouvement/



