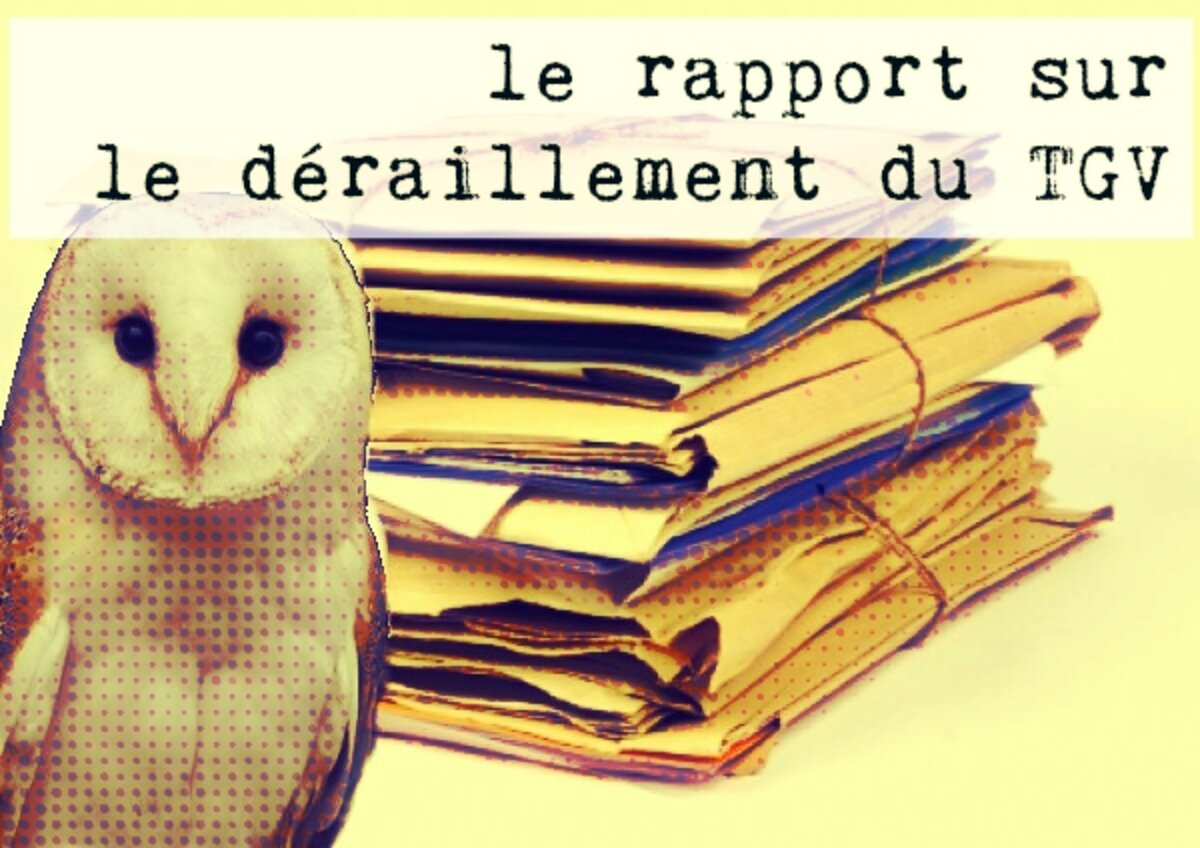
Agrandissement : Illustration 1
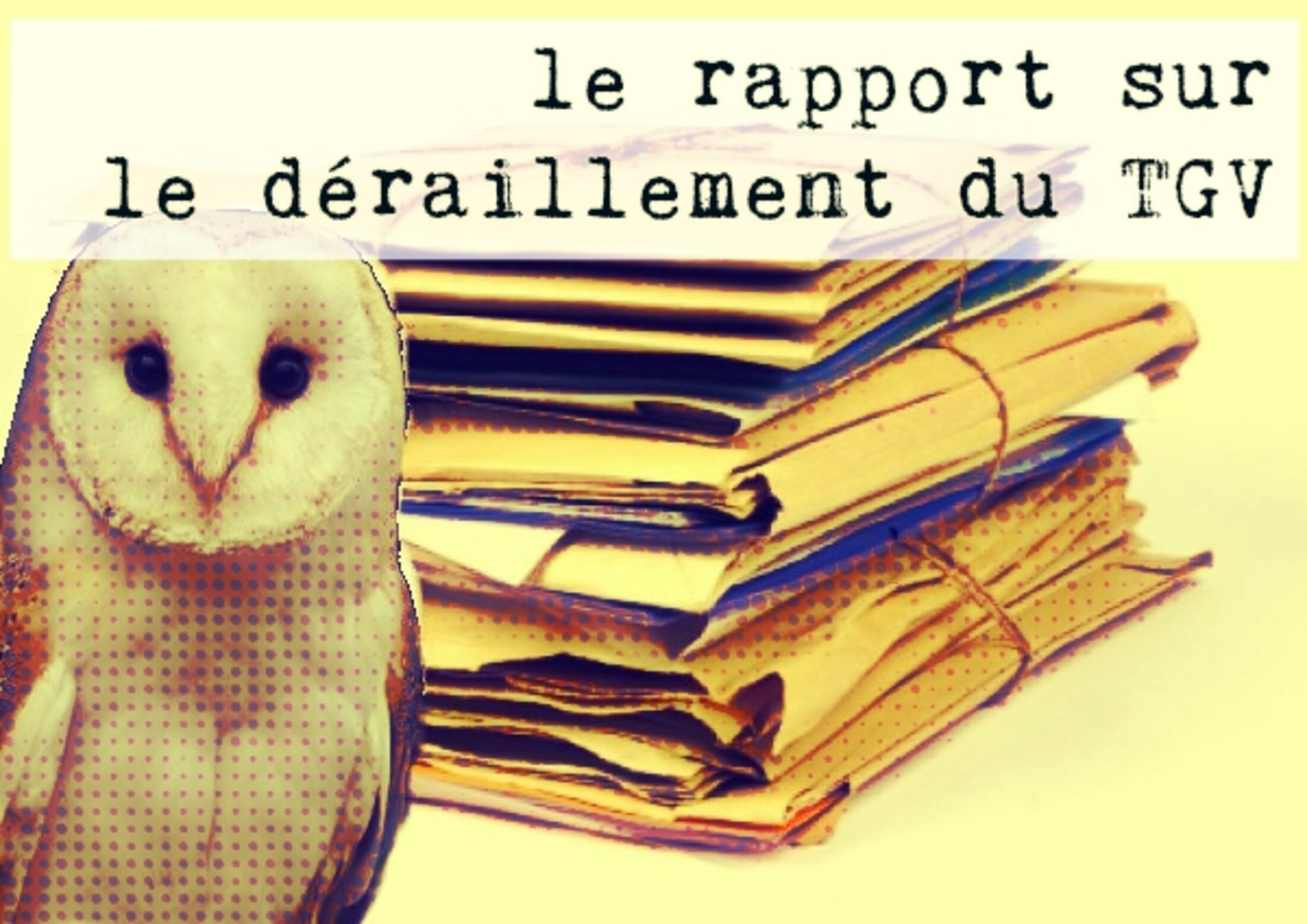
Que contient vraiment le rapport des experts qui ont réfléchi aux causes du déraillement du TGV en Alsace ? Comment ont-ils travaillé ? Qu’ont-ils conclu ? Lecture d'un gros document, évidemment très technique.
Rappelons brièvement le fait : le 14 novembre 2015, un TGV réalisait des essais en survitesse sur la ligne à grande vitesse entre Paris et Strasbourg avec à son bord des invités en grand nombre. Le système de sécurité était volontairement désactivé.
Des sources d’information problématiques
Tout d’abord, voyons sur quelles sources d’informations se basent les experts pour travailler.
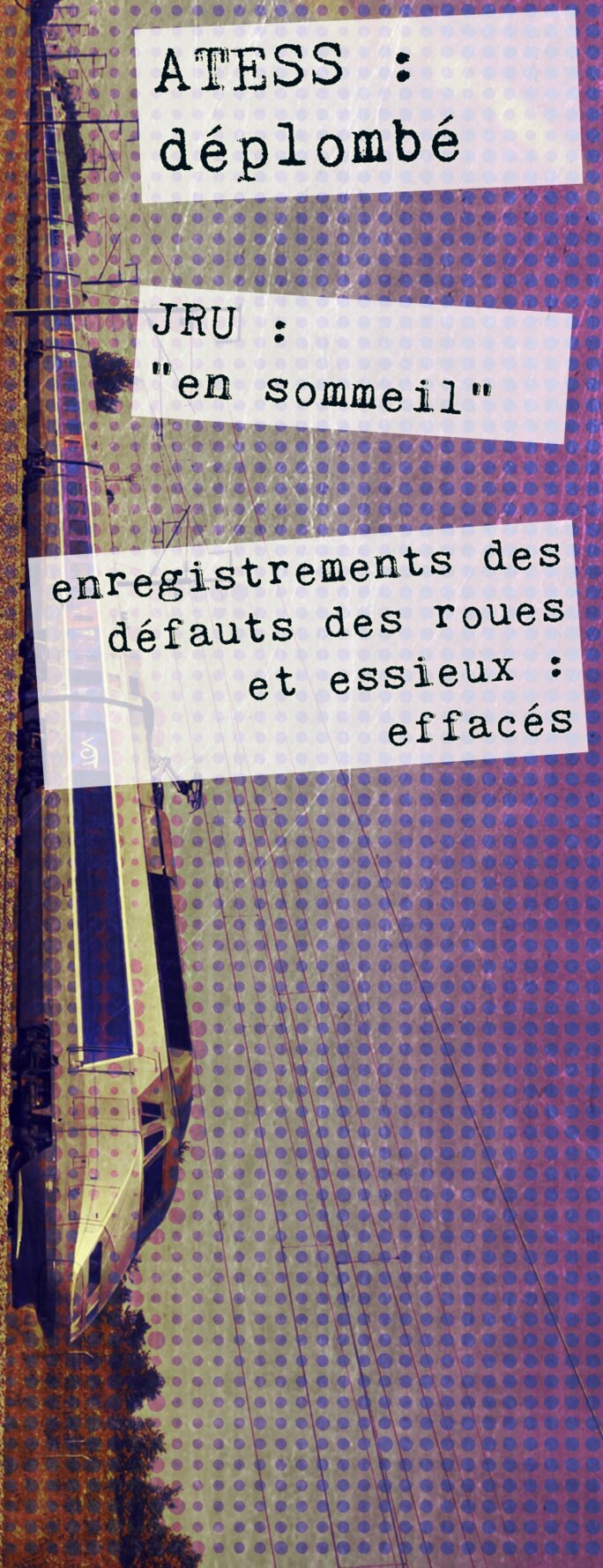
Agrandissement : Illustration 2
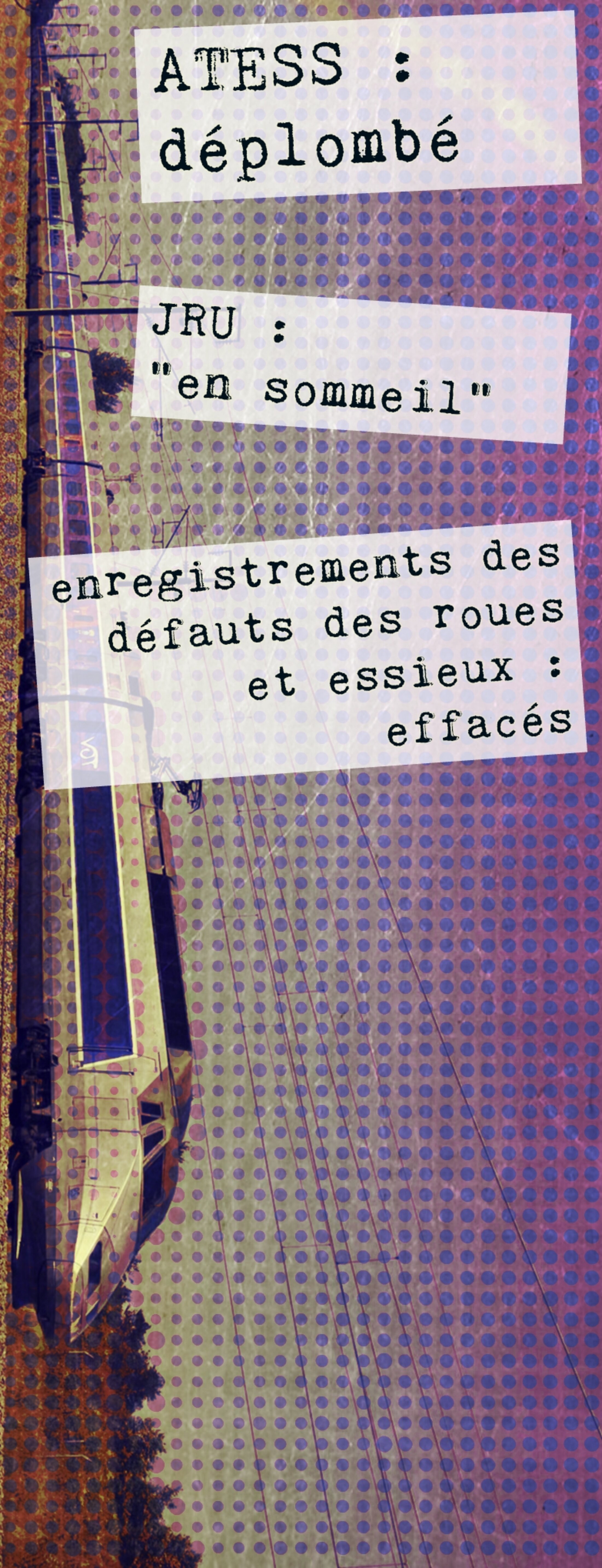
La principale source d’information est une sorte de « boîte noire » dont le nom technique est enregistreur de bord ATESS. La rame 744 était équipée de deux enregistreurs : l’un dans le poste de pilotage avant et le second dans le poste de pilotage arrière (celui qui a fini dans le canal). Au moment du déraillement, seul l’ATESS à l’avant enregistrait : des vitesses, la position du train, l’état des pantographes, l’état de la pression dans les freins, diverses actions du conducteur sur les commandes, etc. Malheureusement, le seul enregistreur ATESS qui enregistrait est aussi le seul à avoir été récupéré, un jour après le déraillement, sans le plombage de sécurité que les cheminots posent afin de garantir la fiabilité des données en cas d’incident. « Ces données sont-elles fiables ? », demande CGT-Cheminots. L’enregistreur ATESS arrière, lui, avait bien son plombage de sécurité… mais il n’enregistrait pas.
Il existe toutefois une deuxième source précieuse d’information, une seconde « boîte noire » : le JRU (juridical recording unit). Ce dispositif garde des traces de nombreuses informations très utiles dans les cas, comme son nom l’indique, où la justice cherchera à comprendre ce qu’il s’est passé. Malheureusement (bis), celui-ci se trouvait être « en sommeil » le 14 novembre 2015, expliquent les experts, c’est-à-dire qu’il n’enregistrait que l’heure, la vitesse et la position du train. Bref, en sommeil, il ne sert pas à grand-chose.
Une autre source importante d’informations valait la peine d’être examinée attentivement. Il s’agit des enregistreurs des défauts des bogies moteurs, c’est-à-dire des défauts qui pourraient survenir sur les équipements qui assurent la traction mais aussi le freinage du véhicule. Malheureusement (ter), ces données ont totalement disparu : après le déraillement, en l’absence d’alimentation électrique, le support informatique qui contenait les données ne pouvait pas les sauvegarder plus d’un mois. Les experts sont hélas arrivés trop tard, regrettent-ils : après un mois, les batteries étaient mortes et les cartes mémoires effacées. Est-il possible que ni la SNCF, ni Alstom, ni SYSTRA, ni aucun de leurs employés, n’ait prévenu les autorités qu’il y avait urgence à récupérer ces enregistreurs car on risquait de perdre leurs contenus ? Ces informations auraient permis de savoir si les bogies du train avaient bien toléré des vitesses pour lesquelles ils n'étaient pas faits.
Ni pour le JRU, ni pour les enregistreurs des bogies moteurs, la perte des informations ne peut être tenue pour une conséquence du déraillement ; quant à l’enregistreur ATESS, son plombage n’a jamais été retrouvé. Bien sûr, toutes ces sources sont des données informatiques volatiles et rien ne vaut l’examen minutieux du train lui-même par les experts. Or, nous apprend le rapport, ceux-ci ont passé trois jours, sur un an et demi de travail, à proximité de la rame accidentée. Et ils ne rendent compte d’aucune observation du train lui-même bien qu’ils expliquent à quelques passages de leur rapport avoir étudié ce qu’il reste du train. Pendant ce temps, les parties civiles demandent toujours que le TGV 744 soit enfin expertisé. Réponse des juges : c’est encore trop tôt.
En résumé, la principale source d’information sur laquelle les experts ont fondé l’essentiel de leur travail est l’enregistreur ATESS qui, mystérieusement déplombé, présente une fiabilité toute relative.
Les auteurs du rapport : Bernard Lerouge, Bernard Dumas
Ils ont l'un et l'autre travaillé longtemps pour Alstom Transport. Ils ont occupé des postes de directeurs dans l’entreprise qui a conçu le TGV qui a déraillé. Bernard Dumas et Bernard Lerouge ont également donné des cours à l’ESTACA (une école d’ingénieurs ferroviaires) où ils ont rencontré et formé une partie des personnes impliquées dans le déraillement. Certains survivants se souviennent de leurs anciens professeurs.
Un auteur invité : sa majesté Alstom
Alstom intervient directement dans le travail d'expertise de ses anciens directeurs techniques. Comme Lerouge et Dumas n'arrivent pas à calculer à deux la vitesse critique au-delà de laquelle on déraille, Alstom leur fournit d'abord un tableur Excel. Le tableur est déjà rempli ce qui permet de directement annoncer le résultat sans avoir à présenter de calcul : à partir de 208km/h, le côté droit du train se soulève obligatoirement. Comme il existe un autre outil, plus précis que la feuille Excel d'Alstom, pour vérifier ce résultat, les experts veulent utiliser le logiciel Simpack, spécialisé dans les simulations de déraillement. Hélas, aucun des deux experts ferroviaires n'a la licence de ce logiciel ! Et puis, de toute façon, expliquent-ils, leurs ordinateurs sont trop faibles pour le faire tourner. A nouveau, Alstom arrive à la rescousse et leur souffle la réponse, le logiciel Simpack dit qu'Excel était un peu pessimiste, le TGV se renverse à partir de 222km/h.
Qu’apprend-on ? Les conclusions
Ce que l’on apprend d'abord, c’est que les conducteurs n’étaient pas préparés, ils n’avaient pas reçu de formation particulière pour réaliser des essais en survitesse, ils n’avaient d’ailleurs pas d’expérience et surtout ils ne disposaient pas des informations nécessaires qui leur auraient permis d’éviter la catastrophe. Manque de rigueur, manque de communication entre les différentes entreprises. Tout ceci, aux dires des avocats des parties civiles, conduira très certainement à ce que la SNCF et sa filiale SYSTRA soient mises en examen.
On apprend également qu'à l’endroit du déraillement, il suffisait de rouler à environ 215km/h pour quitter les rails. L’essai exigeait qu’à cet endroit, le train aille à plus de 176km/h en venant d’un palier à plus de 330km/h. Les experts jugent donc irréaliste et dangereux l'enchaînement sur trois kilomètres à peine de ces deux paliers de vitesse. Entre 176 et 215km/h, une marge de manœuvre bien faible ! D'autant que les conducteurs ne savaient pas qu'à 215km/h (ou plus), le train déraillerait dans le raccordement de Vendenheim. La dernière vitesse enregistrée par la boîte noire (ATESS) était de 243km/h !
De plus, les experts expliquent aussi que la masse des passagers qui avaient tous été installés à l’étage d’une voiture duplex, a élevé le centre de gravité de cette voiture, et a donc favorisé le déraillement. Leur poids était un facteur de risque supplémentaire. Autrement dit, leur poids a diminué la vitesse critique (d'environ 10km/h, précisent-ils à la louche).
Le rapport explique encore que le déraillement est dû à un freinage tardif. Le conducteur a actionné la commande de frein trop tard : s'il avait freiné plus tôt, il aurait pu passer la courbe en-dessous des périlleux 208km/h et le déraillement aurait pu être évité. Cependant, ce qui permet d’établir cette vitesse indépassable de 208km/h, c’est un calcul réalisé directement par Alstom... qui innocente le TGV... que fabrique Alstom. Les experts prennent soin de rassurer : le constructeur du TGV est intervenu en toute neutralité dans ce rapport.
Enfin, en parcourant les annexes, on apprend que le frein d’urgence du TGV n’a pas produit la dépression attendue dans la conduite générale qui permet aux freins de bloquer les roues. Malgré cela, les experts expliquent que le freinage a été optimal et un schéma résume que cette dépression aurait été en fait suffisante contrairement à ce qu’affirme la boîte noire (ATESS). La dépression était-elle suffisante ou insuffisante ? Les cheminots étaient-ils embarqués à bord d'un train dont les freins ne fonctionnaient pas de façon optimale ? C'est une inquiétude que partagent plusieurs rescapés de la catastrophe.
D'une seule voix, la presse a annoncé ce rapport comme extrêmement "accablant" pour la SNCF et sa filiale SYSTRA. Et en effet, le manque de rigueur qui entourait ces essais leur sera certainement reproché par les victimes. Pourtant, ces entreprises n'auront finalement qu'à améliorer leur organisation et mettre un peu de sérieux dans tout ça. C'est ce que l'on souhaite ; et disons-le, ça ne coûte rien de le dire et pas grand-chose de le faire.
Mais comme les experts se sont méthodiquement appliqués à mettre hors de cause le TGV lui-même (et tout spécialement son frein de secours) en n'allant pas examiner le TGV 744 minutieusement, tout simplement, ou en se contentant de déplorer la disparition des données d'enregistreurs, alors il se peut que ce nouveau rapport soit une véritable aubaine pour la SNCF... et pour Alstom, qui demeure au-dessus de tout soupçon !
Pour poursuivre sur ce sujet :
- Mon travail sur la manipulation médiatique
- L'article de Bernard Aubin sur la responsabilité des conducteurs.



