Ellenberger (1905-1993) est un psychiatre de nationalité suisse, naturalisé français. Il a écrit une histoire de la psychothérapie, qui est l’ouvrage le plus célèbre sur ce sujet. Une première édition a paru en 1970 à New York chez Basic Books : The Discovery of the Unconscious. The History and Evolution of Dynamic Psychiatry (932 p.). L’ouvrage sera complété puis traduit en français, italien, allemand, espagnol, japonais. La traduction française, parue chez Simep (Villeurbanne) en 1974, s’intitule A la découverte de l'inconscient. Histoire de la psychiatrie dynamique. Elle compte environ 5000 références bibliographiques. Une réédition a paru en 1994 chez Fayard (1016 p.).
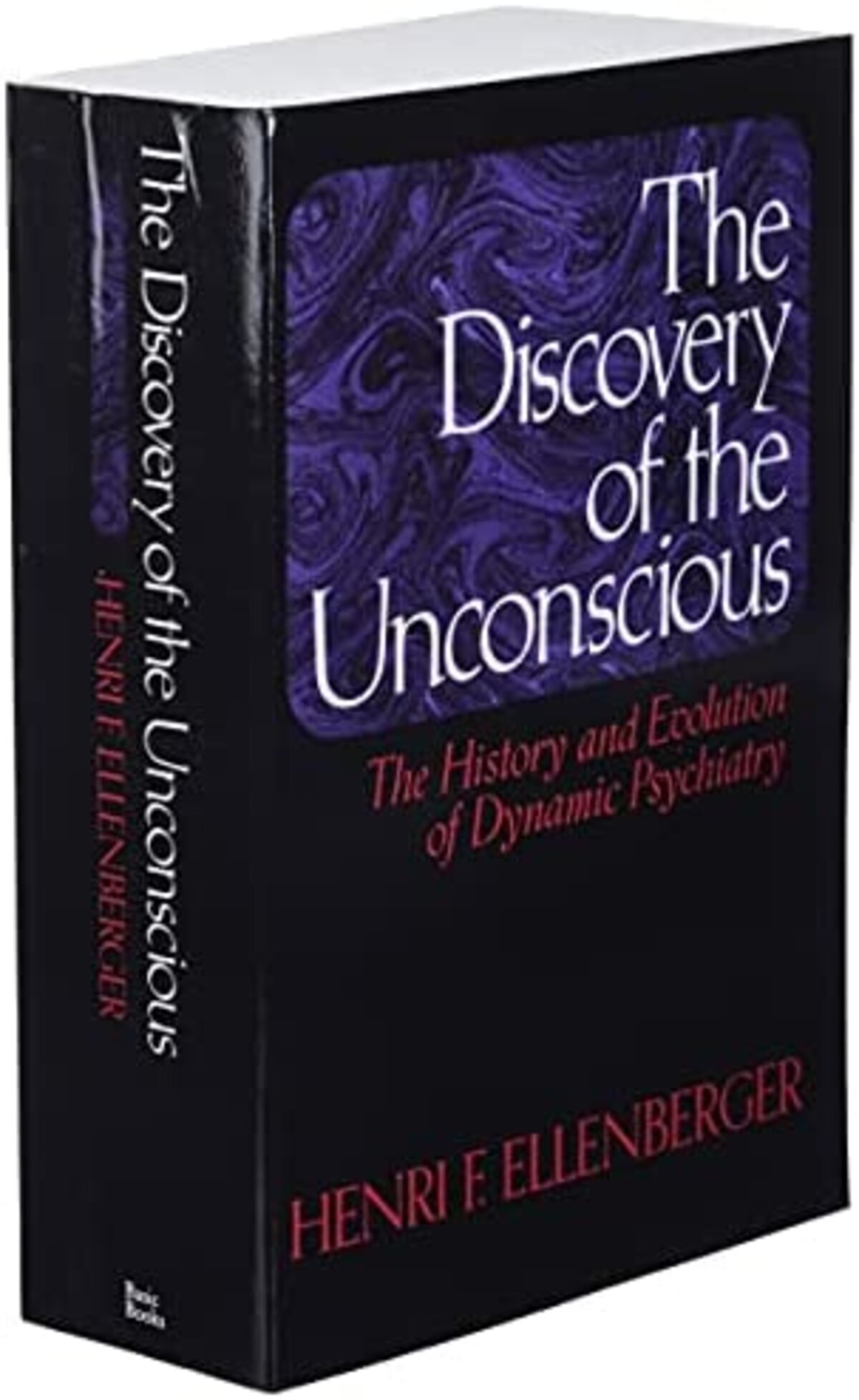
Ellenberger est le fils de pasteurs protestants évangélisant en Afrique. Il a été séparé de ses parents à l’âge de neuf ans pour faire ses études à Paris, puis à Londres, en Alsace et finalement à Paris pour ses études de médecine. Durant un stage à l’Hôtel-Dieu, chez le Dr. Sainton, spécialiste des glandes endoctrines, il constate comment une théorie peut phagocyter des faits hétéroclites, surtout lorsqu’on invoque une forme d’inconscience. Il écrit à ses parents : « Tous les malades, d’après lui, ont quelque chose soit au corps thyroïde, soit à l’hypophyse, etc. De même, il a la manie de voir partout des séquelles de l’encéphalite léthargique. D’après lui, on ne se doute pas du nombre de gens qui ont eu l’encéphalite léthargique sans le savoir, soit au cours de leur plus tendre enfance et ils l’ont oublié, soit que la maladie ait été très fruste et reconnaissable par un spécialiste seul. Il adore cette maladie et il est ravi quand il en trouve une » (28.3.1926).
Ellenberger se spécialise en neurologie et en psychiatrie à La Salpêtrière, à l’hôpital Sainte-Anne et à Berne. Il s’établit ensuite en Suisse. Il a alors des contacts avec C.G. Jung et acquiert une formation psychanalytique freudienne. De 1949 à 1952, il réalise son analyse didactique sous la direction d’Oscar Pfister, le pasteur ami de Freud. Celui-ci lui signale que ce que raconte Ernest Jones au sujet de Freud comporte des erreurs et même des mensonges, notamment l’affirmation que Freud aurait été constamment attaqué de façon malhonnête.
En 1953, Ellenberger émigre aux États-Unis et devient assistant du psychiatre-psychanalyste Karl Menninger à la Fondation Menninger (à Topeka), à l’époque la plus grande institution psychiatrique du monde, où travaillaient plusieurs centaines de psychiatres et de psychologues. En 1953, il est nommé professeur et enseigne le cours « Histoire de la psychiatrie dynamique ». La psychiatrie dynamique est alors définie comme la psychiatrie qui explore les forces psychiques inconscientes et les utilise pour soigner. Son histoire commence à la préhistoire et sa période moderne débute en 1775 avec Mesmer.

C’est à cette occasion qu’Ellenberger lance ses recherche qui aboutiront quelques années plus tard à la publication de son monumental ouvrage, alors qu’il aura été nommé professeur à l’université de Montréal. Quand on sait que le professeur Dongier, son collègue à l’université de Montréal, disait : « La caractéristique que j’ai apprise de lui c’est de toujours aller à la source. Je ne l’ai jamais vu citer quelque chose de seconde main », on mesure qu’Ellenberger a été un travailleur exceptionnel, rigoureux, infatigable. À quoi il faut ajouter : particulièrement honnête et consciencieux. Un conseil, reçu lors d’une rencontre avec le célèbre anthropologue Arnold Van Gennep, était devenu une de ses devises de chercheur : « Méfiez-vous des coups de pouce, autrement dit : Faites attention à cette tendance naturelle qu’on a d’embellir les faits en fonction de sa propre théorie ou de lui donner une couleur journalistique. »
Démystification du cas princeps de la psychanalyse
Lorsque Freud faisait un exposé général de ses conceptions, il commençait souvent par présenter le traitement d’une Viennoise de 21 ans, Bertha Pappenheim, qui avait été traitée par son mentor, Josef Breuer, de décembre 1880 à juin 1882. Le cas avait été publié pour la première fois en 1895, sous le pseudonyme d’Anna O., dans Études sur l’hystérie. Breuer avait passé plus de mille heures en compagnie de sa patiente, qu’il voyait parfois deux fois par jour.
Freud, dans toutes les présentations qu'il fera de ce qu’il considère comme le prototype de la cure psychanalytique, affirmera que « tous » les symptômes d'Anna O. disparurent grâce au rappel de souvenirs accompagnés des émotions qui s'y trouvaient liées.
En 1953, Ernest Jones, ami fidèle et biographe de Freud, évoqua ce qui était devenu un secret de polichinelle dans le milieu freudien : « L'état de la pauvre malade ne s'améliora pas autant que le laisserait supposer l'observation écrite de Breuer. Elle fit plusieurs rechutes et dut être placée dans une maison de santé à Gross-Enzensdorf. Un an après qu'il eut cessé de la soigner, Breuer confia à Freud qu'elle était tout à fait détraquée, et qu'il lui souhaitait de mourir et d'être ainsi délivrée de ses souffrances » [1].
Au terme d’une enquête ayant l’allure d’un roman policier, Ellenberger retrouva en 1971, dans un institut psychiatrique suisse, le dossier concernant le placement d’Anna O. L’issue de la « cure par parole » par Breuer avait été désastreuse : la patiente était davantage perturbée qu’avant le traitement et était devenue morphinomane. L’histoire d’Anna O., telle que Freud la présentait, est une mystification parfaitement consciente [2].
Démystification de légendes freudiennes
Ellenberger a fait pour le freudisme ce que Luther a fait pour le catholicisme : oser remettre en question l’autorité du Pape. Ses recherches l’ont mené notamment à ces conclusions : « La légende freudienne révèle deux traits essentiels. Le premier est le thème du héros solitaire, en butte à une armée d'ennemis, subissant, comme Hamlet, les “coups d'un destin outrageant”, mais finissant par en triompher. La légende exagère considérablement la portée et le rôle de l’antisémitisme, de l'hostilité des milieux universitaires et des prétendus préjugés victoriens. En second lieu, la légende freudienne passe à peu près complètement sous silence le milieu scientifique et culturel dans lequel s'est développée la psychanalyse, d'où le thème de l'originalité absolue de tout ce qu'elle a apporté : on attribue ainsi au héros le mérite des contributions de ses prédécesseurs, de ses associés, de ses disciples, de ses rivaux et de ses contemporains en général. […] La légende attribue à Freud une bonne partie des découvertes d'autres savants, en particulier de Herbart, de Fechner, de Nietzsche, de Meynert, de Benedikt et de Janet, et elle sous-estime considérablement les travaux des explorateurs de l'inconscient, des rêves et de la pathologie sexuelle antérieurs à Freud. Une bonne partie des idées dont on attribue le mérite à Freud étaient des idées courantes » [3].
L’innovation la plus frappante de Freud
La réédition en français du grand ouvrage d’Ellenberger en 1994 se présente avec une préface de Mme Roudinesco, la célèbre avocate française du freudisme. Cette préface et la photo de Freud placée cette fois en couverture vont à l’encontre d’une des thèses essentielles d’Ellenberger : alors qu’E. Roudinesco répète sans cesse que l’œuvre de Freud constitue une « rupture épistémologique » dans l’histoire de la psychiatrie, Ellenberger montre précisément que Freud n’est qu’un auteur parmi d’autres du courant de l’analyse psychologique, un auteur beaucoup moins original que la grande majorité des gens le croient.
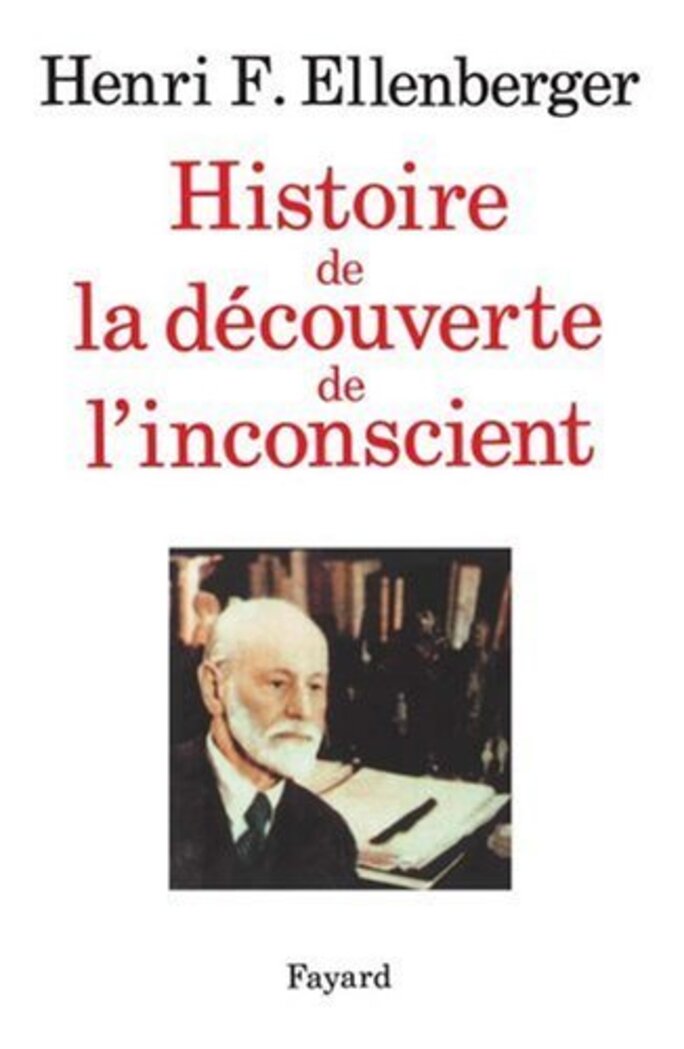
Pour Ellenberger, « L’innovation la plus frappante de Freud fut probablement la fondation d’une “école”, selon un modèle sans exemple à l’époque moderne, mais qui se présente comme une reviviscence des écoles philosophiques de l’antiquité gréco-latine. Presque dès le début, Freud a fait de la psychanalyse un mouvement, avec sa propre organisation, sa maison d’édition, la réglementation très stricte imposée à ses membres et sa doctrine officielle, la théorie psychanalytique. La similarité entre l’école psychanalytique et les écoles philosophiques gréco-romaines s’est trouvée encore renforcée par l’imposition d’une initiation sous la forme de l’analyse didactique. Celle-ci exige du candidat non seulement un lourd sacrifice financier, mais aussi qu’il livre sa vie intime et toute sa personnalité. Le psychanalyste se voit ainsi intégré dans la société de façon plus indissoluble encore qu’un pythagoricien, un stoïcien ou un épicurien pouvaient l’être dans leurs propres organisations. » (p. 465s).
L’œuvre d’Ellenberger compte d’autres livres et surtout des centaines d’articles, se caractérisant toujours par la minutie, la rigueur, la pertinence. Un bon nombre de ses publications présentent des vues nouvelles, originales, tant pour l’histoire de la psychiatrie que pour la criminologie et la sociologie des maladies mentales. Encore un exemple : Ellenberger a découvert l’identité du premier cas de psychanalyse par Freud : Emmy von N. [4].
Dernières années
Ellenberger a continué jusqu’à un âge avancé de pratiquer la psychothérapie, qui était devenue « éclectique » et non plus psychanalytique. Il s’inscrivait alors dans la lignée de la thérapie humaniste, inspirée de Carl Rogers, et se basait sur des concepts d’Adler. Il utilisait aussi des techniques comportementales [5].
Andrée Yanacopoulo, docteur en médecine et maître en sociologie, a publié une biographie d’Ellenberger, dont elle a suivi les cours à l’université de Montréal. À l’exemple d’Ellenberger, elle a travaillé avec un soin exceptionnel. Son ouvrage Henri F. Ellenberger. Une vie. (Montréal : éd. Liber, 392 p.) présente des inédits d’Ellenberger et une bibliographie exhaustive des publications d’Ellenberger (36 pages !). Il s’agit de la biographie indépassable du célèbre psychiatre-historien.
Références
[1] Jones E. (1958) La Vie et l'œuvre de Sigmund Freud. Trad., Paris, PUF, t. 1, p. 248. (Il s'agissait en fait du sanatorium d'Inzensdorf).
[2] « L’histoire d’“Anna O.” Étude critique avec documents nouveaux », L’Évolution psychiatrique, 1972, 37 : 693-717. Pour plus de détails sur l’histoire d’Anna O. :
[3] A la découverte de l’inconscient, Simep, 1974, p. 464.
[4] Ellenberger, H. (1977) Histoire d’Emmy von N. Étude critique avec documents nouveaux. L’Évolution psychiatrique, 1977, 42 : 519-540.
[5] Yanacopoulo, A. (2009) Henri F. Ellenberger. Une vie. Montréal : éd. Liber, pp. 223, 255.
Deux sites pour des publications de J. Van Rillaer sur la psychologie, la psychopathologie, les psychothérapies, les psychanalyses, etc.
1) Site de l'Association Française pour l'Information Scientifique :
2) Site de l'université de Louvain-la-Neuve:



