René Pommier est ancien élève de l’École Normale Supérieure. Il est docteur ès-lettres. Sa thèse, soutenue en 1986 devant l'Université de Paris-Sorbonne, avait pour sujet le livre Sur Racine de Roland Barthes, qu’il a démantelé. Il a enseigné la littérature française du XVIIe siècle à l'université de Paris-Sorbonne. Il a produit une œuvre abondante sur cette littérature.
C’est un extraordinaire polémiste, qui s’attaque à des vedettes de l’intelligentsia, comme Roland Barthes, René Girard [1], George Molinié. Il a consacré cinq ouvrages à Freud, un auteur dont il a découvert les absurdités à l’occasion de son analyse d’œuvres de Barthes [2].
Bien que ses critiques aillent à contre-courant de penseurs à la mode, il a été honoré de récompenses prestigieuses : le Prix de la Critique de l'Académie française pour son ouvrage Assez décodé !, le Prix Joseph Saillet de l'Académie des Sciences morales et politiques pour Sigmund est fou et Freud a tout faux. Remarques sur la théorie freudienne du rêve [3]. Il a reçu le Prix Alfred Verdaguer de l'Institut pour l'ensemble de son œuvre.
Plusieurs de ses ouvrages portent sur l’analyse de la religion, notamment sur Sainte Thérèse d’Avila [4] et les croyances religieuses de Pascal [5]. On peut se faire une idée de son érudition, de son intelligence et de sa puissance d’analyse en visitant son site : <http://rene.pommier.free.fr/>.
J’ai découvert Assez décodé ! en 1979, à l’époque où j’écrivais Les illusions de la psychanalyse. Cet ouvrage a renforcé ma conviction que Lacan et ses imitateurs avaient développé l’art de dire des choses dénuées de sens tout en ayant l’air de dire des choses très profondes. J’ai alors cité cet énoncé du « sémanticien » François Rastier : « L'isotopie métaphorique/ phallus/:/ parapluie/ est plus forte que l'isotopie/phallus/ : /bâton/, car, outre le sème “oblongité”, elle comporte le sème “expansivité” ». Traduit en français « populaire » : le parapluie est une meilleure image du phallus que le bâton parce qu'il est de forme allongée et peut se déployer. René Pommier se désolait de voir que « la psychanalyse a contaminé la critique littéraire sur laquelle on assiste, depuis quelques années, à un véritable déferlement du fléau phallique. Il ne se passe plus de semaines sans que des livres ou des articles de revues n'apportent de nouvelles pièces à l'affolante panoplie de symboles phalliques déjà découverts dans la littérature française et il faudra bientôt utiliser l'ordinateur pour la recenser » (p. 20).
Brocards [6], le nouveau livre de Pommier, est constitué de courts textes satiriques qui visent ses cibles préférées : Barthes, Girard, Freud, Dolto, la religion. Nous transcrivons quelques passages en espérant faire lire celui que le philosophe Pascal Engel appelle « le dernier des Voltairicans ».
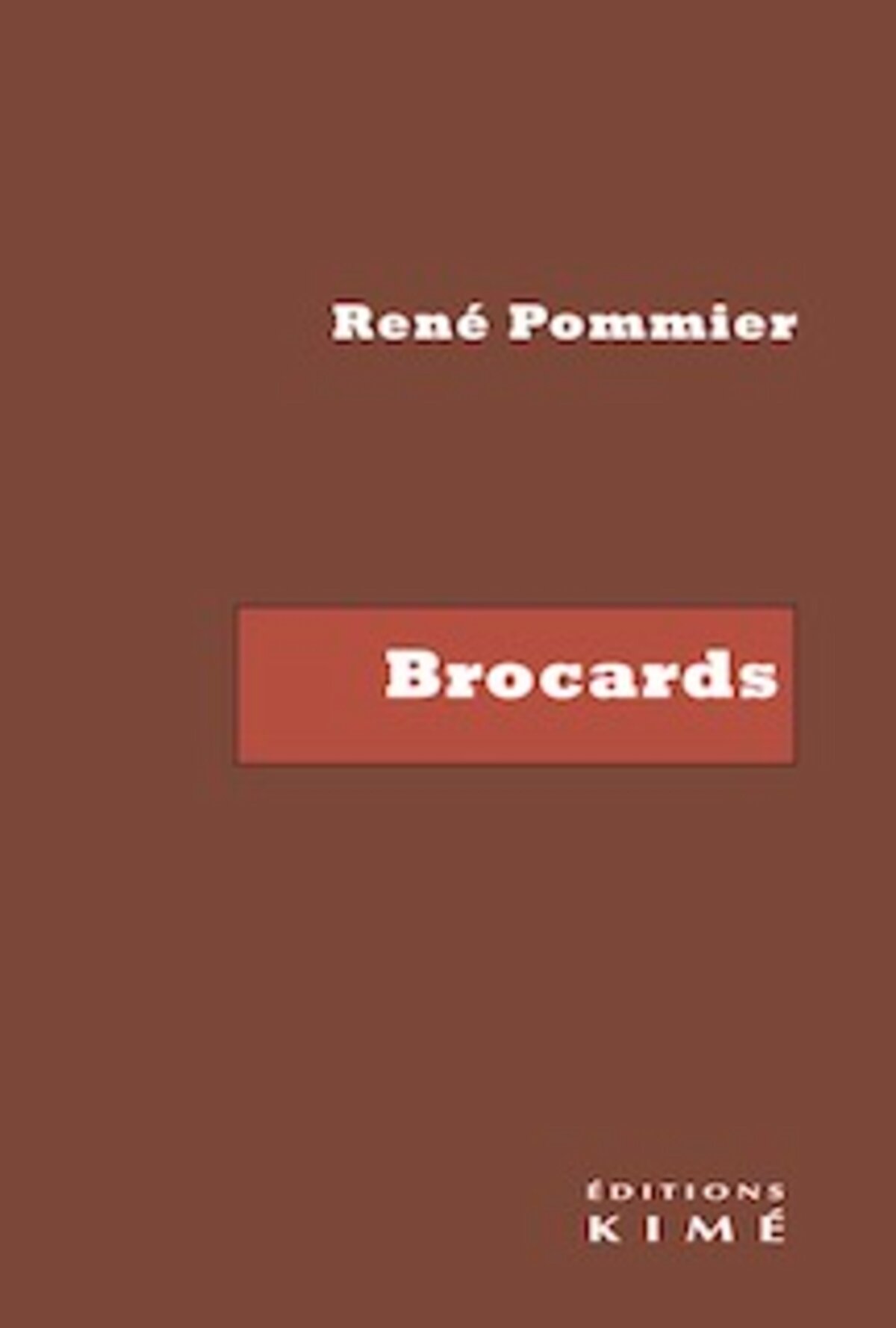
« Le Coran ne cesse d'évoquer l'effroyable sort qu'Allah le miséricordieux réserve aux infidèles après leur mort. Ils sont tous éternellement destinés au feu ardent de la géhenne, leur peau repoussant au fur et à mesure qu'elle est détruite par le feu. Cela étant, on pourrait s'attendre à ce que tous les musulmans fassent preuve d'une grande patience à l'égard des infidèles et les regardent tranquillement mener leur vie impie, riant sous cape en pensant à ce qui les attend à la fin. Au lieu de cela, ils se plaisent à les zigouiller de manières diverses et variées en ayant recours aussi bien à des procédés qui ont depuis longtemps fait la preuve de leur efficacité, comme la lapidation, l'égorgement ou la décapitation, qu'à des méthodes plus modernes comme l'arrosage à la kalachnikov. Se pourrait-il qu'ils ne fissent pas confiance à Allah ? » (p.32)
« Pour expliquer les effarantes puérilités que l'on trouve dans la Bible, et notamment le récit de la création du monde au début de la Genèse, on nous dit que Dieu a voulu se mettre à la portée des gens de l'époque qui ignoraient tout de la cosmologie. Soit, mais c'était là une politique à très court terme, bien étonnante de la part de quelqu'un qui en principe aurait dû, plus que personne, avoir le sens du long terme. Il aurait dû savoir que, la Bible étant destinée à devenir pour de nombreux siècles le plus grand best-seller, le livre par excellence, les puérilités, les incongruités, les absurdités qu'on y rencontre quasi à toutes les pages, poseraient bien vite et de plus en plus de gros problèmes aux chrétiens et fourniraient d'innombrables arguments aux incroyants. » (p. 43)
« Je ne comprends pas qu'on puisse s'interroger sur la ou les causes de la disparition des dinosaures. L'explication ne peut pourtant faire aucun doute si l'on veut bien prendre la Bible au sérieux. La disparition des dinosaures est évidemment liée au Déluge. Mais, il est vrai, on peut légitimement hésiter entre deux hypothèses : ou bien, et c'est l'explication la plus probable, Noé et les siens n'ont pas réussi à convaincre les dinosaures d'entrer dans l'arche et n'ont pas pu les y contraindre (ils avaient déjà eu de très gros problèmes avec les hippopotames et les rhinocéros) ; ou bien Noé, qui était un sage, a jugé qu'il fallait sauter sur l'occasion de se débarrasser d'une espèce particulièrement peu avenante et leur a dit qu'il n'y avait plus de place dans l'arche, ce qui était d'ailleurs tout à fait plausible. » (P. 27)
« Dans le Discours sur l'histoire universelle, Bossuet nous explique que, si Dieu a créé le monde en six jours, alors qu'il aurait très bien pu le faire instantanément, c'est pour bien nous montrer qu'il n'agissait jamais à la légère : « Ce puissant architecte, à qui les choses coûtent si peu, a voulu les faire à plusieurs reprises, et créer l'univers en six jours, pour montrer qu'il n'agit pas avec une nécessité ou par une impétuosité aveugle, comme se le sont imaginé plusieurs philosophes » (Bibliothèque de la Pléiade, pp. 766-767). Bien que je sois tout disposé à admettre que Dieu prend toujours sa tâche très au sérieux, je me demande pourtant si, lorsqu'il a créé Bossuet, il n'a pas agi un peu à la va-vite. » (p. 108)
« On peut ou non, écrit Françoise Dolto, parler avec le flatus vocis à l'enfant qu'on porte. C'est étonnant comme résultat. J'ai eu l'expérience avec mon fils aîné. Il est né en pleine guerre, en 1943. Je faisais tous mes déplacements à bicyclette. On ne se rend pas compte aujourd'hui, au volant d'une voiture, que la rue Saint-Jacques monte beaucoup depuis le boulevard Saint-Germain. Je revenais d'une course et je peinais sur ma machine. Et alors, cet enfant, ce fœtus, probablement gêné parce que j'étais fatiguée moi aussi, remuait, remuait, si bien que je me disais : “Je ne vais pas pouvoir pédaler jusqu'à la maison. Je n'en peux plus. Et marcher en poussant ce vélo, ce sera encore plus long !” Et ce jour, j'ai eu l'idée de lui dire : “Écoute, mon chéri, si tu bouges comme ça dans mon ventre, ça va être encore plus long, parce que tu me gênes pour pédaler. Reste tranquille, on va être vite arrivés”. Il s'est immédiatement arrêté. Je lui avais parlé intérieurement. Pas tout haut, pas avec mes lèvres. Il s'est arrêté, j'ai pu pédaler, pédaler, je suis arrivée à la maison et je lui ai dit : “Maintenant, ça y est”. Et il s'est mis à faire la sarabande dans mon ventre. Il avait huit mois. » (La cause des enfants. Robert Laffont, 1985, p. 242). S'il y a, en effet, quelque chose d'étonnant dans cette histoire, c'est seulement la sottise de Françoise Dolto. Qu'une mère ait envie de parler intérieurement ou tout haut à l'enfant qu'elle porte, surtout vers la fin de la grossesse, cela me paraît tout à fait naturel et je pense que beaucoup le font. Mais celles qui croient que leur enfant comprend ce qu'elles leur disent doivent heureusement être très rares. Françoise Dolto elle, n'en doutait pas. Un de mes vieux amis qui la connaissait bien m'a assuré l'avoir entendu dire un jour à l'enfant qu'elle portait alors : « Mon chéri, comme tu t'en es sans doute aperçu, je suis constipée. Si tu bougeais, cela pourrait aider à me dégager ». (p. 7)
Co-auteur du Livre noir de la psychanalyse, j’ai particulièrement apprécié ce brocard décoché à Élisabeth Roudinesco, la principale avocate de la psychanalyse en France :
« Dans Pourquoi tant de de haine ? Élisabeth Roudinesco ose écrire que le Livre noir de la psychanalyse « connaîtra le sort de tous les brûlots de ce genre, au même titre que les Impostures intellectuelles de Sokal et Bricmont ou que L'effroyable imposture de Thierry Meyssan » (Navarin éditeur, 2005, p. 31). Il faut tout de même un sacré culot pour mettre sur le même plan le livre de Sokal et Bricmont et celui de Tierry Meyssan. Le premier est celui de deux grands savants. Tous les deux enseignaient des sciences dures. Jean Bricmont était professeur de physique théorique à l'Université de Louvain et Alan Sokal professeur de mathématiques à l'University College de Londres et professeur de physique à l'Université de New-York. Thierry Meyssan ne semble avoir fait que quelques études de théologie au séminaire d'Orléans. C'était, il est vrai, une formation tout à fait appropriée pour quelqu'un qui allait se destiner à faire carrière dans l'affabulation et à devenir une figure majeure du conspirationnisme. Mais cela d'ailleurs aurait pu tout aussi bien le mener à devenir psychanalyste. Mais surtout le livre de Sokal et Bricmont dénonce et démonte des impostures, certes sans gravité, mais bien réelles. Le livre de Thierry Meyssan prétend dénoncer une imposture qui serait effectivement effroyable si elle n'avait été inventée de toutes pièces, et constitue lui-même, de ce fait, une monstrueuse imposture. L'amalgame auquel se livre Élisabeth Roudinesco est donc tout à fait scandaleux. »
———————
[1] Compte rendu dans Science et pseudo-sciences, 2011, 282 :96-97, https://www.pseudo-sciences.org/Rene-Girard-Un-allume-qui-se-prend-pour-un-phare
[2] Cf. J. Van Rillaer : Roland Barthes: suiveur de Freud et de Lacan.
[3] Compte rendu dans Science et pseudo-sciences, 2008, n° 282, p. 55s. https://www.afis.org/Sigmund-est-fou-et-Freud-a-tout-faux
[4]Compte rendu dans Science et pseudo-sciences : https://www.afis.org/Therese-d-Avila-Tres-sainte-ou-cintree
[5] Compte rendu dans Science et pseudo-sciences : https://www.afis.org/O-Blaise-A-quoi-tu-penses-Essai-sur-les-Pensees-de-Pascal
[6] Brocards, Paris, éd. KIMÉ, 124 p.



