Ludwig Wittgenstein (1889-1951) est né à Vienne. Il a étudié à Cambridge, où il a bénéficié de l’enseignement de Bertrand Russell. Il y est devenu professeur.
Il est un des plus grands philosophes du XXe siècle. Il a joué un rôle déterminant pour la philosophie analytique. Il a contribué notamment à la logique formelle, l’analyse du langage, l’éthique, l’esthétique, la critique de la philosophie traditionnelle (il a critiqué lui-même ses premiers travaux de philosophie).
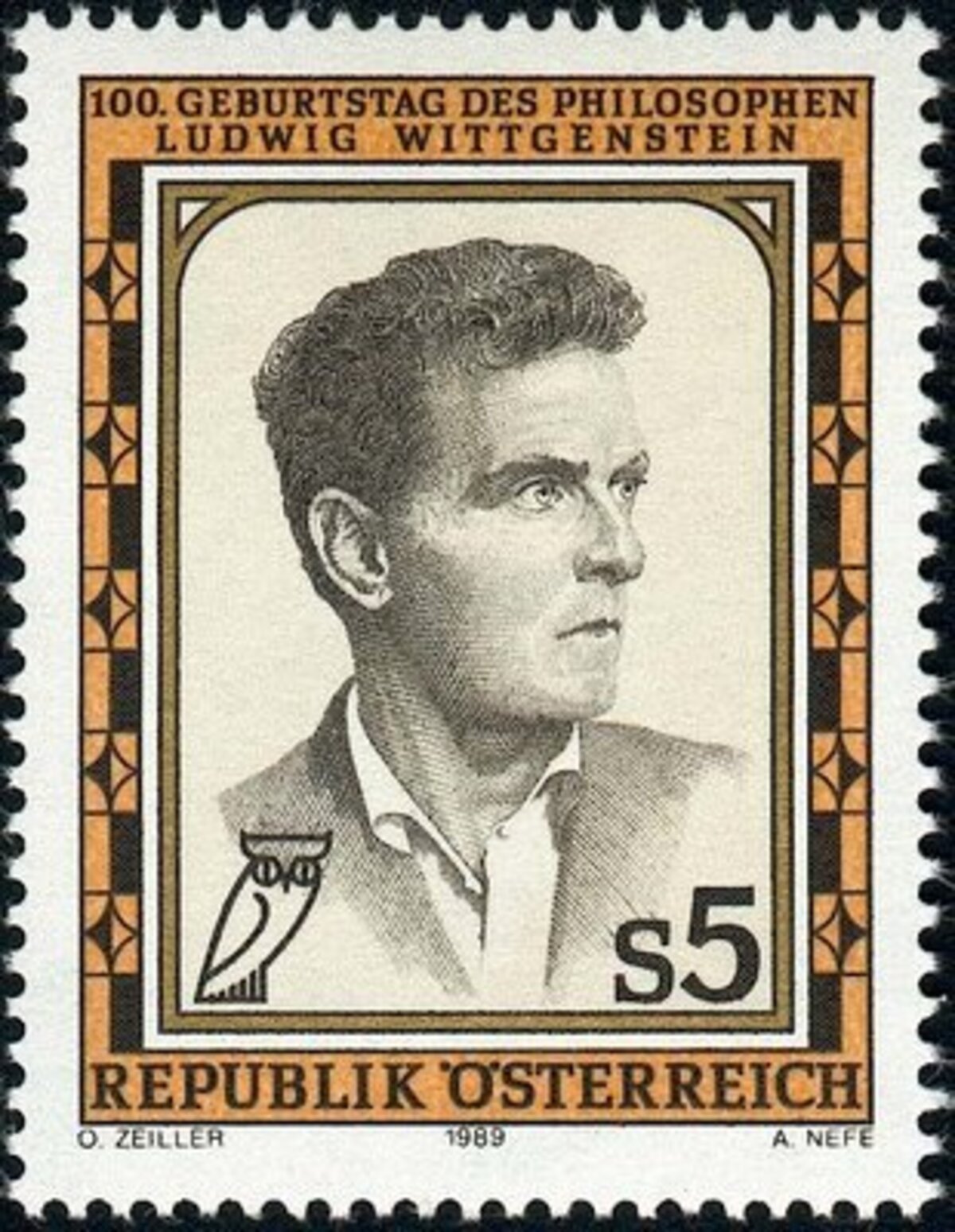
Wittgenstein appartenait au milieu de la grande bourgeoisie éclairée de Vienne, où les révélations freudiennes suscitaient une curiosité considérable. Sa sœur Margarete avait été analysée par Freud et entretenait des relations personnelles avec lui. Elle et Ludwig aimaient se raconter leurs rêves et les interpréter ensemble [2].
Dès les années 1920 Wittgenstein avait lu plusieurs livres de Freud et s’était enthousiasmé pour L’Interprétation du rêve. Jusque dans les années 1940, il se considérait comme un « adepte de Freud » [1]. Freud lui envoya un exemplaire de L’avenir d’une illusion, avec une dédicace datée du jour de son départ pour l’Angleterre (3 juin 1938). Wittgenstein devint par la suite un critique résolu du célèbre Viennois.
En 1945, il écrit à son ami Norman Malcolm, un philosophe américain qui était venu suivre ses cours à Cambridge : « Moi aussi, j’ai été très impressionné lorsque j’ai lu Freud pour la première fois. Il est extraordinaire. — Bien sûr, il est plein d’idées qui ne sont pas nettes, et son charme et le charme de son sujet sont tellement grands que vous pouvez aisément être mystifié. Il souligne toujours quelles grandes forces dans l'esprit, quels puissants préjugés travaillent contre l'idée de la psychanalyse, mais il ne dit jamais quel charme énorme cette idée a pour les gens, exactement comme elle en a un pour lui. Il peut y avoir de puissants préjugés qui vont contre l'idée de découvrir quelque chose de dégoûtant, mais c'est parfois infiniment plus attrayant que repoussant. À moins que vous ne pensiez très clairement, la psychanalyse est une pratique dangereuse et malpropre, et elle a fait un mal infini et comparativement, très peu de bien. […] Gardez donc bien toute votre tête » (italiques de Wittgenstein, cit. in Bouveresse, p. 12).
Notons en passant que Freud avait envisagé au moins une fois des motivations peu reluisantes de s’intéresser à sa psychanalyse. Il avait confié à Ludwig Binswanger : « J'ai toujours pensé que se jetteraient tout d'abord sur ma doctrine les cochons et les spéculateurs » [3].
Les critiques de Wittgenstein sont allées en s’amplifiant. Parmi ses critiques, nous en présentons brièvement cinq.
La confusion des« raisons » et des « causes »
Wittgenstein dit que la confusion des raisons et des causes est la confusion philosophique par excellence.
On peut croire trouver la raison pour laquelle on rit, mais il n'est pas sûr qu'on ait trouvé la véritable cause.
C'est une confusion de dire qu'une raison est une cause vue de l'intérieur. Une cause n'est pas vue de l'intérieur ou de l'extérieur. Elle est découverte par l'expérience.
Le fait que l’analysé soit d'accord avec le psychanalyste ne prouve pas la découverte des véritables causes du comportement.
Les raisons « inconscientes » ne se trouvent pas — dissimulées — dans un lieu appelé « inconscient » en attendant d'être autorisées à apparaître à la conscience. Elles apparaissent comme des raisons simplement parce qu'on les considère comme telles.
Les freudiens se trompent quand ils utilisent un langage causal.
La mythologisation de l’inconscient
Pour Freud, la conscience perçoit des événements qui ont lieu dans une espèce d’espace intérieur. Certains de ces évènements sont facilement perçus, mais d’autres ne peuvent se percevoir que grâce à sa technique.
Freud fait de l’inconscient un agent occulte qui a ses propres désirs, volontés, motifs, intentions, finalités, ruses et stratégies, qui est en mesure d'atteindre ses objectifs avec une intelligence, une habileté et une sûreté souvent très supérieures à celles de la personne à l’intérieur de laquelle il se trouve. Tout en ignorant en principe la logique et ses règles, cet acteur interne se révèle soi-disant capable de raisonnements d'une grande subtilité.
C’est ce que Wittgenstein appelle « l’erreur de homunculus » : postuler l’existence d’un auteur à l’intérieur de la personne et utiliser des prédicats applicables seulement à des êtres humains ou à des animaux.
Les généralisations et les essentialisations
Dans le chapitre intitulé « La pulsion de généralité », Bouveresse écrit :
« Une des caractéristiques les plus constantes de la démarche de Freud est sa conviction remarquable qu'il peut être suffisant d'examiner un seul cas bien choisi ou un très petit nombre de cas pour accéder immédiatement à la connaissance de ce qui est fondamental et essentiel et qui doit nécessairement se retrouver dans tous les autres cas. Freud raisonne comme un homme qui est convaincu qu'une fois que l'on aura accepté la bonne explication (la sienne), on se rendra compte qu'il n'y a fondamentalement qu'une seule espèce d'hystérie, de rêve, de lapsus, de mot d'esprit, etc. Il se comporte donc, aux yeux de Wittgenstein, non pas comme le ferait un scientifique proprement dit, mais plutôt comme un philosophe qui est convaincu de devoir et de pouvoir expliquer les ressemblances qui existent entre une multitude de cas qui peuvent également, par ailleurs, être très différents les uns des autres, par la reconnaissance (ou plutôt la postulation) de l'existence d'un état de choses extrêmement général qui leur est commun à tous, mais qui est dissimulé à une certaine profondeur sous la diversité des apparences » (p. 78).
J’ajoute qu’un exemple remarquable est l’universalisation par Freud de son complexe d’Œdipe.
Après qu’une lettre de Fliess ait ramené à Freud un souvenir d’excitation à la vue de sa mère nue, il conclut que tous les êtres humains désirent sexuellement le parent de sexe opposé. Pour des détails sur cette surprenante généralisation :
L’interprétation des rêves
Freud écrit, dans sa lettre du 12-6-1900 à Fliess, qu’il avait découvert d’un seul coup l’« essence » des rêves. Il poursuit : « Crois-tu vraiment qu’il y aura un jour sur cette maison une plaque de marbre où on pourra lire : “Ici se dévoila le 24 juillet 1895 au Dr Sigmund Freud le mystère du rêve” ? ». Ce jour-là, il avait analysé le rêve intitulé « l’injection à Irma », qui sera l’exemple princeps du livre L’interprétation du rêve. Sa conclusion était que le rêve est la réalisation d’un désir (notons que dans ce rêve le désir n’avait rien de refoulé).
Dans un manuscrit envoyé à Fliess peu après, le 8-10-1895, Projet d’une psychologie, il écrit : « La finalité et le sens des rêves peuvent être établis avec certitude. Ils sont des accomplissements de souhait ». Il n’évoque guère des rêves de patients. Son expérience personnelle a suffi pour une « certitude ». Comme pour le complexe d’Œdipe, il généralise à partir d’une expérience personnelle et pense avoir découvert l’essence d’un phénomène psychique. Le titre du livre sera « L’interprétation du rêve » (Die Traumdeutung) et non « des rêves ».
Wittgenstein estime que les écrits de Freud sont intéressants pour comprendre des erreurs philosophiques : affirmer des essences alors qu’il s’agit seulement d’une hypothèse, « uniquement une bonne façon de présenter un fait ».
Selon Wittgenstein, Freud fait sous le nom de « science » de la mauvaise philosophie, il érige en vertu scientifique des vices caractéristiques du comportement philosophique : croire qu’il n’y a qu’une espèce de rêve, de lapsus, de mot d’esprit.
Wittgenstein souligne que le rêve est typiquement le genre d'objet qui donne l'impression de « dire » quelque chose sur un mode plus ou moins énigmatique. Nous sommes dès lors disposés à accepter une reconstruction plausible et ingénieuse de ce que le rêve pourrait vouloir dire. Ce qui est problématique c’est l'idée que cette chose, qu'il nous semble vouloir dire, a été réellement dite, à l'insu du rêveur, au moment du rêve.
Wittgenstein ne croit pas qu'il existe une méthode d'interprétation qui soit susceptible et seule susceptible de nous révéler ce que le rêve signifiait réellement au moment où il a eu lieu, ce que Freud appelle « le sens profond et réel » du rêve.
L'embryon de sens que comporte en quelque sorte le rêve demande à être développé et complété, mais, contrairement à ce que suppose Freud, rien ne prouve que la manière dont il peut l'être soit déterminée de façon univoque. Le fait que nous réussissions à établir après coup un sens à un arrangement de type (plus ou moins) linguistique, qu’il n’avait pas à première vue, ne signifie nullement qu'il a été utilisé avec ce sens.
Le récit du rêve, dit Wittgenstein, est de la nature d'« un fragment qui nous impressionne fortement (parfois, en tout cas), de sorte que nous cherchons une explication, des connexions » (Culture and Value, p. 83). Mais cela n'implique pas que la question du pourquoi et de la provenance, que nous aimerions poser à propos de chacun des éléments du rêve, ait toujours un sens et une réponse.
« Lorsqu'un rêve est interprété, dit encore Wittgenstein, nous pourrions dire qu'il est intégré à un contexte dans lequel il cesse d'être énigmatique. En un sens le rêveur re-rêve son rêve dans un environnement tel que son aspect change » [4]. Le rêve n'est pas « analysé scientifiquement », comme nous pouvons analyser une substance chimique pour découvrir ses constituants réels [5]. Le rêve est en quelque sorte rêvé à nouveau dans un contexte modifié et donc transformé en un autre rêve dont il constitue le point de départ et le prétexte.
Freud persuade par des spéculations
Wittgenstein reproche à Freud notamment de se présenter toujours comme un scientifique alors qu’il ne fournit que des « spéculations », qu’il chosifie l’inconscient, qu’il confond des raisons imaginées avec les causes réelles de comportements et de rêves…
En un mot, il déplore que « Les pseudo-explications fantaisistes de Freud (précisément parce qu'elles sont brillantes) rendent un mauvais service. (Maintenant, n'importe quel âne a ces images à sa disposition pour “expliquer” les symptômes d'une maladie ») [6].
A Vienne, Wittgenstein avait des amis et des connaissances qui lui avaient permis de juger de l’efficacité de la psychanalyse freudienne. Il écrivait à ce sujet : « L'analyse peut être nocive. Elle peut permettre de découvrir différentes données sur soi-même, mais il faut avoir un sens critique solide et pénétrant pour reconnaître et dépasser la mythologie qui est proposée ou imposée. La tentation existe de dire : “Oui, bien sûr, il doit en être ainsi.” Cette mythologie est puissante. » [7].
————
[1] Mon texte est largement redevable au livre de Jacques Bouveresse : Philosophie, mythologie et pseudo-science. Wittgenstein lecteur de Freud. Paris : Éd. de l'éclat, 2006, 191 p.
[2] Bouveresse p. 15.
[3] Binswanger, L. (1970) Discours, parcours et Freud. (Trad.), Gallimard, 1970, p. 10.
[4] Lectures and Conversations, p. 45.
[5] Rappelons que Freud dit avoir appelé sa méthode « psychanalyse » « parce que “analyse” — qui signifie démontage, décomposition — fait penser à une analogie avec le travail du chimiste sur les substances qu’il trouve dans la nature ». Pour lui, « toutes les activités psychiques sont d’une nature hautement composée » et le travail de l’analyste est de les « ramener aux motions pulsionnelles qui les motivent » (Gesammelte Werke, XII 184).
[6] Culture and Value. Trad., Blackwell, 1980, p. 55.
“Freud's fanciful pseudo-explanations (precisely because they are brilliant) perform a disservice. (Now any ass has these pictures available to use in "explaining" symptoms of an illness”.
[7] Wittgenstein L. (1966) Leçons et conversations sur l'esthétique, la psychologie et la croyance religieuse. Trad. Gallimard, 1971. Extraits publiés dans Freud. Jugements et témoignages. Textes présentés par R. Jaccard, P.U.F., 1976, p. 266.



