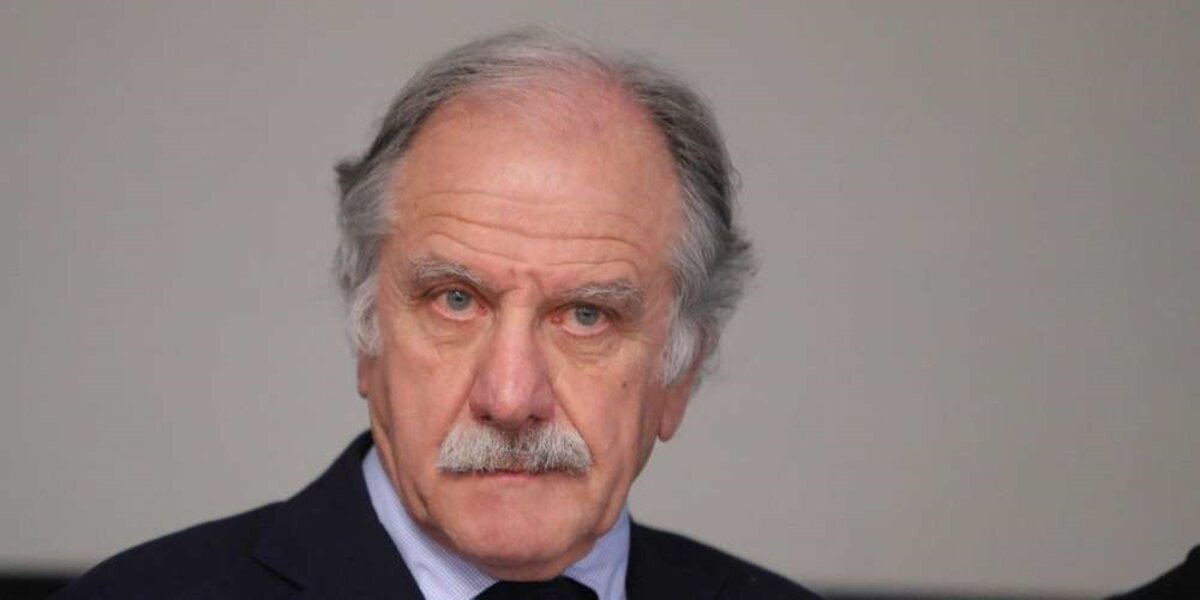
Agrandissement : Illustration 1
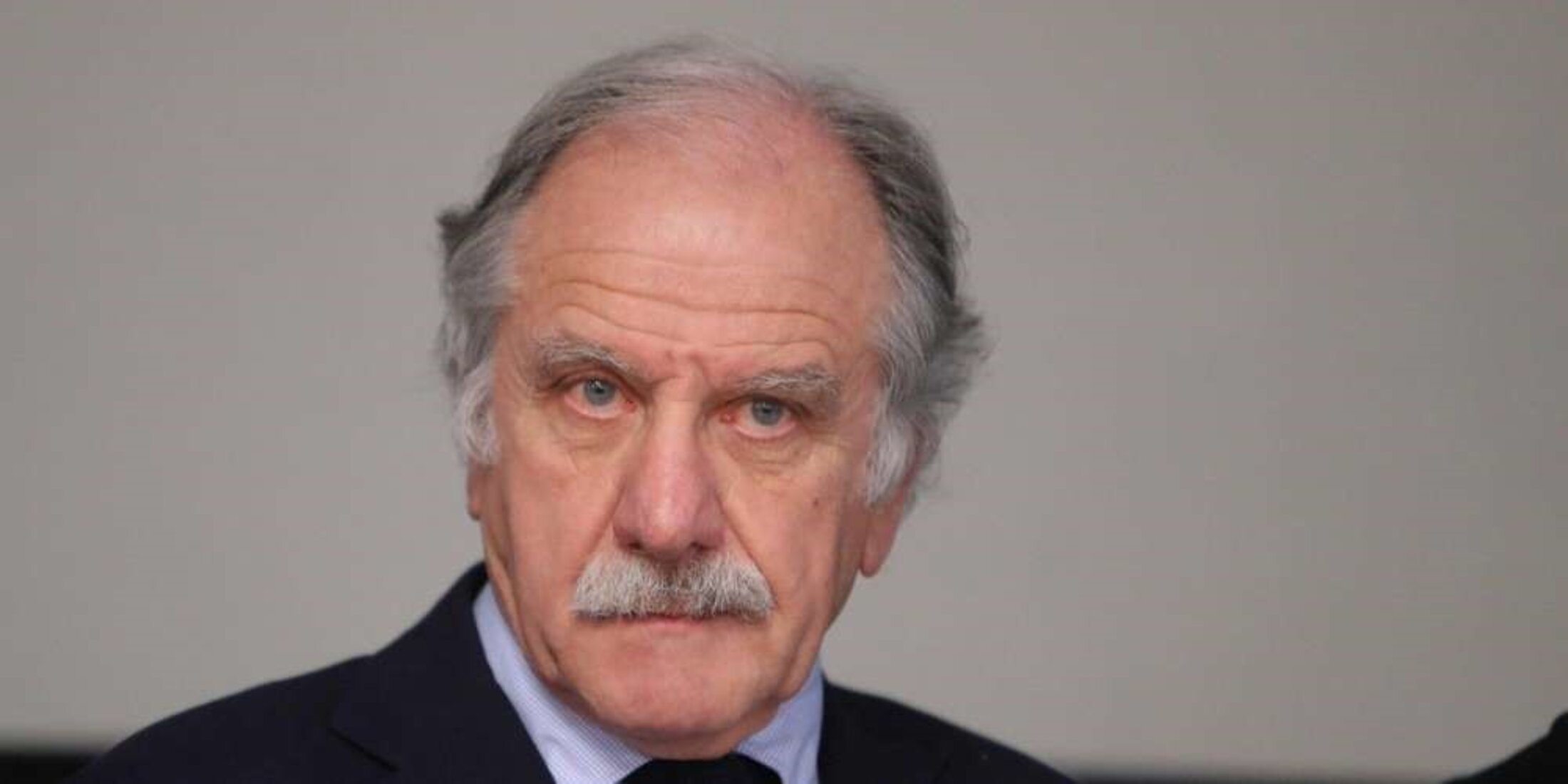
« Il n’y a plus d’après, la catastrophe est là ». Dans une tribune publiée hier 16 avril sur le site Reporterre, l’écologiste Noël Mamère disqualifie sans appel la moindre tentative pour penser à quoi pourrait ressembler le fameux « jour d’après » :
« Au moment où philosophes, sociologues, économistes, think-tanks et politiques phosphorent sur le « jour d’après » et pensent « le monde d’après », il n’est pas inutile de s’interroger sur les limites de cet exercice en forme d’exorcisme. (…) Nous savons tous que demain ressemblera à aujourd’hui et que « les jours d’après » risquent d’être pires que ce que nous avons connu jusqu’à ce violent choc planétaire qui devrait nous valoir avertissement. (…) La seule question qui est devant nous est : comment allons-nous faire pour nous adapter aux bouleversements que nous avons provoqués ? »
Curieux, de la part de quelqu’un qui a écrit (avec Patrick Farbiaz) un ouvrage intitulé « Changeons le système, pas le climat » (Flammarion, 2015), de venir aujourd’hui vanter les vertus de la seule « adaptation ». Est-ce bien le même Noël Mamère qui vient de cosigner, avec 44 militant.e.s politiques, syndicaux, associatifs, intellectuels, chercheurs, « l’appel à ne pas redémarrer pour tout recommencer » ? (lire ICI).
Dans sa tribune pour Reporterre, Noël Mamère poursuit :
« Nous pouvons toujours nous évertuer à « penser » le monde d’après tout en sachant qu’il n’y a plus d’après. Dans notre « novlangue » d’aujourd’hui « après » veut dire « encore ». Ça rassure et apaise, mais ce n’est qu’un peu de brouillard en plus sur la montagne de nos angoisses existentielles. (…) Parce que le monde d’aujourd’hui a préempté celui de demain, « penser le monde d’après » ressemble à une grande opération de diversion qui permet d’éviter d’accepter toute la vérité sur ce que nous avons fait subir à notre milieu de vie. »
Sauf le respect que je devrais à l’ancien journaliste devenu maire de Bègles, voilà qui me fait penser à la figure du vieux sage devenu, au crépuscule de sa vie, vieux con brandissant sa canne et vociférant : « Je vous l’avais bien dit ! »
« Plus jamais ça »
Oui, Noël Mamère l’avait bien dit, que nous allions dans le mur. Et bien d’autres avec lui, bien d’autres avant lui, au moins depuis René Dumont, premier candidat écologiste à l’élection présidentielle, en 1974. René Dumont fit alors 1,32 % des voix (voir ICI). Et je suis bien placé pour savoir que la parole écologiste a eu du mal à percer la croûte de la propagande. Dans la jeunesse de mes années étudiantes, je militais simultanément au PSU et aux Amis de la terre. Nous n’étions guère nombreux, et sur les marchés où nous rendions, nous étions perçus comme des extraterrestres, ou quasi.
Aujourd’hui, l’écologie est devenue omniprésente dans le débat public. Sans parvenir encore à inverser radicalement la donne. La fiction d’un « développement durable » tient encore lieu de boussole. Mais les conséquences inattendues de la crise planétaire du coronavirus pourraient bien contribuer à changer les règles du jeu. A condition, évidemment, de ne pas céder aux sirènes de ceux qui voudront, à l’issue du confinement, « revenir à la normale » (avant, ce n’était pas du tout « normal ») et relancer dare-dare la machine économique. Il va de soi que nous n’accordons aucune confiance à une « rupture » sortant de la bouche de l’actuel président de la République : nous ne savons que trop que ce n’est là que communication et enfumage.
Une tout autre rupture est préfigurée par l’appel « Plus jamais ça », lancé par 18 responsables d’organisations syndicales, associatives et environnementales, de la CGT et de la FSU jusqu’à Alternatiba en passant par les Amis de la Terre, Attac, la Confédération paysanne, Greenpeace, Oxfam France, l'Union syndicale Solidaires, 350.org, Action Non-Violente COP21, le CCFD-Terre Solidaire, Droit au Logement, la FIDL, la Fondation Copernic, le Syndicat de la magistrature, l’UNEF et l’UNL. Ces organisations réclament « de profonds changements de politiques », pour « se donner l'opportunité historique d'une remise à plat du système, en France et dans le monde ». Excusez du peu. A ce jour, on n’a pas entendu M. Mamère, ni aucun de ses camarades politiciens écologistes, relayer cet appel.
L’alerte ne suffit pas
L’écologie politique a sans doute des vertus. La politicaillerie écologiste a échoué, et c’est peut-être là-dessus que M. Mamère (5,25 % des voix à l’élection présidentielle de 2002) devrait s’interroger.
A titre personnel, je fus tenté, voici quelques années, de trahir ma promesse de ne plus adhérer à quelque parti politique que ce soit et de rejoindre Europe Ecologie Les Verts. Une seule réunion m’en a dissuadé : j’y ai vu les mêmes travers organisationnels, les mêmes enflements d’ego, que partout ailleurs.
Plus largement, pourquoi les mouvements écologistes ont-ils échoué à devenir majoritaires, y compris ces dernières années, alors que grandissait la prise de conscience face à l’urgence climatique ? Parce que l’alerte ne suffit pas. Citant le « catastrophisme éclairé » de Jean-Pierre Dupuy, Noël Mamère le dit lui-même : savoir n’est pas croire.
Que faut-il donc, pour y « croire » ? De l’imaginaire, du récit, de la fiction, du conte.
Mamère et autres politiciens professionnels de l’écologie ne lisent pas assez de poésie, voilà tout.
Or, imaginer, c’est déjà penser.
« Prendre soin » (ou prêter attention) se dit, en espagnol, « cuidar », dont l’étymologie renvoie au latin « cogitere ». Soigner et penser ont racine commune.
Penser le « jour d’après » (vite dit, il n’y aura évidemment pas un seul jour), c’est permettre qu’il advienne.
Chacun.e sent confusément qu’au jour d’après plus rien ne sera comme avant (vite dit, car plein de choses auront lieu come avant : par exemple, le soleil continuera en général de se lever le matin et de coucher en soirée). Chacun.e, confusément, peut désirer ce jour d’après ; mais tout autant et le redouter, car cet inconnu est inconnu. On craint de « lâcher la proie pour l’ombre » (revenir à la bougie), et de toute façon l’inconnu fait peur. D’autant que nous savons, intuitivement, que ce « jour d’après » apportera dans ses filets la nécessité d’une « obéissance consentie » (comme disait Simone Weil) à de nouvelles règles. Ne pas en avoir peur, c’est montrer en quoi cette « obéissance consentie » n’est en rien synonyme de la « servitudes volontaire » dont parlait La Boétie.
Ne pas en avoir peur, c’est entreprendre dès maintenant le récit de ce « jour d’après » que l’on ne connaît pas encore. Faire émerger une intelligence collective : de l’intelligence, il n’y en aura jamais en trop.
C’est sur la base de tels préceptes que j’ai contribué, avec d’autres, à créer sur le site de Mediapart, le blog Au jour d’après, atelier d’écritures en voix mêlées du Tout-monde pour gouverner le futur. Les textes déjà publiés (Raoul Vaneigem, Michel Maffesoli, Bruno Tackels, Jean-Claude Grosse) ou à venir, qui réunissent personnalités connues et « gens de la moyenne » (comme chantait Colette Magny) sont des semences pour nourrir notre faim d’avenir. Et rien, dans cette foison de textes, n’est programmatique.
Cette initiative est loin d’être isolée : l’excellente série Le monde d’après lancée par Mediapart, les « tracts de crise » des éditions Gallimard, ou encore, pour ne pas confiner franco-français, le projet Nouvelles cartographies- Lettres du « Tout-Monde », lancé par le Labo148 et africultures.com, etc, etc.
Tout cela, aux dires de M. Mamère, ne serait donc que « grande opération de diversion » ? Eh bien soit. Diversion : « opération militaire destinée à détourner l’ennemi d’un point » (Petit Robert). Si l’ennemi est ce « jour d’après » que nous préparent Emmanuel Macron et ses thuriféraires (pour ne parler que de la France), et de façon générale, les toujours-les-mêmes-qu’avant ; alors, détournons son attention vers des bases lointaines pour mieux attaquer ses fondations (ce qu’il en reste, tant ça s’effrite).
Ce sera camp contre camp (comme dirait le cerbère Lallement).
Le camp d’en face a déjà passé commande de grenades de désencerclement, LBD et autres gaz lacrymogènes.
Nous aussi, nous devons nous armer.
N’en déplaise à M. Mamère, la pensée, ce sont des munitions. Pour maintenant et pour après.



