Le refus du code pénal
Le 15 décembre dernier, le vice-président Álvaro García Linera a promulgué la loi 1005 intitulée Código del Sistema Penal boliviano, bien que les médecins et les personnels de santé du secteur public se soient mis en grève à compter du 23 novembre pour demander l’abrogation d’un article qui criminalise les fautes médicales (por mala práctica ). Le gouvernement a joué ouvertement le pourrissement du mouvement protestataire en comptant sur la grogne des usagers. Il a orchestré une campagne de diffamation contre l’ordre des médecins, créé un ordre parallèle et passé contrat avec le régime cubain afin qu’il envoie un contingent de personnels de santé pour briser la grève de leurs collègues boliviens. Un large soutien populaire et celui des transporteurs qui menaçaient de mettre en place des barrages routiers a amené Evo Morales à demander le retrait de deux articles de la loi : le 205 criminalisant les fautes médicales, et le 137 aggravant les sanctions pour les coupables d’accidents de la route. Dans le même mouvement, il a annoncé que deux articles seraient modifiés : le 293, relatif au délit de sédition et le 294 qui pénalise ceux qui s’attribuent indûment les « droits du peuple », particulièrement combattus par les Comités civiques[1], les représentants de l’opposition et les collectifs citoyens.
En conséquence, les médecins et les personnels de santé ont stoppé leur mouvement, après 47 jours de grève. Mais les menaces de sanction et de décompte salarial des jours de grève, qui ne sont pas encore totalement écartées en dépit de nouvelles négociations, font que des poches de résistance subsistent notamment à Cochabamba, Oruro, Santa Cruz et Tarija.
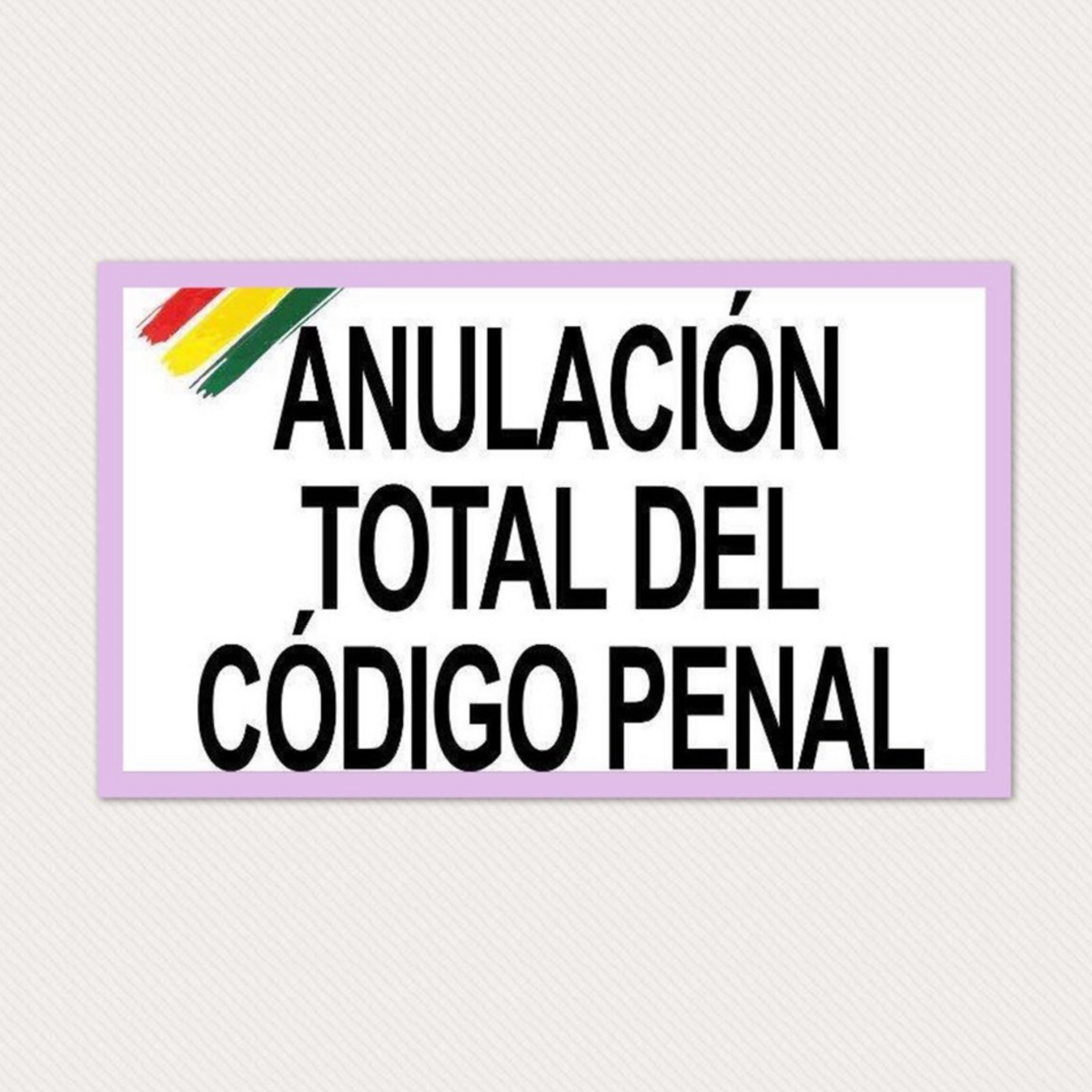
Agrandissement : Illustration 1
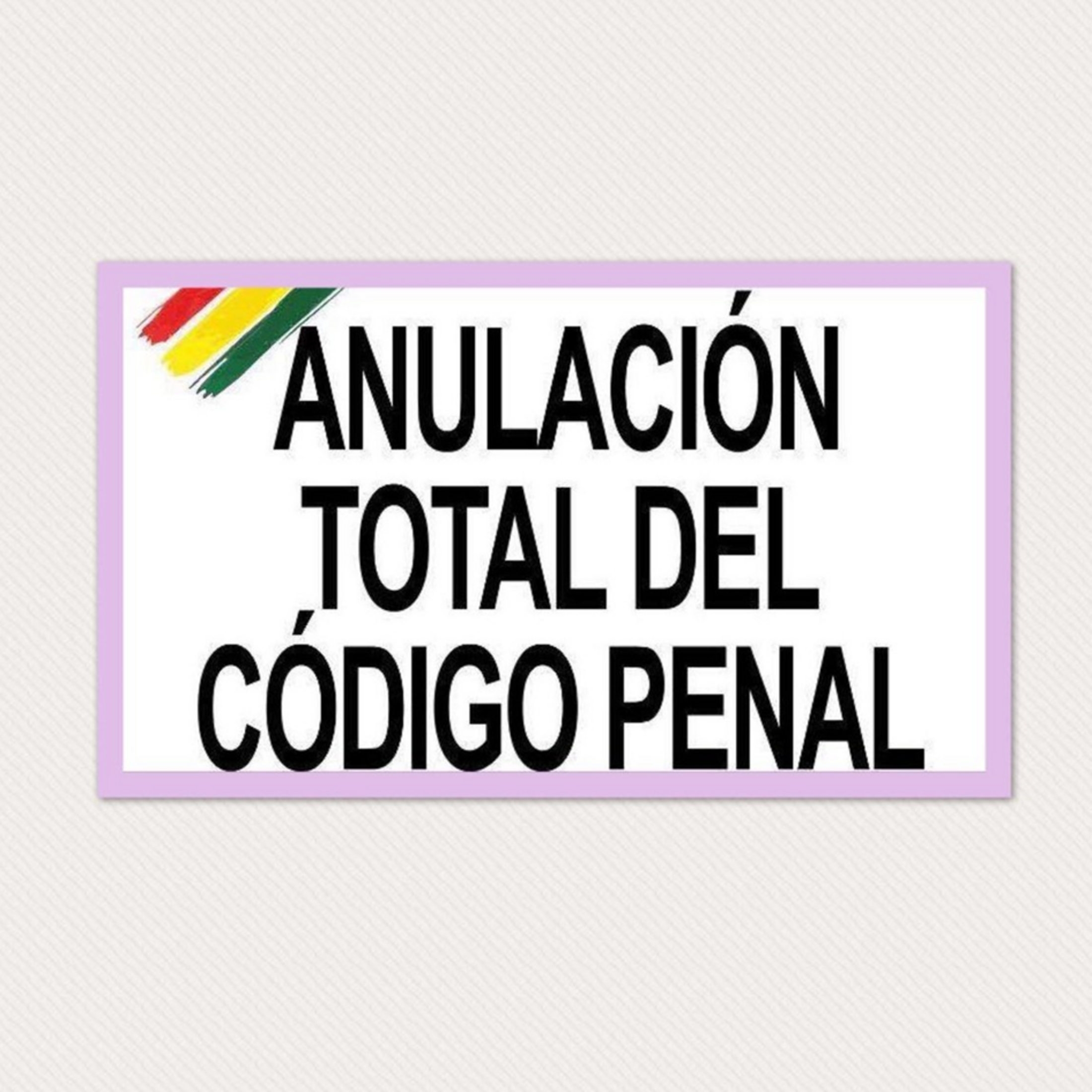
Peu à peu, à la lecture attentive des 700 articles du code, divers secteurs organisés ont tiré la conclusion qu’ils pouvaient être victimes de ces nouvelles dispositions et que, globalement, le code était une machine à réprimer les rétifs, les insoumis, tous ceux qui refusent l’embrigadement et ne sont pas ouvertement alignés sur les positions du régime, en les accablant de procès et donc en suscitant la peur et l’intimidation dans leurs rangs. En somme le nouveau code pénal permettrait de généraliser la méthode qu’appliquent systématiquement les gouvernants pour décourager et éliminer leurs opposants politiques : celle du harcèlement judiciaire[2]. Si bien qu’est née la revendication d’abroger l’ensemble de la loi 1005.
À cette fin, tout l’arsenal des techniques protestataires est utilisé, la grève, on vient de le voir, les rassemblements et défilés, la grève de la faim (de 17 parlementaires de l’opposition[3]), les barrages routiers, les opérations ville morte…Et un ensemble d’organisations, partis, syndicats, Églises, ONG, associations de quartiers, groupements citoyens, comités civiques (qui refont surface), unissent conjoncturellement leurs forces pour demander cette abrogation, et exiger le respect du résultat du referendum du 21 février 2016, contraire à une nouvelle candidature présidentielle d’Evo Morales en 2019.
Jeudi 11 janvier, les rues du centre de La Paz ont été complètement bloquées : les unes par la police pour que la caravane du rallye Paris Dakar puisse passer ; les autres par les rassemblements et les défilés des manifestants dont les quatre marches ont conflué sur la place San Francisco (celle de la Centrale ouvrière bolivienne(COB), celle de l’Université Mayor de San Andrés, celle de l’Association départementale des producteurs de coca (ADEPCOCA), et celle des médecins et personnels de santé ; et les alentours de la place Murillo ( la place du Palais présidentiel et de l’Assemblée nationale) où le président Morales festoyait le jour national de l’acullico (mastication de la feuille de coca), en compagnie de producteurs, et de groupes affins[4].
Après que les manifestants eurent brûlé le code pénal et un mannequin symbolisant le gouvernement au cri « À mort le code pénal »[5], puis que divers orateurs se soient exprimés, le rassemblement a été dispersé par la police à coup de grenades lacrymogènes. Des manifestants ont été acculés dans l’église San Francisco où il été procédé à des arrestations[6]. D’autres manifestants qui tentaient de bloquer la voie de passage du rallye ont été, eux aussi, délogés – d’autant plus facilement que la pluie battante avait éclairci leurs rangs.
Il y a eu des manifestations de type divers dans tous les départements, excepté celui du Pando. Santa Cruz a connu son rassemblement le plus spectaculaire depuis les mobilisations en faveur de l’autonomie du département de l’année 2006 (cabildo autonomico )[7] ; un rassemblement organisé par un groupe d’ anciennes élèves d’un collège et convoqué par WhatsApp et Facebook. Dans l’après-midi, elles avaient réussi à joindre 76 collèges qui ont drainé entre cinq et 40 promotions chacun. Si bien que le centre-ville était totalement congestionné[8].
Le passage du rallye Paris Dakar en Bolivie[9] a été l’occasion de donner un écho inhabituel à ces protestations et de révéler à la face du monde l’organisation naissante d’une résistance à l’égard du régime d’Evo Morales. Un des compétiteurs bolivien du rallye, dans la catégorie quad, a profité audacieusement de la tribune qui lui était offerte pour demander à Evo Morales de respecter la Constitution et les résultats du referendum de 21 février 2016[10].
La défense de la démocratie
Trois aspects de cette protestation me paraissent dignes d’être retenus. Tout d’abord la renaissance du Comité national de défense de la démocratie (CONADE) qui avait été créé en avril 1980 (gouvernement de Lydia Gueiler Tejada) à la suite de l’assassinat du père jésuite Luis Espinal (le 22 mars précédent), pour contrer le coup d’état militaire qui s’annonçait. Une initiative avisée, mais malheureuse puisqu’au moment du coup d’état du 18 juillet 1980 qui porta Luis Garcia Meza à la présidence, la direction du CONADE réunie dans les locaux de la COB pour organiser une riposte à l’alerte de putsch qui venait d’être lancée, fut capturée par surprise par un commando de paramilitaires. La plupart des présents furent emprisonnés, tandis que deux dirigeants ouvriers et Marcelo Quiroga Santa Cruz, leader du Parti socialiste, étaient froidement assassinés.
Le nouveau Comité regroupe la Centrale Ouvrière bolivienne (COB), l’Assemblée permanente des droits de l’homme (APDHB), le Conseil national de défense des droits constitutionnels (CONDECOB) dirigé par l’ex magistrat Gualberto Cusi, les Fondations d’inspiration catholique Jubileo et Caritas, Le Consejo nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), l’Universidad Mayor de San Andrés et celle de El Alto (UPEA), la confédération d’enseignants universitaires de Bolivie, et d’autres organisations ou associations.
Il se donne pour objectif de surveiller, défendre, promouvoir les droits de l’homme et les garanties constitutionnelles démocratiques.
Cette renaissance montre que la COB est entrain de récupérer son autonomie. Et elle manifeste clairement une volonté de coordonner les manifestations d’opposition au gouvernement. Mais il reste beaucoup à faire pour rapprocher les positions des uns et des autres, notamment pour ce qui concerne leur conception de la démocratie. Il suffit de regarder la banderole de la COB déployée au moment du défilé du 11 janvier pour s’en convaincre. Qu’y voit-on au centre ? Le portrait emblématique de Che Guevara.

Ajoutons que les slogans “Esto es Bolivia/No Venezuela”, “Democracia si/ dictadura no”, que l’on a entendu dans les cortèges, ne doivent pas cacher le fait que les opposants au code pénal représentent des secteurs très divers qui, pour beaucoup organisés à la manière de corporations, défendent leurs intérêts propres. Ils ne sont unis qu’en raison de leur hostilité aux gouvernants ou à certaines de leurs décisions. Par exemple, les planteurs de coca du département de La Paz ne sont là que parce qu’ils s’opposent à la décision de légaliser la production des cultivateurs de la région du Chaparé, dévoués au chef de l’État ; ils rêvent de revenir à la situation antérieure quand ils étaient les seuls à commercialiser la coca destinée à la consommation par mastication, et ne décolèrent pas contre Evo Morales. Et il en va ainsi d’autres secteurs corporatifs comme les transporteurs, les commerçants, les mineurs des coopératives…
Les comités civiques connaissent, eux aussi, une nouvelle jeunesse à l’occasion de ces protestations parce que les secteurs mobilisés de la population les appellent à chapeauter des manifestations spectaculaires et massives. Celui de Santa Cruz a encadré avec succès la journée ville morte du vendredi 12, et la mesure a été suivie dans la plupart des capitales des quinze provinces du département. On n’avait pas vu pareille mobilisation civique depuis 2006[11].
Le comité civique de Potosi est sûrement celui qui est resté le plus actif depuis l’arrivée du MAS au pouvoir. Il a mobilisé la ville à plusieurs reprises pour tenter d’obtenir des équipements et des aménagements de la part du gouvernement central. Vendredi 12, il a appelé avec succès à cesser toutes les activités et il a décidé de se joindre au CONADE. La centrale ouvrière départementale a quant à elle déclenché une grève de 48 heures.
Et l’appel civique semble devoir faire tache d’huile. À Trinidad (Beni), six groupements citoyens, les personnels de santé et des représentants ayant défilé le 12 janvier pour manifester leur refus des dictats gouvernementaux exigent du comité civique local qu’il organise une journée ville morte (un paro cívico). « Le gouvernement moral de notre département doit être en accord avec la prise de position de la population » clame un responsable de l’organisation citoyenne Construyendo Futuro. La fédération des organisations de quartier (Federación de Juntas Vecinales) de El Alto appelle à cesser toute activité « paro de actividades » le 14 janvier, et le comité civique de Cochabamba lance le même appel pour le 16 janvier.
Mais c’est surtout la naissance et l’activité des groupes citoyens à l’occasion des dernières élections nationales (referendum du 21 février 2016 et élections des hauts magistrats de décembre dernier) et leur présence lors de ces protestations qu’il me paraît important de souligner. Ces groupes sont nés en dehors des partis. Ils visent explicitement le respect des normes démocratiques. Ils sont dirigés et composés, majoritairement, par des jeunes. Et ils mobilisent et coordonnent leurs adhérents en utilisant les réseaux sociaux. Ils sont répartis sur l’ensemble du territoire urbain. Enfin comme on l’a vu, les jeunes femmes y prennent une part importante voire prépondérante[12], à tel point qu’à Santa Cruz, ce sont elles qui ont réveillé une ville que le gouvernement avait réussi à assoupir par un mélange de répression et de prébendes. On les a vues manifester à plusieurs reprises depuis le début du mois de décembre dernier pour s’opposer à la sentence du Conseil constitutionnel autorisant Evo Morales à se représenter à la présidence en 2019. Elles ont créé le mouvement Mujer Fuerte qui a maintenant des antennes dans les autres villes.
Tous ces groupes, expriment non seulement une lassitude à l’égard du gouvernement de Morales, et un refus de son autoritarisme, mais aussi la volonté de vivre dans une société pacifiée et moins corrompue. Ce n’est pas un hasard si le manifeste des lycéennes de Santa Cruz qui ont organisé le regroupement du 11 janvier comprend non seulement le refus du code pénal et le respect du résultat du referendum, mais aussi la lutte effective contre le trafic de drogue et contre la corruption.
*
Il est bien sûr difficile de prévoir le futur de cette mobilisation. Cependant, elle est un signe de plus de la perte de crédit du régime qui amorcée en février 2016 avec le rejet de la réforme constitutionnelle ouvrant la porte à une nouvelle candidature d'Evo Morales à la présidence du pays. Toutes les contorsions auxquelles se livrent les gouvernants pour invalider ce vote sont de plus en plus mal acceptées. Si Evo Morales continue d’être suivi dans les campagnes, il perd chaque jour du crédit dans les villes, notamment parmi les jeunes, les étudiants, les professions libérales et au sein des classes moyennes. Et c’est de là que vient la dynamique contestataire la plus constructive et la plus imaginative. Il est donc à craindre que le régime ne puisse se maintenir qu’en accentuant plus encore la répression et les mesures autoritaires.
[1] Institution qui agglomère l’ensemble des organisations civiles (organisations patronales, syndicats, ONG, associations culturelles, sportives…) d’une ville (ou d’une région). Le plus connu est celui de la ville de Santa Cruz de la Sierra, (Comité Pro Santa Cruz), fondé en 1950. Il a servi de modèle à tous les autres.
[2] Divers articles attentent au droit de manifestation ou le criminalise, ou encore mettent en péril la personnalité juridique d’associations ou de groupements.
[3] La grève a commencé le 8 janvier. Un premier abandon pour cause de santé a eu lieu vendredi 12..http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/12012018/registran_primera_baja_de_la_huelga_de_hambre_de_oposicion I y a aussi des enseignants qui observent une grève de la faim pour protester contre les articles 293,294 et 295.
[4] Selon la loi 864, promulguée le 12 décembre 2016 le 11 janvier est déclaré Día Nacional del Acullico ..
[5] http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/12/democracia-dictadura-no-grita-multitudinaria-marcha-166282.html
[6] http://eju.tv/2018/01/policia-reprime-con-gases-e-irrumpe-en-la-iglesia-san-francisco-para-arrestar-a-manifestantes/. Selon le recteur de l’Université certains auraient été gravement blessés et torturés.
[7] http://www.emol.com/noticias/internacional/2006/12/15/239211/bolivia-un-millon-de-personas-en-manifestacion-por-autonomia.html
[8] https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Una-multitud-desborda-la-plaza-sin-politicos-en-la-vispera-del-paro-civico-20180112-0011.html
[9] Sur ce sujet, voir mes précédents billets : https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-lavaud/blog/311216/dakar-2017-le-rallye-indecent ; https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-lavaud/blog/140117/le-passage-du-dakar-en-bolivie-le-bilan
[10] http://eju.tv/2018/01/martinez-dios-me-puso-en-posicion-de-poder-hablarle-al-presidente/
[11]http://www.eldeber.com.bo/seccion/santacruz; http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/13/santa-cruz-paro-favor-desemboca-agenda-cvica-166422.html Le 10 janvier les villes de Tarija et de Guayaramerin (Beni) avaient elles aussi été paralysées par des grèves civiques.
[12] http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Una-multitud-desborda-la-plaza-y-sin-politicos-20180112-0011.html



