thetransmitter.org Traduction de "The spectrum goes multidimensional in search of autism subtypes" - 14 août 2025 - Katie Moisse
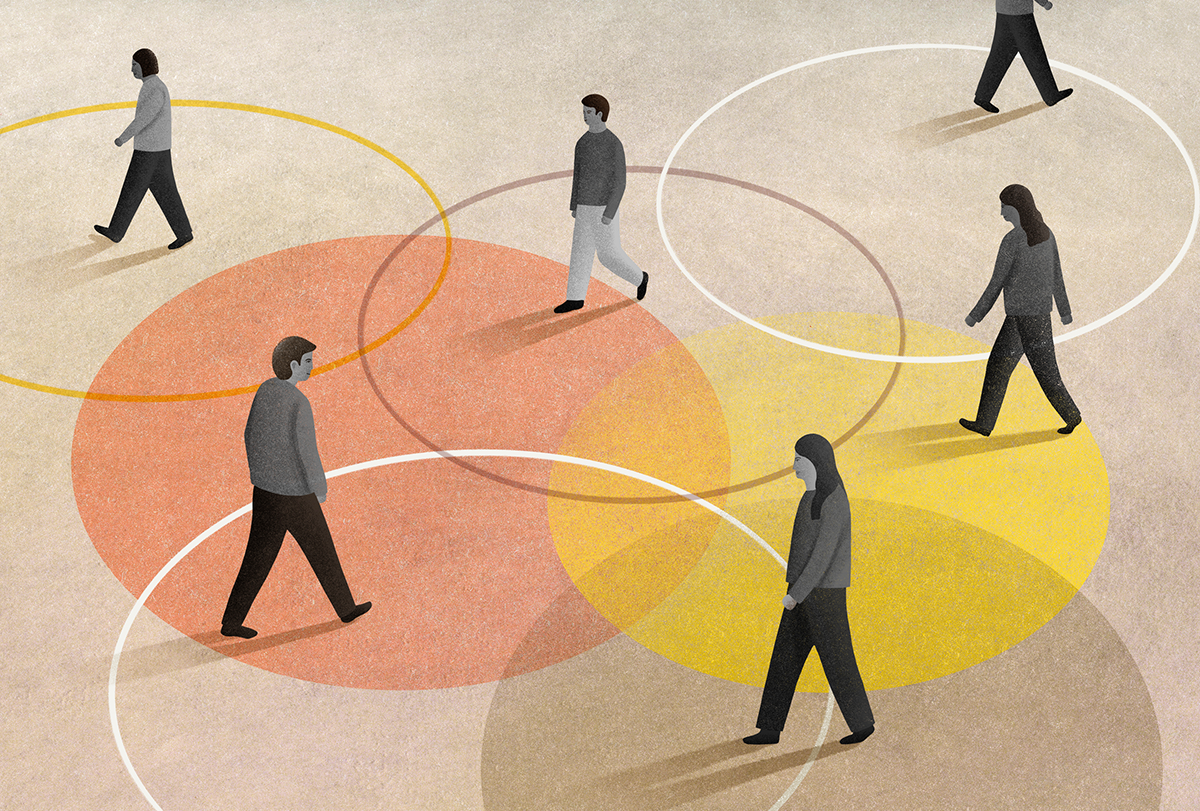
Agrandissement : Illustration 1
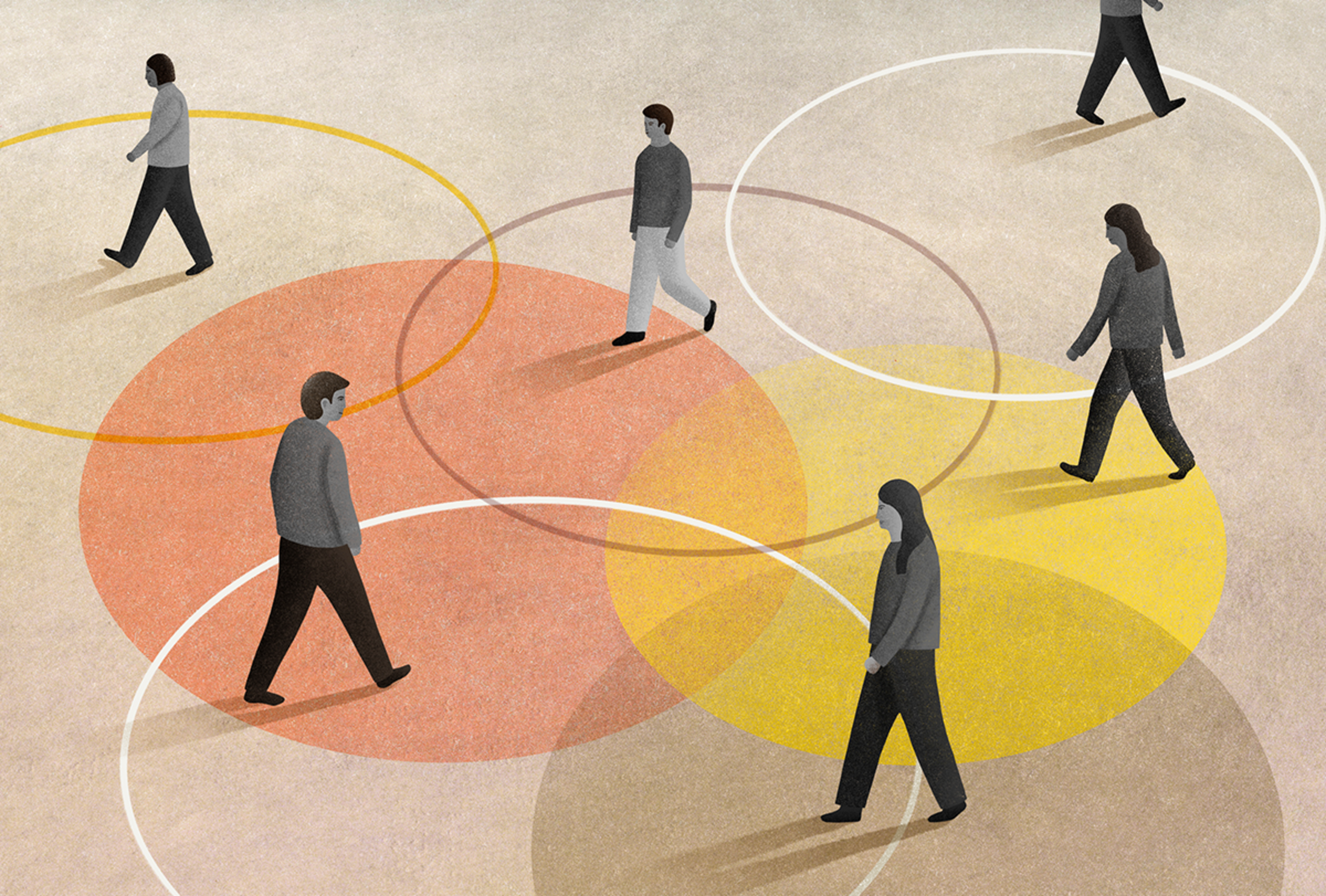
L'autisme est connu pour ses manifestations variées. Par définition, toutes les personnes autistes ont des difficultés de communication sociale, mais celles-ci peuvent varier de légères à profondes. Beaucoup souffrent de troubles concomitants, tels que l'anxiété ou le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). Certaines ont des régions cérébrales atypiquement grandes ou petites, ou des connexions entre les régions cérébrales atypiquement fortes ou faibles. Et pour couronner le tout, certaines ont des anomalies génétiques, tandis que d'autres n'ont pas de cause évidente.
Cela fait 31 ans que les chercheurs ont adopté le terme « spectre » pour décrire l'hétérogénéité de l'autisme. Mais l'idée d'un spectre unique ne permet pas de saisir les nombreuses dimensions de l'autisme, explique Matthew Siegel, chef de l'entreprise clinique du département de psychiatrie et de sciences comportementales du Boston Children's Hospital.
« Ce terme ne nous a pas été très utile », déclare M. Siegel. « Nous savons tous que les frontières entre les catégories sont poreuses et imprécises. Mais nous devons essayer de catégoriser les personnes et de comprendre la complexité, car c'est ainsi que nous progressons. »
Siegel fait partie d'un groupe croissant de chercheurs qui adhèrent à l'idée qu'il existe plusieurs « autismes » plutôt qu'un seul, et qui tentent de catégoriser davantage les personnes autistes en fonction de traits cliniques communs ainsi que de caractéristiques génétiques, physiologiques et neuroanatomiques. Selon Siegel et d'autres, cela permettrait de révéler des mécanismes biologiques communs et d'apporter plus de clarté au pronostic pour les familles.
Cela permettrait également d'améliorer les résultats des essais cliniques en plaçant les participants « dans une catégorie plus homogène qui offre de meilleures chances de résultats », explique Jacob Ellegood, spécialiste en neuroimagerie à l'hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview, qui a utilisé des approches de neuroimagerie pour identifier des sous-groupes d'autisme.
À ce jour, les chercheurs ont exploré des méthodes de regroupement à partir de données génétiques, neuro-imagiologiques et cliniques, et ont développé des groupes de comparaison à partir de modèles animaux, avec un succès quelque peu limité. La difficulté réside dans le fait que les personnes autistes peuvent être regroupées de nombreuses façons, et que la manière dont ces groupes différemment analysés se recoupent et interagissent peut être tout aussi importante que n'importe quel type de regroupement pris isolément.
« Nous devons accepter cette complexité », déclare Alessandro Gozzi, directeur de la neuroimagerie fonctionnelle à l'Istituto Italiano di Tecnologia, qui a également défini de grands sous-groupes de personnes autistes sur la base de la neuroimagerie. « Nous avons besoin de nombreuses modalités de sous-groupes, car chacune d'entre elles n'explique qu'une partie de la variabilité. »
L'idée de sous-groupes n'est pas nouvelle. Les chercheurs le font couramment pour des conditions beaucoup moins hétérogènes. Les chercheurs dans le domaine de l'autisme tentent depuis plus de dix ans d'identifier des sous-groupes sur la base de la génétique en utilisant le séquençage de l'exome entier et, plus récemment, le séquençage du génome entier.
Ces efforts ont révélé certains schémas utiles. Lorsque l'autisme provient de variants du gène CHD8, par exemple, il s'accompagne souvent d'une déficience intellectuelle, d'une hypertrophie crânienne, de retards de langage et de motricité, de troubles du sommeil et de symptômes gastro-intestinaux. Les variants d'autres gènes liés à l'autisme, tels que SHANK3 et ADNP, s'accompagnent de leurs propres constellations de caractéristiques. Cependant, moins de 30 % des diagnostics d'autisme sont liés à des perturbations génétiques spécifiques. Les chercheurs ont donc cherché d'autres moyens de regrouper les personnes autistes qui pourraient partager des caractéristiques biologiques communes. À ce jour, ces projets ont permis d'identifier de nombreux groupes, mais pas nécessairement de manière cohérente ou avec des implications cliniques claires.
Une nouvelle approche, décrite le mois dernier, a permis de classer 5 392 enfants autistes de la base de données SPARK en quatre sous-groupes en établissant un lien entre des caractéristiques cliniques communes et des signatures génétiques distinctes. (SPARK est financé par la Fondation Simons, l'organisation mère de The Transmitter).
Les enfants du plus grand sous-groupe, qui représente 37 % des enfants étudiés, ont des difficultés sociales et des comportements répétitifs, mais ont tendance à atteindre les étapes importantes du développement à peu près au même moment que leurs pairs neurotypiques. Beaucoup d'entre eux présentent des troubles concomitants, tels que le TDAH, l'anxiété, la dépression ou le trouble obsessionnel compulsif. Les enfants du plus petit groupe, environ 10 %, ont tendance à présenter des caractéristiques autistiques plus prononcées et des retards de développement. Ils sont également plus susceptibles que les enfants des autres groupes d'avoir des variantes génétiques rares qui ne sont pas héritées d'un parent.
Ces grands sous-groupes ne sont pas nécessairement définitifs ; comme l'a rapporté The Transmitter, des données supplémentaires pourraient permettre d'affiner davantage les groupes.
Ellegood, Gozzi et d'autres s'intéressent aux approches de sous-groupes qui intègrent l'imagerie cérébrale, car elles sont non invasives et relativement accessibles, ce qui les rend relativement faciles à intégrer dans un bilan diagnostique.
Mais la diversité des méthodologies utilisées dans la littérature sur l'imagerie a soulevé des questions. « De nombreux articles sont publiés sur la classification de l'autisme en sous-groupes, et ils utilisent tous des données et des algorithmes légèrement différents », explique Clara Pecci Terroba, étudiante diplômée dans le laboratoire de Richard Bethlehem au département de psychologie de l'université de Cambridge, qui a étudié ces écarts dans une étude publiée le 4 juin. Dans le cadre de cette étude, deux algorithmes d'apprentissage automatique différents ont été appliqués aux données d'imagerie par résonance magnétique (IRM) structurelle de 4 115 personnes (1 305 autistes, 987 avec TDAH et 1 823 témoins neurotypiques) afin d'identifier deux sous-groupes d'autistes distincts en fonction de la taille globale du cerveau.
Un groupe présentait une surface et un volume de matière grise supérieurs à la normale, tandis que l'autre présentait des valeurs inférieures ; mais selon l'algorithme utilisé, certaines personnes changeaient de groupe, ont constaté les chercheurs. Et lorsque l'équipe a recherché des différences dans des zones cérébrales spécifiques, de nouveaux groupes sont apparus.
« Cela nous indique que nous devrions peut-être passer un peu plus de temps à essayer de comprendre ce que font les algorithmes et ce qu'ils détectent », explique Pecci Terroba.
Même si les algorithmes ont produit des sous-groupes cohérents, les différences de surface cérébrale et de volume de matière grise ne révèlent que peu de choses sur les mécanismes sous-jacents de l'autisme, explique M. Siegel. « C'est comme essayer de répondre à la question « Qu'est-ce qui fait rouler cette voiture ? » en décrivant la taille de la voiture et l'épaisseur du métal », explique M. Siegel. « Ce sont des paramètres, mais vous apprennent-ils vraiment quelque chose sur ce qui fait rouler la voiture ? »
Néanmoins, l'identification de signaux reproductibles dans le bruit des données de neuroimagerie est une première étape cruciale, explique M. Gozzi. Ensuite, « nous devons décoder ces signaux en mécanismes plausibles et vérifiables ».
C'est là que les études combinant des analyses humaines et animales peuvent être utiles, explique-t-il. Par exemple, quatre groupes émergent lorsque l'on compare les données IRM structurelles de personnes autistes et les analyses moléculaires de modèles murins [de souris] d'autisme, selon une prépublication d'Ellegood, Gozzi et leurs collègues, publiée sur bioRxiv en mars. Les chercheurs envisagent de pouvoir utiliser les regroupements de modèles murins comme points de référence pour développer des hypothèses sur ce qui pourrait se passer, d'un point de vue mécanistique, chez des personnes ayant une neurobiologie parallèle mais des contributeurs génétiques inconnus.
Et des stratégies spécifiques de sous-typage peuvent aider les scientifiques à mettre l'accent sur des questions de recherche particulières, comme l'illustre une étude axée sur le déséquilibre entre excitation et inhibition. Les personnes autistes se répartissent en deux groupes sur la base des résultats de l'électroencéphalographie (EEG) : l'un qui montre plus d'excitation que les contrôles neurotypiques et l'autre qui en montre moins, selon une prépublication publiée sur medRxiv en juin par Gozzi et ses collègues. Les chercheurs ont pu reproduire ces signatures EEG en manipulant l'activité cérébrale chez des souris, fournissant ainsi un modèle pour étudier comment des schémas opposés d'activité cérébrale peuvent tous deux conduire à des traits autistiques, ainsi que pour tester différentes interventions.
Au lieu d'un spectre unique, Gozzi imagine un spectre ou un axe pour chaque dimension de l'autisme : un pour les caractéristiques fondamentales de l'autisme, un autre pour la génétique, un autre pour les troubles concomitants, etc. Le point d'intersection de tous ces axes représente l'« autisme » unique d'un individu.
« Nous avons commencé par une description très monolithique de l'autisme, qui, de toute évidence, ne fonctionne pas », explique Gozzi, ajoutant qu'une description qui s'appuie fortement sur les différences individuelles peut être tout aussi difficile pour la recherche. « Nous devons trouver un juste milieu, une couche intermédiaire, qui nous permette d'identifier des groupes solides et reproductibles. »
Une telle approche pourrait permettre des progrès cliniques, en identifiant des groupes d'individus partageant des caractéristiques et une biologie communes qui pourraient bénéficier des mêmes traitements ou soutiens, explique M. Gozzi.
Siegel est d'accord. « Il est clair qu'on ne peut pas appliquer les mêmes approches, les mêmes interventions et les mêmes aides à toutes les personnes autistes », dit-il, tout en notant que l'idée de sous-groupes autistiques rencontre encore une certaine résistance. « Je pense que le manque d'intérêt, voire la crainte, pour la subdivision en sous-groupes, qui caractérise notre approche depuis 58 ans, a en fait causé beaucoup de confusion et d'amalgame entre les besoins des différentes personnes. »
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
Quatre sous-types d'autisme correspondent à des gènes et des traits distincts
Une analyse portant sur plus de 5 000 enfants autistes et leurs frères et sœurs souligne l'idée que l'autisme peut être compris comme un ensemble de troubles multiples présentant des trajectoires distinctes.



