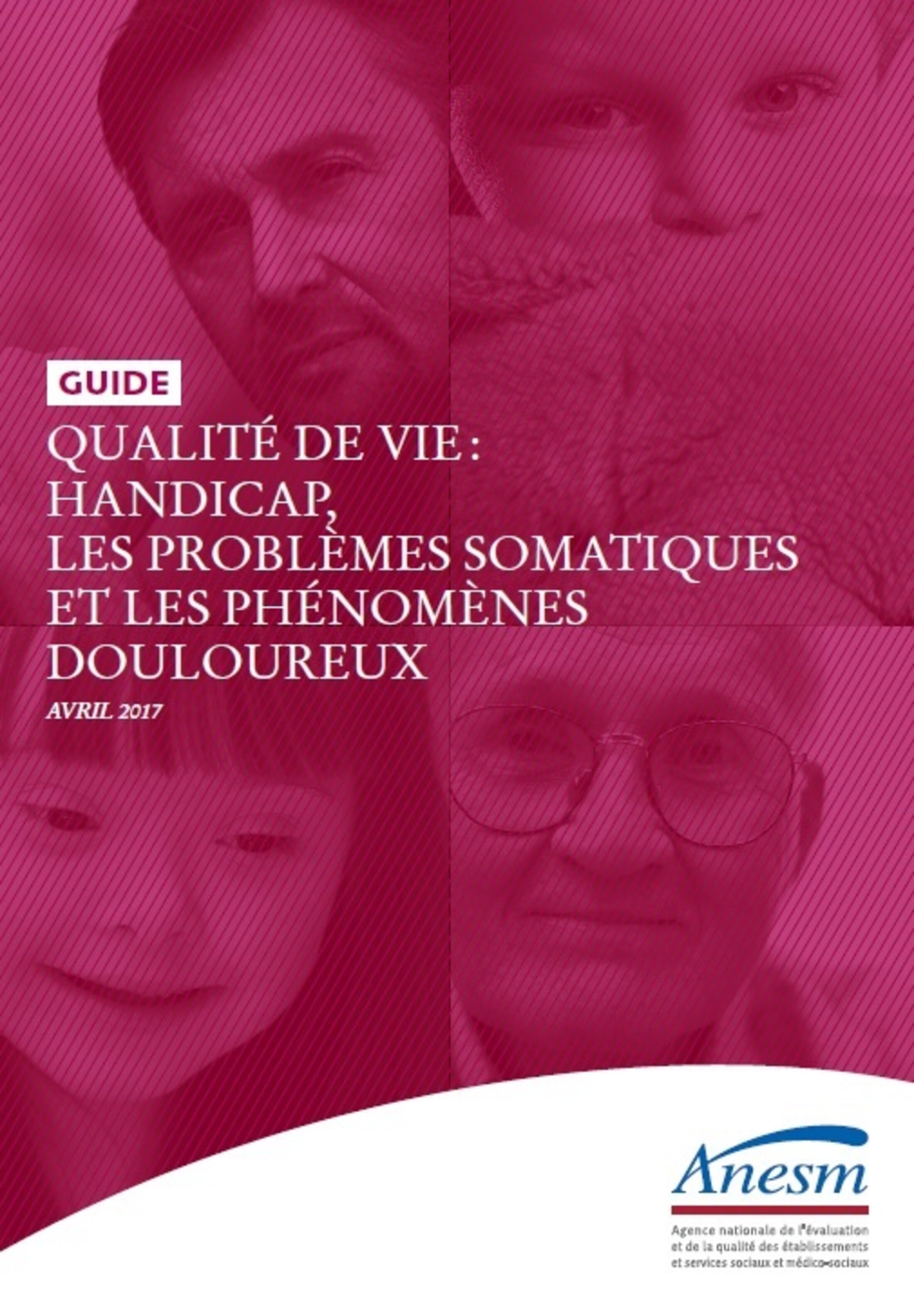spectrumnews.org Traduction par Sarah de "Unseen agony: Dismantling autism's house of pain" par Sarah DeWeerdt ; 21 Mai 2015

Agrandissement : Illustration 1

Lorsqu’il était enfant, Noah détestait que sa mère passe l’aspirateur dans la maison. « Elle posait toujours l’aspirateur sur le plancher, et non sur la moquette », se rappelle-t-il. « Et ça faisait vraiment du bruit, alors ça me paniquait. »
Noah, qui a demandé à ce qu’on ne mentionne pas son nom, a reçu le diagnostic d’une forme légère d’autisme, appelée autisme asperger, lorsqu’il était à l’université (le syndrome d’Asperger a depuis été englobé dans la catégorie plus large des troubles du spectre de l’autisme).
A présent au début de sa trentaine, il conseille d’autres hommes autistes et enseigne la psychologie à Boston. Mais, quand il était enfant, il ne se rendait pas compte que son monde sensoriel était différent de ce qu’expérimentaient les autres.
« Au début, je hurlais et lui criais d’arrêter, mais elle elle ne voyait pas du tout en quoi ce qu’elle faisait était irritant », raconte Noah. « Et je n’avais aucune idée du fait que ce que je ressentais, personne d’autre ne le sentait de la même manière. »
Noah a fini par accepter l’idée que le bruit de l’aspirateur, comme d’autres expériences sensorielles, était une chose qu’il devait supporter. En conséquence, « j’étais très insensible », dit-il. « je pouvais supporter un froid, ou même une douleur, très intense, et ne rien faire, ne pas sentir grand-chose. »
L’expérience de Noah illustre le paradoxe de la douleur dans l’autisme. D’un côté, certains autistes peuvent tolérer une chaleur, un froid ou une douleur extrêmes, mais paraître relativement insensibles à la douleur. De l’autre côté, ils peuvent ressentir une douleur intense de sources qui leur sont propres, mais avoir du mal à la communiquer.
« Je trouve intéressant que ces deux notions puissent cohabiter dans l’esprit en même temps », remarque Matthew Lerner, professeur assistant de psychologie, psychiatrie et pédiatrie à l’Université Stony Brook à New York.
A y regarder de plus près, la littérature médicale sur le sujet confirme que, bien que certains autistes soient insensibles à la douleur, d’autres y sont anormalement vulnérables. Les hypersensibilités sensorielles – réactions exagérées à certains sons, lumières, ou d’autres stimulations – touchent jusqu’à 70 % des personnes autistes. La douleur peut émaner de problèmes de santé associés à l’autisme, comme des problèmes gastro-intestinaux. Par ailleurs, les difficultés de sommeil, l’anxiété ou l’entêtement, ou encore la tendance à se fixer sur une seule pensée – toutes ces caractéristiques étant courantes dans l’autisme – peuvent intensifier la douleur.
Cela constitue cependant un défi important de reconnaître cette douleur, car les personnes autistes ont des manières inhabituelles de l’exprimer. Cela aussi peut alimenter l’impression qu’ils ne ressentent pas la douleur.
« C’est vraiment un gros problème quand on doit faire des injections ou des opérations médicales à des personnes autistes », note Clare Allely, chargée de cours de psychologie à l’Université de Salford à Manchester, au Royaume-Uni.
Une étude française a constaté, par exemple, que moins de la moitié des enfants autistes avaient une anesthésie locale avant une prise de sang, alors même que cette pratique était coutumière pour les enfants typiques. (1)
La peau sur la neige
La théorie d’une expérience altérée de la douleur dans l’autisme remonte aux premières descriptions du trouble. Leo Kanner a mentionné un traitement anormal des sensations, comme constaté chez une fille qui avait une réaction étrange et détachée lorsqu’on la piquait avec une aiguille, au moment où il a forgé l’expression « autisme » en 1943. Des études de cas plus tardives décrivent, par exemple, une fille autiste qui jouait nue dans la neige, et un garçon qui serrait tellement sa ceinture qu’elle lui rentrait dans la peau, et qui avait attrapé une fois une poêle à frire chaude sans broncher. (2)
Ces anecdotes ont donné naissance à une conception dominante, incontestée pendant des années, selon laquelle les autistes avaient tendance à être insensibles à la douleur. En fait, de nombreux cliniciens interrogés pour cet article disent qu’ils ont connu des autistes qui semblaient de la même manière insensibles à la douleur, ce qui peut expliquer pourquoi cette théorie a prévalu pendant si longtemps.
Mais au-delà de ces preuves éparses, on manque de recherches solides sur le sujet.
« J’ai été surpris qu’il existe si peu de littérature scientifique sur l’autisme et la douleur », s’étonne David Moore, chargé de cours de psychologie à l’Université John Moores de Liverpool, au Royaume-Uni, qui a publié l’année dernière une revue sur ce domaine. (3)
Jusqu’à ce que les scientifiques parviennent à saisir plus clairement la façon dont les autistes ressentent et montrent la douleur, dit David Moore, les médecins risquent de continuer à méconnaître leurs signaux de détresse – et peut-être des problèmes médicaux sérieux pour lesquels la douleur est un signal important, comme des fractures et des infections.
« Pour la seule raison que dans certains cas, des personnes ne ressentent pas la douleur, ignorer la douleur et la souffrance potentielles d’autres enfants qui ont le même diagnostic est tout aussi dangereux », affirme-t-il.
Les quelques études rigoureuses et bien contrôlées sur ce sujet laissent à penser que la théorie selon laquelle les autistes sont insensibles à la douleur est en grande partie un mythe. Ainsi, trois études expérimentales dans lesquelles les chercheurs ont soumis des volontaires à une légère décharge électrique, une pression, du froid ou du chaud, indiquent que les autistes ont des paliers de douleur normaux, ou sont parfois même plus sensibles à la douleur que les autres. (4, 5, 6)
Deux autres études ont observé les réactions d’enfants aux prises de sang, enregistrant leurs pleurs, grimaces et réactions physiologiques, comme le rythme cardiaque. (7, 8) Globalement, ces études, elles aussi, indiquent que les enfants autistes ressentent les mêmes niveaux de douleur que les enfants au développement typique.
Si tel est le cas, les personnes autistes ressentent peut-être plus de douleur que les autres, en raison d’autre problèmes médicaux. Par exemple, ils ont du mal à dormir régulièrement, et un petit nombre d’études ont commencé à suivre cette piste, pour savoir comment cela pourrait influencer leur réaction à la douleur.
Dans une étude en ligne publiée l’année dernière, 62 mères d’enfants autistes ont rapporté une prévalence étonnamment élevée, à la fois de problèmes de sommeil, et des comportements liés à la douleur chez leur enfant. (9) Plus de 90 % des enfants dormaient trop ou insuffisamment, ou faisaient des cauchemars, ou avaient des anomalies respiratoires en dormant. Et plus de 90 % avaient un score supérieur au seuil pour les comportements indiquant la douleur, comme de gémir, faire des grimaces ou chercher des câlins.
Il n’est pas surprenant que les enfants qui ont présenté le plus de comportements associés à la douleur sur une semaine donnée aient eu également le plus de problèmes de sommeil. Ne pas bien dormir pourrait aussi saper la capacité d’un enfant à supporter la douleur, et créer des problèmes de comportements supplémentaires en général.
Les problèmes gastro-intestinaux peuvent être aussi une source de souffrance pour les enfants autistes. Un sondage auprès des parents, l’année dernière, a fait ressortir que 58 des 225 enfants avaient connu des douleurs abdominales pendant au moins trois mois. (10) Une année après, plus de 85 % de ces enfants avaient toujours ce type de problèmes. Et chez presque un quart des enfants qui n’avaient pas de douleurs abdominales au début de l’étude, celles-ci avaient fini par apparaître vers la fin.
Un millier d’aiguilles
La recherche sur l’intestin fait aussi allusion aux façons dont les répercussions psychologiques de l’autisme peuvent augmenter la douleur.
L’anxiété peut contribuer à des problèmes gastro-intestinaux dans la population générale. De la même manière, les enfants autistes anxieux sont plus susceptibles d’avoir mal à l’estomac.
Dans la population générale également, l’anxiété amplifie la douleur que ressent une personne suite à une blessure, et l’anxiété est particulièrement présente chez les enfants autistes. Cette anxiété pourrait rendre les autistes conscients, à un plus haut degré, de leurs maux et douleurs, même s’il n’existe pas de preuve directe de ce lien.
« Il est parfois difficile de dire ce qui cause quoi, lorsque nous voyons tous ces symptômes en même temps », remarque Micah Mazurek, professeur assistant de santé psychologique à l’Université du Missouri-Columbia.
D’autres caractéristiques de l’autisme pourraient aussi rendre les personnes sur le spectre psychologiquement plus vulnérables à la douleur. Noelle Giesse, mère habitant dans le Queens, à New York, raconte que, lorsque son fils autiste de 15 ans, Matthew, qui est autiste et a la maladie de Crohn, souffre d’accès de douleurs abdominales, la souffrance a tendance à l’envahir. Peut-être qu’à cause d’une tendance à s’entêter associée à l’autisme, il est incapable de se distraire de son malaise, en vaquant à ses occupations, comme le fait sa sœur.
Micah Mazurek et son équipe ont découvert que, dans l’autisme, les hypersensibilités sensorielles sont encore plus liées à la douleur que ne l’est l’anxiété. Les enfants que leurs parents ont signalé comme hypersensibles aux sons, aux odeurs, au toucher ou à d’autres stimuli, ont tendance à avoir plus de douleurs abdominales pour commencer, et sont plus susceptibles de contracter des douleurs abdominales par la suite.
« Il se peut que pour eux, de nombreux stimuli différents soient douloureux, y compris la stimulation gastro-intestinale », précise Micah Mazurek. Les sensations corporelles normales de digestion et d’élimination sont peut-être si intenses et désagréables qu’ils évitent d’aller aux toilettes et commencent à être constipés, ce qui entame un cercle vicieux.
Ce type d’hypersensibilités peut faire que ce que d’autres considéreraient comme de légères sollicitations paraissent intensément douloureuses pour les autistes. Noah explique qu’il ne peut supporter un grand nombre de sensations, que ce soit une sonnerie brutale de téléphone ou la sensation des os de ses chevilles qui se touchent. Croiser le regard de quelqu’un est pour lui intolérable de la même manière.
Quand il travaillait dans un camp d’été pour des enfants autistes, raconte Noah, il a une fois entendu un garçon réagir, alors qu’un autre garçon chantait une petite chanson répétitive et agaçante de « to-mA-te, to-mÂ-te » en lui disant : « Arrête de chanter ça. C’est comme si tu me piquais avec un millier d’épingles. »
Malgré cette image abrupte, Noah justifie : ce type de description est seulement une métaphore ; ses hypersensibilités sensorielles ne ressemblent pas à la réalité physique d’une coupure ou d’un coup.
« Ma réaction ressemblera beaucoup à celle d’une personne qui a mal, mais elle vient d’un endroit différent », dit-il. « C’est juste que c’est ce processus qui irrite et englobe tout, qui vous enveloppe le cerveau entier. »
Cri silencieux
Même dans la mesure où tous ces facteurs réunis conspirent à faire augmenter la douleur chez les personnes autistes, cette douleur peut être extraordinairement difficile à reconnaître.
Dans une étude de 2009, les chercheurs ont constaté que le coeur des enfants autistes battait plus vite quand on leur faisait une prise de sang que celui des enfants typiques. (8) Mais les enfants autistes faisaient moins d’expressions faciales, comme des grimaces, qui indiquent la douleur, peut-être parce qu’ils ont un répertoire de comportements expressifs plus restreint en général.
« Le défi avec l’autisme, c’est que nous avons affaire à une population qui a un comportement social altéré », constate David Moore. « Et le comportement dans la douleur est une chose éminemment sociale. »
Certaines personnes autistes peuvent communiquer leur douleur de manière contre-productive. Noëlle Giesse se souvient de la réaction de Matthew quand on lui a retiré les amygdales. Il a piqué une crise, en hurlant qu’il voulait rentrer à la maison, même si sa gorge lui faisait certainement très mal.
Plus tard, Matthew a dit à sa mère qu’il avait hurlé justement parce que sa gorge lui faisait si mal. « Mais il ne pouvait pas nous exprimer ça ; pour lui, c’était juste hurler », dit Mme Giesse.
Incapables de s’exprimer, certains enfants dirigent parfois leur frustration vers l’extérieur – ou même contre eux-mêmes.
« Très souvent, la douleur peut être extériorisée comme une exagération des problèmes de comportement, ou davantage d’auto-mutilations ou d’agressivité », surtout chez les autistes qui ont des capacités verbales limitées, dit Micah Mazurek.
Il n’existe pas beaucoup de recherches sur ce sujet, mais les comportements mêmes souvent interprétés comme une tolérance élevée à la douleur – comme se cogner la tête ou se mordre la main – pourraient être des signes que la personne est en souffrance.
Il y a des preuves que, au moins dans certains sous-types génétiques de l’autisme, il peut y avoir une base biologique à la tolérance à la douleur. Ainsi, des personnes qui ont le syndrome de Phelan-McDermid, une anomalie génétique souvent accompagnée d’autisme, sont fréquemment insensibles aux maux. Les modèles souris de ce trouble partagent cette caractéristique.
La première description du syndrome de Rett en 1966, un trouble lié à l’autisme qui touche majoritairement les filles, fait aussi mention de la capacité des filles à supporter des maux importants.
En 2010, la première étude à explorer d’une manière systématique la douleur dans le syndrome de Rett a sondé 646 familles en Australie, en France et dans d’autres pays, et a constaté que 65 % des parents rapportaient que leurs filles avaient une réaction à la douleur retardée ou atténuée. (10)
Certaines filles avec le syndrome de Rett riaient au lieu de pleurer quand elles étaient blessées, disaient leurs parents. « Il arrivait souvent qu’elles aient une fracture et que personne ne le sache », note la directrice de l’étude, Helen Leonard, épidémiologiste à l’Université d’Australie occidentale, près de Perth.
Les fractures constituent un problème particulier chez les filles qui ont le syndrome de Rett, lesquelles tendent à avoir une densité osseuse plus basse. Les familles et médecins qui s’occupent des filles avec ce syndrome « doivent vraiment être vigilants pour la prévention des fractures », avertit Helen Leonard. Son équipe développe des recommandations pour protéger et soigner les os fragiles des filles qui ont ce trouble.
Le syndrome de Rett est dû à une mutation de MeCP2, un gène qui commande l’expression de plusieurs milliers d’autres. Ces quelques dernières années, les études sur les animaux ont montré que MeCP2 orchestre la perception de la douleur dans le corps. Le blocage du gène chez un rat peut avoir pour effet de suspendre la perception de la douleur après une blessure, ce qui expliquerait peut-être les réactions retardées à la douleur des filles qui ont ce trouble.
MeCP2 a aussi été impliqué dans l’autisme, c’est pourquoi ce mécanisme contribue peut-être à modifier la sensibilité à la douleur chez certains autistes également, suppose Helen Leonard. Mais cette conception est une spéculation.
Ne plus être insensible
Pour certains autistes, grandir peut permettre de remédier à un grand nombre de sources de douleur.
Mais attendre ce soulagement n’est pas une solution pratique. Au lieu de cela, les parents et médecins ont besoin de mieux identifier et mesurer la douleur chez les autistes.
D’abord, les chercheurs assurent qu’ils ont besoin d’étudier de manière systématique la douleur chez les personnes autistes, afin d’esquisser les variations dans la sensibilité à la douleur, et l’expression sur l’ensemble du spectre.
David Moore et Clare Allely annoncent qu’ils s’intéressent à la conduite d’études en psychologie et imagerie pour les aider à suivre la douleur dans le système nerveux chez les personnes autistes. Ils souhaitent ainsi déterminer si les terminaisons nerveuses enregistrent les stimuli douloureux de manière différente, ou si le cerveau interprète la douleur différemment chez les autistes que chez les contrôles.
D’autres chercheurs tentent de démêler les relations de cause à effet entre la douleur, les problèmes de santé et les traits psychologiques. Ce travail pourrait, en fin de compte, permettre aux cliniciens d’atténuer la douleur chez les autistes, en abordant les causes à la racine, même si celles-ci ne sont pas purement physiques.
Matthew Lerner étudie actuellement la façon dont les personnes autistes expriment la douleur, demandant à celles qui ont de bonnes aptitudes verbales d’aider à interpréter les comportements liés à la douleur des autres personnes sur le spectre. Le but est de s’appuyer sur ces connaissances pour décoder les comportements et les expressions faciales des personnes autistes. En parlant de sa collaboration avec ceux qu’il essaie d’aider, Matthew Lerner a cette formule : « Qui est le mieux à même de répondre sur ces différences que les experts ? »
En attendant, les personnes sur le spectre cherchent des moyens de prévenir et de calmer leurs propres maux.
Noah, par exemple, a appris à reconnaître et à contrôler les bizarreries de son monde sensoriel. Il porte souvent des écouteurs quand il sort en public, pour contrôler son environnement auditif. Et il se sent beaucoup moins insensible, en général, qu’il se rappelle l’avoir été enfant, changement qu’il attribue à une meilleure connaissance de soi, qui a découlé de son diagnostic d’autisme comme jeune adulte.
« Il m’a fallu longtemps après avoir découvert ceci, pour arriver à m’ouvrir un peu plus à mes sens, et à sentir les choses comme une personne neurotypique », dit-il.
Références :
- Rattaz C. et al. Pain 154, 2007-2013 (2013) PubMed
- Allely C.S. Scientific World Journal 2013, 916178 (2013) PubMed
- Moore D.J. Autism 19, 387-399 (2015) PubMed
- Bird G. et al. Brain 133, 1515-1525 (2010) PubMed
- Fan Y.T. et al. Soc. Cogn. Affect. Neurosci. 9, 1203-1213 (2014) PubMed
- Cascio C. et al. J. Autism Dev. Disord. 38, 127-137 (2008) PubMed
- Nader R. et al. Clin. J. Pain 20, 88-97 (2004) PubMed
- Tordjman S. et al. PLoS One 4, e5289 (2009) PubMed
- Tudor M.E. et al. Autism 19, 292-300 (2015) PubMed
- Downs J. et al. Am. J. Med. Genet. A 152A, 1197-1205 (2010) PubMed
Le Centre de Ressources Autisme Normandie-Seine-Eure propose un support d'aide à l'identification et la description des sensations douloureuses. 26 pages.
Interview du Dr Djéa Saravane
Interview du Dr Djéa Saravane réalisée à l'occasion des Aspie Days, organisés par l'ASS des AS à Lille, les 17 et 18 février 2017
- 13 juin 2017
Dr Djéa Saravane - Soins et Douleur chez les personnes autistes
Une conférence du Dr Djéa Saravane à Brest le 7 mars 2017. L'ANESM vient de publier ses recommandations sur les problèmes somatiques et les problèmes douloureux, auxquelles a participé le Dr Saravane. L'ARS Nouvelle Aquitaine crée deux centres de soins du type de celui d'Etampes.
- 29 mai 2017
- 29 mai 2017
Qualité de vie : handicap, les problèmes somatiques et les phénomènes douloureux
Guide méthodologique - Mis en ligne le 12 mai 2017
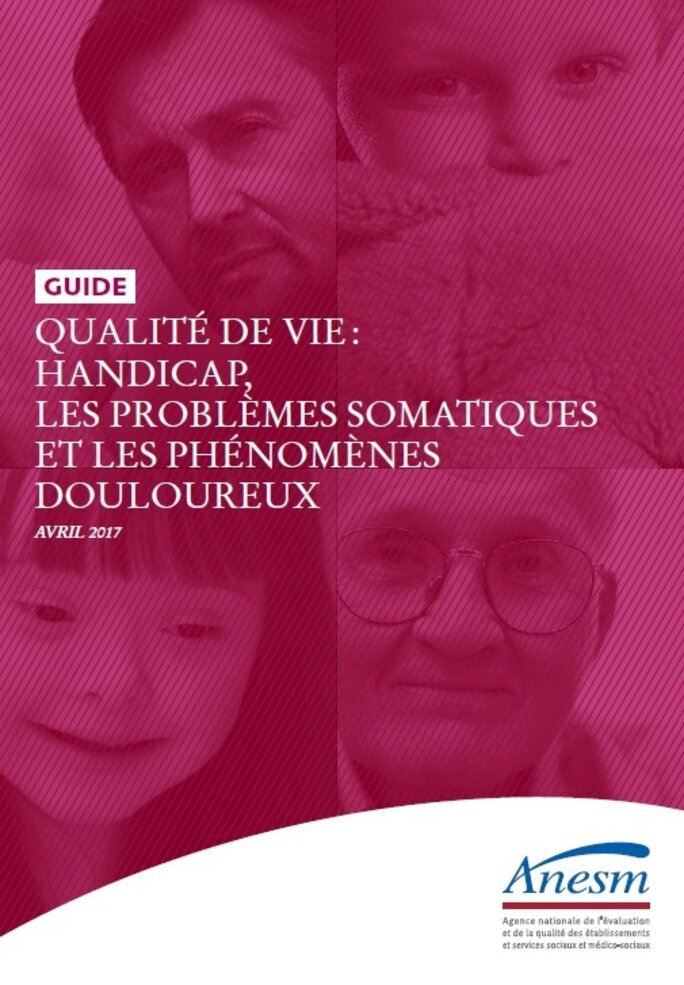
Agrandissement : Illustration 2