Je viens de terminer la somme biographique de Daniel Bensoussan, sur le comte Hervé Budes de Guébriant, cofondateur de l'Office Central (le"Syndicat") à Landerneau en 1911 et adjoint de Pétain à la Corporation Paysanne du régime de Vichy.
Cette biographie peut passionner ceux qui s'intéressent à l'évolution sur une longue durée du monde agricole breton. Et du monde catholique, particulièrement dans le Léon, dit "la terre des prêtres" (Nord-Finistère).
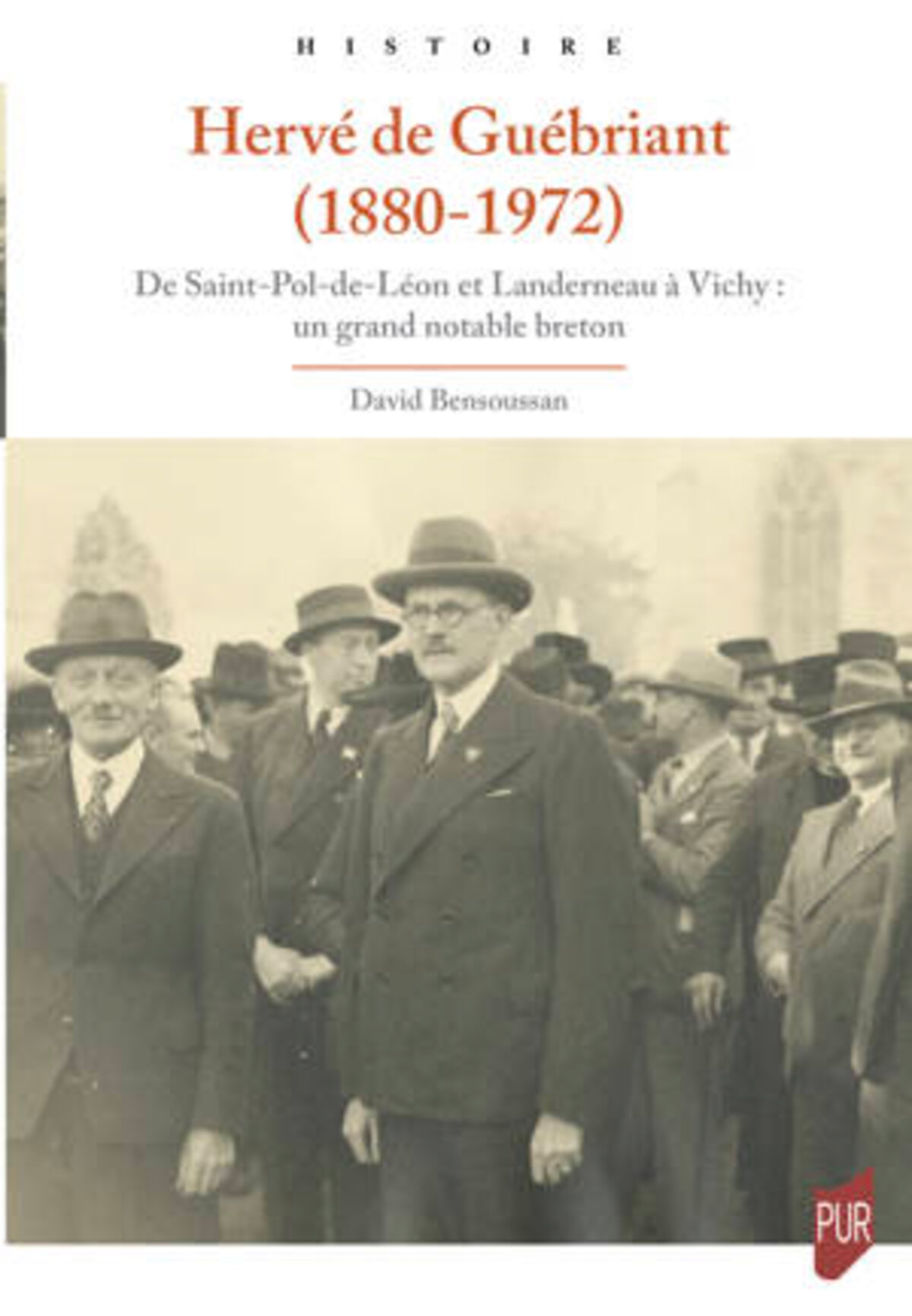
J'ai travaillé pendant quelques dizaines d'années rue Hervé Budes de Guébriant à Landerneau, où se situait la Mutualité Sociale Agricole, Groupama, la Maison Carrée etc. J'ai baigné dans ce milieu sur le plan professionnel, syndical et familial.
J'ai déjà abordé cette question dans le post Landerneau, le « Syndicat » : du corporatisme/fascisme au féminisme
La première partie du livre décrit une implantation progressive à St-Pol-de-Léon d'une famille noble, qui rétablit et accroît progressivement son patrimoine foncier (notamment grâce à des mariages de nobles) à l'occasion de la Restauration - après 1815. La famille est légitimiste, pas orléaniste. Son royalisme légitimiste va la mettre à la lisière des lieux de pouvoir, après 1830. Bien sûr, elle a ensuite en horreur la République : c'est l'alliance du château et du presbytère. Le patrimoine foncier reste traditionnel (42 fermes à St-Pol et Cléder - çà va augmenter) sans aucune innovation. Il est accompagné cependant de la constitution d'un patrimoine mobilier, essentiellement dans les emprunts d’État. Mais il n'y a aucune participation à la révolution industrielle.
Le pouvoir de l'aristocratie royaliste est cependant menacé dans le Léon par les catholiques républicains, qui s'appuient sur une encyclique du pape et le mouvement du Sillon. Ils sont appuyés par le bas clergé, alors que l'évêque est toujours en cheville avec les royalistes. Il y aura ensuite des affrontements à l'occasion de l'expulsion des sœurs en 1904* et de l'inventaire des biens des églises, mais la famille de Guébriant se résout à rentrer dans le cadre républicain. Elle se pose aussi la question du changement du modèle économique. Les Républicains, sous la forme de la démocratie-chrétienne, avec y compris l'élection de l'abbé Gayraud comme député, deviennent dominants dans le Léon.
Hervé de Guébriant a connu l'alternance de la vie au château de St-Pol et de la vie parisienne. Mais il va faire l'Agro**, ce qui lui a donné sans aucun doute une compétence pour faire évoluer ensuite la productivité agricole. Et donc de la mettre au niveau de la révolution industrielle.
En 1911, il est cofondateur de l'Office Central des associations agricoles du Finistère. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il faisait partie des actionnaires de l'Office. Celui-ci n'était donc pas constitué seulement d'associations. Bien entendu, les actionnaires individuels étaient des nobles propriétaires fonciers, et avaient donc un poids prépondérant dans l'Office.
Mais l'Office Central va ensuite, après 14-18, s'appuyer sur la création de centaines de syndicats agricoles, organisés par commune (on devrait dire paroisses). L'Union des syndicats agricoles va se confondre avec l'Office Central (mêmes locaux, mêmes dirigeants, même personnel, même idéologie). Les syndicats agricoles sont censés aller des ouvriers agricoles (pas très chauds apparemment) aux nobles propriétaires fonciers non exploitants (qui sont les dirigeants). C'est pour cela que j'entendais parler du Syndicat, qui était synonyme de l'Office Central ou de "Landerneau".
La conception corporatiste vise à rassembler les différentes couches de la société (agrarienne en l'occasion, considérée comme conforme à la tradition et centrale dans la société) en opposition au régime parlementaire. Chaque corporation serait alors chargée d'organiser la vie économique de ce secteur d'activité. Les chemises vertes (dorgéristes) n'avaient pas la même couleur que les chemises brunes (Allemagne) ou les chemises noires (Italie), mais elles avaient la même idéologie et les mêmes objectifs.
Les années 1930 voient l'alliance de l'Office Central avec le mouvement des chemises vertes, lancé à partir de Dorgères en Ille-et-Vilaine. Il s'agit de s'opposer à la loi de 1930 sur les Assurances Sociales - alors que de Guébriant y est plutôt favorable, comme l’Église, à condition que la gestion soit confiée à des organismes mutualistes. De grandes manifestations ont lieu. Ma grand-mère racontait qu'une équipe américaine de cinéma (pour les actualités) avait fait simuler une manifestation de paysans dorgéristes, vers 1935.
Le Front Populaire est une horreur pour l'Office Central, mais il va s'adapter à l'Office du Blé, qui permet une augmentation de son prix, et qui sera géré par les coopératives.
A cette époque, de Guébriant plaide contre l'affrontement avec Hitler. Et la "divine surprise" sera l'arrivée au pouvoir de Philippe Pétain, avec lequel il nouera des relations cordiales fréquentes. Pourtant Vichy était loin géographiquement de Landerneau. Mais les conceptions pétainistes étaient totalement conformes aux conceptions corporatistes de l'Office Central. Pétain a dit à ce moment là : "La terre ne ment pas", ce qui ne veut évidemment rien dire : l'acier, les parpaings, les buzugs [vers de terre en breton] ... ne sont pas en capacité de mentir. Mais derrière cela, il y avait une conception agrarienne, suivant laquelle la paysannerie (au sens large, nobles et propriétaires fonciers compris) devaient être au centre de la vie économique et sociale.
A noter le rare point de divergence avec l'évêché. Celui-ci préconisait la création de syndicats d'ouvriers agricoles de la CFTC - pour faire barrage à la CGT - alors que l'Office Central voulait les enrôler dans ses Syndicats, sans beaucoup de succès. La fâcherie n'est pas allé bien loin, notamment avec Mgr Favé (qui m'a confirmé).
Contrairement à ce que je croyais, de Guébriant n'a pas été l'adjoint de Pétain à la Corporation Paysanne. Mais plus, il a été le président de la commission nationale d'organisation de la Corporation. Il a fini par être rétrogradé par le Ministre de l'Agriculture, ce que décrit le livre. Il note dans ses carnets son combat avec le Ministère, les fonctionnaires, qu'il assimile à la franc-maçonnerie honnie et persécutée par le régime de Vichy. Il restera un pilier de la Corporation Paysanne, qui me semble être un des rares "succès" de la politique corporatiste du régime de Vichy.
La Corporation a été un relai du régime de collaboration avec les allemands, surtout pour la politique de ravitaillement et de réquisition. Elle devait aussi se payer la répartition des impôts entre les paysans, tâche pas très populaire. Les MSA de la Bretagne Ouest se sont attelés à la répartition des cotisations sociales des exploitants agricoles dans les années 1970, et leurs dirigeants se sont heurtés à de fortes adversités (je pense aux éleveurs porcins ou à la zone légumière de St Pol de Léon).
Aucune preuve de Résistance de la part de l'Office Central. Il était tellement enfoncé dans la France de Vichy collaborationniste. Il a milité en faveur de Pétain jusqu'à ses derniers jours.
Le livre donne des preuves de l'antisémitisme du comte. Pas vraiment étonnant compte tenu de ses origines et fréquentations politiques. Il n'y a pas pour autant d'actes antisémites, sans doute parce qu'il n'y avait pas de nobles ou de paysans juifs en Bretagne ! Il ne semble pas qu'il y ait eu des dénonciations. Dans mon bled (Ploudaniel), il y avait des familles juives qui s'étaient réfugiées et travaillaient dans les fermes. Personne ne les a dénoncées. Par contre, dans mon château à la Roche-Maurice, il y avait une famille juive qui portait l'étoile jaune : elle a été raflée par la gendarmerie française en octobre 1942. La fille a réussi à s'échapper, mais la châtelaine d'à côté, pétainiste, a refusé de l'héberger ! Elle vit toujours encore à 104 ans, comme sa fille, bébé de 6 mois à l'époque, que les gendarmes voulaient aussi déporter.
Je ne sais pas trop comment dire çà, mais la collaboration du comte avec Vichy a été très mal récompensée. Il considérait que les américains seraient une nouvelle occupation. Vraiment pas enchanté de la Libération. Les habitants de St-Pol étaient par contre joyeux de la Libération, mais s'étaient réjouis trop tôt. Les nazis sont revenus et ont tué 26 civils, dont en premier le fils de De Guébriant, maire de Saint-Pol (55 ans de De Guébriant à la mairie).
Quelques mois après, le comte a été emprisonné pendant 8 mois. Ce n'était pas très cher payé compte tenu du rôle qu'il a joué dans la Collaboration. Il sera assez vite libéré, interdit de séjour dans le 29 et le 22, interdit de diriger des associations agricoles, interdits qu'il ne respectera pas. Il sera grassement indemnisé par le Conseil d’État en 1952 ! Le livre impute cette "persécution" à François Tanguy-Prigent, syndicaliste agricole de la région de Morlaix, jeune député socialiste du Front Populaire, et Ministre de l'Agriculture de 1944 à 1947. C'est vraisemblable, et Tanguy-Prigent, résistant et syndicaliste agricole, avait de bonnes raisons pour cela. En tant que Ministre, il s'attaque à un des fondements de la puissance de l'Office Central, c'est-à-dire la confusion entre le syndicalisme agricole et les organisations économiques : les syndicats n'ont plus le droit d'exercer une activité économique. Il aura moins de succès en mettant en place la CGA (confédération générale de l'agriculture) : les dirigeants de la Corporation Paysanne vont la phagocyter, puis créer la FNSEA (fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles). Les nobles propriétaires fonciers non-exploitants vont quand même quitter progressivement la scène. Mais le comte y reste.
J'ai connu à la Mutualité Agricole (MSA et Assurances 1900 = Groupama) les survivants de la Corporation : Moreau, Bonjean, de Bretteville. La famille de .Louis Lichou, directeur général de l'Office Central, vivait à l'autre bout de ma rue.
La JAC (jeunesse agricole catholique) a bouleversé le monde paysan au sortir de la seconde guerre mondiale. A son apogée (1951), mon père est devenu président national; ma mère était dans l'équipe nationale de la JAC féminine. D'où deux ans après, ma naissance. Les organisations n'étaient pas mixtes, mais il y avait quand même quelques occasions de se retrouver !
Dans le livre, j'ai été assez surpris de lire que des jeunes de la JAC (Marcel Léon, Alexis Gourvennec ...) avaient baissé pavillon devant de Guébriant après l'assaut de la sous-préfecture de Morlaix en 1961. Il s'agit peut-être de positions opportunistes.
Chez mes parents, je ne sentais pas un enthousiasme pour l'Office Central. Mon grand-père maternel était pourtant à droite toute. Mais la JAC a bouleversé l'analyse des problèmes. Je vois d'abord des raisons géographiques et économiques.
Mon père était de Plaine-Haute, près de Saint-Brieuc (22), et n'était pas dans la plus forte zone d'implantation de l'Office Central. L'exploitation laitière de mes grands-parents maternels était à Ploudaniel - 11 km au nord de Landerneau - et était de ce fait affilié à la Coopérative Laitière Even, une des plus anciennes et grandes coopératives laitières. Ensuite, mes parents ont choisi de se lancer dans la production avicole - à Ploudaniel -, ce qui n'était pas couvert à ce moment-là par les coopératives. Ce secteur a été occupé très tôt par des entreprises privées (Doux, Guyomarc'h ...), parfois créées par des agriculteurs (UCO, Goasduff). C'est ce qui a amené Bernard Lambert a décrire le modèle d'intégration des paysans par des entreprises, les transformant en quasi-salariés ("Les paysans dans la lutte de classes"). Il y avait quand même un dépôt du Syndicat au bourg.
C'est un peu matérialiste dialectique ce que j'en dis, mais une fracture s'est aussi élargie ensuite (fin des années 1960) dans les militants de la JAC, entre ceux qui ont été à fond dans le modèle productiviste breton et ceux qui se sont posé des questions.
Il y avait par exemple Pierre Abéguilé, dirigeant de la Section Nationale des Fermiers et Métayers de la FNSEA, conseiller départemental (centriste) du canton de Ploudiry (29). Les libéraux de la FDSEA le haïssaient tellement qu'ils ont fait campagne pour le PS (François Marc) dans les années 1980 pour l'éliminer du Conseil Départemental.
Mes parents se sont aussi investis dans la Famille Rurale, la Ruche, la création des ADMR (aides à domicile en milieu rural), puis la MSA.
Ma mère a fait partie des dirigeants de l'Office Central en 1977, quand elle est devenue présidente de la MSA. Elle était évidemment la seule femme sur une douzaine de présidents. Sans parler des directeurs.
Le sexisme du comte n'est pas étonnant. A noter, dans sa dernière année, à l'occasion de la grève du lait (1972), quand "il note la présence des femmes dans le mouvement de contestation qui, à la porte de l'usine de Lanrinou, invectivent les directeurs : "Quand les viragos se mêlent à des énergumènes, tout raisonnement devient inutile" (29 mai 1972 - p.427)."***
Dans l'après-guerre, le corporatisme ayant échoué politiquement, le comte accompagnera l'évolution de l'Office Central vers un modèle productiviste, la modernisation de l'agriculture bretonne. Progressivement, cela se traduira par l'éclatement de l'Office entre différentes entités avec une logique économique différente :
- Coopagri (aujourd'hui Eureden)
- la banque Crédit Mutuel de Bretagne (Arkea)
- Assurances 1900 et SAMDA (Groupama)
- MSA
- Habitat rural
- Coopérative d'Insémination Artificielle (présidée par le comte jusqu'à sa mort à 92 ans).
et j'en oublie sûrement.
La dernière Convention Collective de l'Office Central date de 1959. A la fin des années 1960, Groupama et la MSA quittent la Maison Carrée - aujourd'hui Maison des Services Publics - et construisent leur siège juste à côté. La Coopagri construira le "fromage" un peu plus loin, à Lanrinou. Le CMB partira au Relecq-Kerhuon (traumatisme landernéen).
Je ne sais pas comment apprécier le fait que le comte ait soutenu la langue bretonne, par exemple en accueillant le Bleun-Brug dans son château de Kernévez. Pétain a envisagé de le nommer gouverneur de Bretagne, mais pour le comte, ce devait être une Bretagne à 5 départements. Finalement, Pétain a décidé d'une autre organisation administrative (non basée sur les provinces). Dans l'après-guerre, De Guébriant a été une des chevilles ouvrières du CELIB (comité de liaison des intérêts de la Bretagne), acteur du changement socio-économique de la Bretagne..
La politique sociale de l'Office Central
A mon grand regret, le livre ne donne pas d'indication sur la politique sociale (par rapport aux employés) de l'Office Central. Ce que je vais en dire, c'est grâce aux archives que j'ai récupérées et aux témoignages des anciens.
La première trace sociale est la création de la Caisse de secours des Employés de l'Office Central vers 1928. Elle était destinée à rembourser les dépenses de soins des employés (par exemple le viandox - considéré comme un fortifiant), mais ses statuts conduisaient à refuser de rembourser le vin. C'était à peu près au moment où l'Office Central cherchait à implanter des "caisses de secours" pour les adhérents du Syndicat.
C'était une mutuelle qui a duré jusqu'au début des années 1980. Elle a continué à fonctionner quand la loi sur les Assurances Sociales de 1930 a été appliquée aux salariés agricoles (dont faisait partie les salariés de l'Office Central). Elle est intervenue à ce moment là en complément. Elle a fusionné vers 1980 avec la Caisse de Prévoyance, qui intervenait plutôt sur les arrêts maladie (quand la convention collective ne prévoyait pas le maintien du salaire, pour les salariés en période d'essai ou en contrat à durée déterminée). Pendant l'occupation, ces "caisses" sont devenues obligatoires. Une Sécurité Sociale avant l'heure. Des dizaines d'années ensuite de lutte pour que la cotisation continue à être en pourcentage du salaire (1% - sans plafond) et financée par l'employeur très partiellement (30 anciens francs par salarié, devenus 0,3 F). La Mutuelle est devenue Mutagro (Mutuelle Agroalimentaire), ce qui dénote l'influence de la CFDT, qui a constitué en 1980 la Fédération Générale Agroalimentaire (FGA). Depuis qu'elle a perdu son mode de financement basé sur le salaire, elle a été absorbée par Previades, puis Harmonie Mutuelles.
A l'occasion du Front Populaire, la direction de l'Office Central a accepté de commencer à négocier une Convention Collective avec le seul syndicat créé à ce moment-là, le syndicat fasciste SPF (syndicat professionnel français), créé par les Croix-de-Feu (PSF). Il y avait une convergence idéologique entre la direction et le pseudo-syndicat. Le livre le mentionne en note p.169, en se référant à la thèse de JP. Sénéchal. Cela n'a pas empêché la direction de l'Office d'envoyer bouler le SPF le 31 décembre 1938 quand la situation politique s'est modifiée (division du Front Populaire) : c'était à l'employeur de décider unilatéralement d'un règlement intérieur, faisant office de statut.
Dans le cadre de sa politique paternaliste, l'Office Central a créé vers 1943 la Protection familiale. Il me semble que cela intervenait sur l'invalidité et la retraite. Progressivement, du fait de l'évolution des droits légaux et conventionnels (CCPMA), cela s'est concentré sur un complément de retraite pour les salariés avec de forts salaires ou avec des carrières courtes : les directeurs et les cadres.
Les syndicats ont lutté après 1945 pour participer à la gestion de cette caisse. Au bout de dizaines d'années, nous avons obtenu d'être 3 délégués du personnel (Coopagri, la banque CMB, la mutualité agricole - Groupama ou MSA). Un listing des nouveaux bénéficiaires a fini par nous être présenté : ainsi, nous avons pu constater qu'un directeur du "Paysan Breton" (l'hebdomadaire de l'Office Central, mais qui avait une structure indépendante) avait un complément de retraite, alors que l'entreprise n'avait jamais cotisé. C'est la secrétaire de direction chargée de la liquidation de ces retraites qui signalait discrètement aux délégués syndicaux les abus.
A la fin des années 1980, nous sommes allés au Ministère des Affaires Sociales avec une boîte d'archives sur ce sujet. On nous a répondu immédiatement que c'était complètement illégal depuis 1945, car ces fonds devaient depuis cette date être gérés paritairement entre les employeurs et les syndicats. Il nous a fallu des années pour liquider cette "caisse noire" et la redistribuer en faveur des salariés - et pas de quelques dirigeants ou cadres. De Guébriant le savait parfaitement, puisqu'il était administrateur de la CCPMA (caisse de prévoyance et de retraite complémentaire des salariés d'organismes agricoles), caisse évidemment gérée paritairement.
Les salariés étaient très minoritaires, ce qui n'empêchait pas les patrons de prendre les décisions au préalable. Un jour, je suis tombé sur un brouillon dans la photocopieuse (un bourrage), sur un compte-rendu de réunion préparatoire des directeurs marqué en grand "confidentiel"!
Je me faisais un petit plaisir, avec Marcel Kerdraon, de la CFDT du CMB, lors des conseils d’administration de la Protection Familiale, à rappeler les origines vichystes de l'organisme et du comte de Guébriant. Sales galopins gauchistes. Le président de l'époque, René de Foucaud, restait impavide devant nos provocations.
La Caisse de Protection Familiale a été la dernière survivance concrète de l'Office Central. Les soins palliatifs ont duré une dizaine d'années, car il fallait un accord entre les patrons et les syndicats de chaque organisme. Les patrons de la MSA 29 ont joué les prolongations, jusqu'aux jours qui ont précédé la fusion avec la MSA des Côtes d'Armor (anciennement Côtes du Nord).
Dès 1944, les jeunes militants de la JOC ont constitué la CFTC - devenue CFDT en 1964. Je me base sur les archives de Nicolas Bodénez. Les anciens du SPF sont arrivés dans le syndicat, mais les jeunes de la JOC ont réussi à s'en débarrasser au bout d'un an. Alors que les organisations comme l'Office Central et la FNSEA ont recyclé immédiatement les responsables de la Corporation Paysanne de Vichy. Le livre montre de plus que de Guébriant n'a pas respecté les interdictions de gérer des organismes agricoles suite aux poursuites pour collaboration qui lui avaient été intentées. La négociation d'une convention collective a pu avoir lieu. Elle a été signée en 1945, puis en 1947. Avec Nicolas Bodénez, Francis Bouroullec.
Mais il y a eu ensuite l'établissement d'un Règlement intérieur qui n'était pas négocié en 1950. Dès que la situation politique le permettait, l'Office Central remettait en cause les droits de ses salariés. Ce qui n'a pas empêché les délégués syndicaux CFTC d'intervenir. Ainsi, Houdet, directeur général, voulait considérer comme démissionnaire d'office une femme un an après son mariage. En effet, à cette date, elle aurait du donner naissance à un enfant. C'était la norme admise, mais une "étrangère" (née hors du Finistère) avait refusé de partir. Le délégué CFTC, Nicolas Bodénez, a écrit à l'inspecteur du travail (Horellou) qui a répondu que seul le mari pouvait décider de l'emploi de sa femme...
Houdet a conclu qu'il ne pouvait rien faire, ce qui n'a pas empêché le maintien de mesures discriminatoires sur l'embauche ou la réembauche des femmes mariées jusqu'en ... 1980 ! Il était admis que les femmes valables devaient être capables de trouver un mari qui leur permettrait d'arrêter de travailler. Le refus de promouvoir une femme comme tutrice aux prestations familiales était qu'elle était sûrement incapable de gérer un budget, car elle ne se contentait pas du salaire de son mari.
Il y a eu en fin de compte une convention collective en 1953 sans la disposition sur les femmes mariées : les délégués syndicaux expliquaient cependant qu'il fallait que le salaire des hommes soit suffisant pour permettre à leurs femmes de se consacrer au travail domestique. Une autre convention collective a été signée en 1959, mais le statut collectif a commencé à se diversifier (dénonciation de la convention à des dates différentes suivant les organismes, maintien dans d'autres).
J'ai appris cependant quelque chose sur le sujet dans le livre, c'est le fait qu'en Mai 1968, il n'y a eu qu'une seule grève importante à l'Office Central - et sans doute à Landerneau -, c'est à la MSA (Mutualité Sociale Agricole). Cela pourrait s'expliquer par l'ancienneté du syndicalisme CFDT (CFTC) depuis 1944, avec Nicolas Bodénez. Il était responsable national de la CFDT MSA, qui était très implantée. Il y a pu y avoir un effet de contagion nationale. La grève a duré longtemps. Elle a été marquée par la création de deux commissions : relations cadres-employés et femmes. Cette commission femmes est une rareté de Mai 1968, parce que je n'en trouve pas d'autres dans la littérature historique. C'était le seul organisme de l'Office Central constitué majoritairement de femmes, et elles étaient particulièrement discriminées. Quelques hommes, délégués du personnel, très minoritaires (deux), étaient réceptifs (il n'y avait pas une seule femme dans le conseil syndical). Le compte-rendu de cette commission était tellement dévastateur que je l'ai lu lors d'un Comité d'Entreprise plus de 20 ans après : la Direction n'en était pas émue, parce que cela correspondait à notre analyse habituelle et à nos revendications, et aussi à ce qu'elle constatait. Mais savoir que çà n'avait pas changé en 20 ans, c'était la preuve qu'il fallait une politique volontariste pour redresser la barre. Ce qui a été négocié dans le dernier des 23 plans d'égalité professionnelle de la loi Roudy de 1984.
Alors que le Conseil d'Administration de la MSA s'y était opposé depuis des années, en voulant conserver la Convention Collective de l'Office Central****, en refusant les négociations nationales de la Mutualité (convention dite à titulaires multiples), Mai 1968 s'est traduit par la signature locale de la convention collective d'origine nationale.
Je vais donner aux Archives Municipales de Landerneau les documents de cette période. En les triant, je retrouve des questions ayant perduré des dizaines d'années : date d'effet de la prime d'ancienneté au 1er janvier, prime d'ancienneté de 1 ou 2%, place du restaurant interentreprises, durée de la pause déjeuner (35 ou 40 mn), mutations interentreprises, embauche des femmes seulement comme dactylos, retenue logement de l'employée de la pouponnière ...
NB : j'ai dévoré le livre en 3 jours. Il aurait cependant gagné à être plus concis.
* L'expulsion dans ce triangle (Ploudaniel, Trégarantec, St Méen) a été largement rapportée dans la presse nationale, mais j'ai compris que les députés catholiques républicains sont intervenus pour calmer les esprits. Au contraire des royalistes, qui me l'ont raconté 60 ans après.
** Agro : Institut National d'Agronomie (études supérieures, niveau ingénieur)
*** Ma mère m'a raconté comment en 1981, elle a assisté à l'explosion de misogynie des dirigeants agricoles, quand Mitterrand a nommé Édith Cresson Ministre de l'Agriculture. Une femme comme Ministre ? Quelle marque de mépris ! Elle était obligée de leur rappeler qu'elle était aussi une femme.
**** A noter cependant que la référence dans les négociations sur la convention collective ou les salaires était l'UCCMA (union des caisses centrales de la mutualité agricole). Un bon exemple du caractère moteur de certains acquis syndicaux.
Landerneau, le « Syndicat » : du corporatisme/fascisme au féminisme
Évolution sur 100 ans d'un organisme, créé pour consolider l'ordre social, et passant du corporatisme (fascisme) dans les années 30/40 à un plan d'égalité professionnelle en 80/90, au travers d'une commission en mai 68 puis d'une prise de conscience. Un livre de Jean-Pierre Sénéchal décrit la période 1934-1938.
7 août 2018



